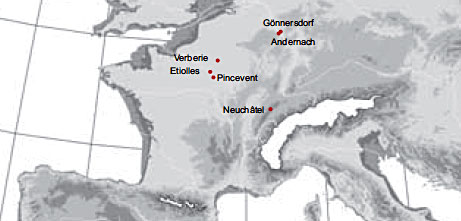Près de trois millions d'années séparent les premiers outils fabriqués par l'homme des premières images préhistoriques : cette longue période, équivalente de celle qui marqua l'émergence de Homo au sein des Hominidés quelque part en Afrique orientale, est dominée par un phénomène évolutif spécifique à l'homme : sa cérébralisation. Avec ses lobes frontaux développés, le cerveau d'Homo sapiens sapiens fossilis offrait une complexité et des possibilités fonctionnelles sans précédent ; c'est alors qu'apparaît l'art, trente mille à quarante mille ans à peine avant notre ère.
Ce lien en quelque sorte organique entre le cerveau évolué de l'homme préhistorique moderne et la création artistique dont il est l'auteur s'inscrit dans la perspective des comportements métaphysiques proprement et exclusivement humains attestés par des sépultures aménagées dès le Paléolithique moyen, deux à trois dizaines de millénaires auparavant : une bonne trentaine d'inhumations individuelles ou collectives, réalisées par des Néandertaliens (Homo sapiens neandertalensis) en Europe et au Moyen-Orient.
Cependant, l'acte de représenter, c'est-à-dire d'inventer entre soi et son univers une forme, de l'inscrire pour durer dans la pierre ou l'os, bref d'introduire de l'imaginaire pur dans la matérialité concrète des objets et des parois rocheuses, est absolument nouveau et conduit à notre modernité, celle du visuel et de l'abstrait.
Nouveau, le phénomène artistique est également universel. Jusqu'aux années 1970, l'ancienneté et la multitude des travaux consacrés à l'art paléolithique franco-cantabrique d'une part, la rareté des recherches appliquées ailleurs – à l'exception de l'Afrique saharienne et australe – s'étaient conjuguées pour laisser croire que les origines de l'art préhistorique étaient européennes ; il n'en est rien. En Australie, des travaux ont donné des datations absolues au carbone 14 archéologiquement bien fondées ; celles-ci montrent que d'assez nombreux ensembles gravés ou peints en abris et en grottes sont contemporains de l'art pariétal magdalénien de France et d'Espagne ; certains sites ont même plus de vingt mille ans ; ils sont donc plus anciens que l'essentiel de l'« art occidental préhistorique ». Il en est de même sans doute en Amérique du Sud, au Brésil notamment, mais aussi en Argentine et au Chili, où les sites correctement datés au-delà de 10 000 B.P. (before present), voire 15 000 B.P. et plus, se multiplient sous l'effet de recherches intensives développées à partir de 1980. L'Afrique et l'Asie – l'Inde en particulier – offrent aussi une multitude de sites d'art rupestre appartenant à des cultures anciennes dont les modes de vie permettent de les comparer aux cultures du Paléolithique supérieur européen.
Séries d'incisions, nappes de cupules ou de points, signes géométriques, files d'animaux, d'hommes, d'armes... témoignent abondamment de la conception de rythmes, de séquences, en un mot de types de numération : une dimension abstraite caractérise la plupart des formes d'art préhistorique monumentales – art rupestre et art pariétal – ou mobilières – les objets et supports amovibles. En ce sens, les arts préhistoriques annoncent les écritures ; cependant, ils sont profondément figuratifs par les deux thèmes majeurs qu'ils privilégient : l'homme et les animaux. Le premier fut dessiné dans la variété infinie de ses attitudes, postures, accoutrements ; les animaux dans leur extrême diversité témoignent des choix des chasseurs aussi bien qu'ils illustrent partiellement les faunes sauvages locales ou encore la domestication, lorsqu'elle intervint à diverses époques et sur chaque continent.
Le choix des supports montre aussi la richesse des comportements symboliques des hommes préhistoriques : armes et outils furent parfois richement décorés comme pour souligner la valeur et l'importance qu'ils revêtaient pour l'accomplissement des tâches quotidiennes ; mais les « objets d'art », sans fonction utilitaire, sont également nombreux dès les périodes les plus anciennes comme le prouvent les statuettes animales et humaines modelées en terre et cuites par des Gravettiens d'Europe centrale, il y a plus de 25 000 ans.
Partout dans le monde, l'art monumental est un mode d'expression de plein air, qu'il s'agisse de représentations en abri, sur roches ou même sur dalles au sol ; la seule exception fut celle, merveilleuse, de l'art pariétal paléolithique, un art des profondeurs, celui des grottes et des cavernes.
Plus que tout autre vestige archéologique, l'art préhistorique reflète directement la pensée, le rêve de ses auteurs, les cosmogonies et les symboles de leurs groupes. Il est un lien privilégié de compréhension entre les hommes préhistoriques et nous-mêmes.
Les objets gravés de figures animales et de motifs abstraits ou géométriques trouvés avant les grandes recherches et classifications d'Édouard Lartet, Henry Christy, Félix Garrigou en Périgord et dans les piémonts pyrénéens, au cours des années 1860, passèrent pour « celtiques », tel l'os gravé de deux biches du Chaffaud (Vienne), dégagé vers 1834. Les fouilles des grands gisements comme Laugerie-Basse, La Madeleine le long de la Vézère en Dordogne, celles de Bruniquel (Tarn-et-Garonne), de Brassempouy (Landes), de Lourdes (Hautes-Pyrénées), puis d'Isturitz (Pyrénées-Atlantiques), du Mas-d'Azil (Ariège) permirent d'établir des classifications chronologiques relatives, à partir des séquences stratigraphiques mises au jour. Ainsi l'idée de l'ancienneté pré-historique d'un art d'objets s'imposa peu à peu aux savants pionniers (Édouard Piette, en particulier) de la seconde moitié du xixe siècle, parallèlement donc aux découvertes d'hommes fossiles et leurs habitats, industries et sépultures. D'entrée, les préhistoriens avaient été frappés par les représentations d'animaux appartenant à des espèces éteintes ou disparues de nos régions : des mammouths, des bisons, des rennes ; l'abondance des débris osseux de rennes consommés par les chasseurs les inclina à attribuer à un « Âge du renne » les couches d'habitats qui recélaient ces vestiges, associés à des objets gravés. Alors même que l'ancienneté « antédiluvienne » de l'Âge du renne ne pouvait être évaluée correctement ni bien sûr datée, l' art mobilier des chasseurs préhistoriques avait été reconnu sans difficultés majeures. Lorsque, en 1879, don Marcelino de Sautuola découvrit les peintures du plafond de la grotte d' Altamira (Cantabrie) où il pratiquait des fouilles en amateur éclairé, l'homme préhistorique était encore envisagé comme un sauvage, bon ou mauvais, mais en tout cas pas comme l'auteur des splendides bisons bichromes d'Altamira ! L'art mobilier avait été admis ; c'était principalement un art de gravure, parfois de sculpture ou de découpage de lames osseuses, toujours de dimensions réduites ; on n'avait pas encore compris l'extraordinaire niveau esthétique et artistique atteint par ces chasseurs primitifs. Ce n'est qu'au début de ce siècle, en 1902, qu' Émile Cartailhac, premier titulaire d'une chaire d'enseignement de la préhistoire, reconnut dans son célèbre écrit Mea culpa d'un sceptique l'authenticité des peintures d'Altamira qu'il avait intempestivement contestée. En réalité, une vingtaine de grottes découvertes à partir de 1895 avaient conduit à la reconnaissance de l'art monumental souterrain : la grotte Chabot dans le canyon de l'Ardèche avec ses vigoureuses gravures de mammouths, la grotte de Pair-non-Pair au milieu du vignoble girondin, offrant plusieurs panneaux de gravures d'animaux profondément incisés, la longue et étroite galerie de Marsoulas (Haute-Garonne) possédant de multiples signes peints et gravés, ainsi que des représentations de bisons et de chevaux, les gravures variées de la galerie sinueuse et basse de La Mouthe (Dordogne) dont les sédiments livrèrent une lampe en calcaire décorée d'un bouquetin (voir ) contribuèrent d'abord à l'identification de l'art pariétal et à son extension dans tout le sud-ouest de la France jusque sur la rive droite du Rhône ; les deux découvertes presque simultanées à la fin de l'été de 1901 des Combarelles et de Font-de-Gaume, près des Eyzies-de-Tayac au cœur du Périgord noir, emportèrent ensuite et définitivement la conviction générale ; elles étaient dues à Denis Peyrony dont les fouilles en Périgord furent fondamentales pour l'établissement d'une chronologie stratigraphique renouvelée et encore en partie valide, et furent aussitôt mises en valeur par Henri Breuil qui en fit les relevés ; elles comptent, comme Lascaux, parmi les « géants » de l'art préhistorique pour reprendre le vocable d'Henri Breuil, avec leurs centaines de gravures (Combarelles) et de gravures et peintures (Font-de-Gaume) attribuées à la phase classique du Magdalénien.
Si, de nos jours, aucun problème majeur d'identification et d'authenticité ne se pose plus lors d'une découverte, les questions de datation de l'art paléolithique ne trouvent pas toujours une réponse satisfaisante ou définitive. Sur ce point, il faut distinguer l' art mobilier de l'art pariétal.
Lorsqu'un objet préhistorique est découvert en surface comme la « Vénus » de Sireuil (), hors de tout contexte stratigraphique ou culturel, son attribution reste conjecturale et, dans le meilleur des cas, ne repose que sur une comparaison morphologique et stylistique ; dans cet exemple, la ressemblance de la Vénus de Sireuil avec celle effectivement gravettienne de l'abri du Facteur à Tursac (voir) autorise à l'introduire dans l'ensemble des « Vénus gravettiennes » trouvées dans toute l'Europe jusqu'en Ukraine (Kostienki).
L'appartenance à une couche archéologique datée, soit relativement dans une séquence stratigraphique, soit absolument par le carbone 14, est bien entendu déterminante pour des blocs gravés ou sculptés comme ceux (V) du Roc de Sers (Charente), solutréens, ou pour tout objet d'art ; a fortiori lorsqu'il s'agit d'un type d'objets trouvés en de multiples exemplaires dans des gisements différents et plusieurs fois datés comme, par exemple, les figurines animales en « contour découpé » (Saint-Michel d'Arudy, voir), les rondelles osseuses perforées ( Mas-d'Azil, voir), les propulseurs sculptés (La Madeleine, Enlène - Trois-Frères, Bruniquel, voirIII), tous caractéristiques du Magdalénien moyen. En définitive, les milliers d'objets décorés ou sculptés trouvés en fouilles sont pour la plupart datés ou placés de façon valide dans la chronologie du Paléolithique supérieur étendu à l'Europe entière.
Il n'existe de datation directe de l'art pariétal que dans les cas d'un rapport stratigraphique dûment établi : une paroi décorée enfouie dans une (ou plusieurs) couche archéologique déterminée et datée, ou un élément décoré de paroi trouvé dans une couche archéologique également bien définie ; moins de dix grottes paléolithiques pourraient prétendre encore aujourd'hui à une datation de cette qualité ; la petite grotte à gravures fines sur calcaire concrétionné de la Mairie à Teyjat (Dordogne) serait de celles-ci ; elle est datée de la fin du Magdalénien. Les dessins aux traits rouges de la grotte de la Tête du Lion à Bidon (Ardèche), un bovidé, une tête de bouquetin et une de cerf, une nappe de points, sont pratiquement les seuls à être datés directement : en effet, des éclaboussures des colorants utilisés furent décelées sur le sol préhistorique à proximité d'un foyer, datés au 14C de 20 650 A 800 ans B.P. (laboratoire de Lyon, Ly. 848) : ils appartiennent donc au Solutréen ancien rhodanien.
Il arrive enfin que l'attribution chronologique soit avancée de façon incontestable lorsque le contexte archéologique trouvé dans la grotte ornée ou à son entrée le permet. La grotte de Fontanet (Ariège) dont l'entrée paléolithique fut bouchée naturellement, vraisemblablement à la fin du Paléolithique, contient des foyers datés, des outils, des restes osseux d'animaux consommés, ainsi que des empreintes humaines et animales, du Magdalénien moyen ; or c'est précisément à cette culture bien développée dans cette région pyrénéenne que renvoient toutes les comparaisons techno-stylistiques appliquées aux quelques dizaines de splendides gravures et peintures parfaitement conservées sur ses parois.
Les comparaisons techno-stylistiques et thématiques restent le dernier recours pour une éventuelle attribution chronologique et culturelle ; elles ne sont véritablement fondées que dans le cas d'une uniformité des représentations de la cavité concernée en correspondance avec une homogénéité culturelle régionale, par exemple Niaux () appartenant au Magdalénien de l'Ariège.
Désormais, il apparaît clairement que les analyses, descriptions, inventaires et classifications doivent précéder les interprétations des représentations mobilières et pariétales ; il est plus fondé de faire apparaître ces documents dans tous leurs caractères propres et leurs liens archéologiques et chronologiques que de prêter à leurs auteurs, muets, nos discours et nos théories.
Quelques courts épisodes tempérés, comme celui d'Arcy vers 31 000 ans B.P. ou celui de Lascaux (17 000 ans B.P.), s'intercalent dans la continuité climatique des deux derniers stades würmiens (35 000-10 000 ans B.P.) caractérisés par un froid rigoureux, particulièrement à la fin du stade III après l'oscillation tempérée de Tursac, entre 22 500 ans et 19 500 ans B.P. Faune et flore bien adaptées à ces conditions périglaciaires ne se modifient guère jusqu'au retrait de l'inlandsis et jusqu'au réchauffement humide inaugurant la période géologique actuelle, l'Holocène. En somme, les paysages pléistocènes offrent aux chasseurs paléolithiques des moyens de subsistance et des conditions de vie relativement stables et identiques pendant tout le temps d'éclosion de l'art paléolithique.
C'est sur ce fonds technologique nouveau que furent distinguées les quatre grandes cultures d' Homo sapiens sapiens en Europe paléolithique. Les distinctions ont d'abord été faites à partir des industries et en fonction des données stratigraphiques par l'abbé Breuil notamment (1912) ; elles sont complétées de nos jours par les observations paléontologiques, paléoclimatiques et écologiques, ainsi que par les données spécifiques des formes d'art pariétal et mobilier.
L'art figuratif apparaît dans la plus ancienne culture reconnue d'Homo sapiens sapiens en Europe, l'Aurignacien, qui s'étendit dans toute l'Europe de l'Oural aux Asturies entre 33 000 et 26 000 ans B.P. Deux sites du haut Danube, Vogelherd et Hohlenstein-Stadel (Allemagne), ont livré notamment une demi-douzaine d'animaux et une statuette humaine masculine sculptés dans de l'ivoire de mammouth ; leurs caractères figuratifs parfaitement attestés interdisent de se référer à une quelconque « primitivité » pour les décrire. Un habitat de Basse-Autriche, Galgenberg, a fourni une figurine humaine en pierre d'une élégance comparable. Plusieurs gisements aurignaciens du Périgord, sensiblement contemporains, ont fourni également des documents mobiliers mais qui n'ont cependant pas les mêmes données figuratives. Au contraire, hormis un phallus sculpté dans une cheville osseuse de boviné, ce sont des objets présentant des motifs gravés abstraits, en particulier des alignements de petites cupules et de traits (abri Lartet, ) pour lesquels les chercheurs évoquèrent des systèmes de compte ou des calendriers.
Outre ces objets mobiliers en os, les Aurignaciens de la Vézère exécutèrent des représentations semi-pariétales sur des blocs et des dalles calcaires placés dans leurs abris rocheux. À l'exception du profil animal de Belcayre, les figurations animales, une dizaine, sont rudimentaires ; par contre, la quarantaine de représentations vulvaires sont soit réalistes soit déjà abstraitement formulées.
C'est l'image de la femme qui caractérise la majeure partie de l' art mobilier gravettien (30 000-21 000 ans B.P.). L'aire de répartition du Gravettien est identique à celle de l'Aurignacien, mais on note une extension tardive dans la péninsule italique et surtout une forte implantation, ancienne, en Europe centrale, particulièrement en Moravie.
À Dolni Vestonice et à Pavlov, les Gravettiens modelèrent avec la terre, qu'ils firent cuire ensuite, des dizaines de petites figurines animales : ours, félins, loups, mammouths, etc., et aussi une bonne trentaine de femmes. La plupart furent traitées selon le canon stylistique propre à tout le Gravettien : de lourds seins sur lesquels sont plaqués des avant-bras frêles ; des ventres rebondis et des volumes fessiers excessifs, des jambes courtes, potelées et séparées par un sillon médian prolongeant la fente vulvaire incisée ; elles rappellent, souvent fortement, la trentaine de statuettes russes (Kostienki, Gagarino), une partie de la trentaine de celles trouvées en France (Brassempouy, Lespugue, Laussel, ), et en Italie (Baoussé Roussé, ), et bien sûr celle proche de Willendorf (Autriche, ). D'autres statuettes moraves sont au contraire complètement schématisées ; un corps en baguette plus ou moins allongé portant deux lourds seins.
La Vénus de Willendorf La Vénus de Willendorf, art gravettien, 30000-25000 av. J.-C. Calcaire. Hauteur: 10, 4 cm. Musée d'Histoire naturelle, Vienne, Autriche.Les figurations animales sur bloc du Gravettien n'ont ni le renom ni les qualités esthétiques des Vénus, sauf quelques étonnantes exceptions comme un cheval gravé sur un galet de l' abri Labattut (Dordogne) exprimé en incisions si fines qu'elles font penser à la technique magdalénienne. Dans cet abri furent trouvés aussi plusieurs blocs calcaires portant vestiges d'animaux peints et un bloc décoré d'une « main négative » noire ; cette main faite au pochoir est une des seules bien datées du Paléolithique supérieur qui en compte environ trois centaines exécutées dans une vingtaine de grottes en Espagne et en France, en particulier dans celle de Gargas (Hautes-Pyrénées) qui en possède à elle seule plus de deux cents pour la plupart incomplètes (doigts tronqués).
C'est également avec la plus grande vraisemblance que l'on date du Gravettien les gravures incisées profondément de Pair-non-Pair (Gironde) dont l'unique accès fut comblé précisément par des Gravettiens. Comme ceux des Pyrénées centrales et de l'Espagne cantabrique (Hornos de la Peña), les artistes gravettiens de Pair-non-Pair sont les premiers à avoir réalisé des représentations en grotte ; ce sont les créateurs de l'art pariétal souterrain.
Tandis qu'en Europe centrale, en Europe orientale, dans la péninsule italique, la civilisation gravettienne se maintient en se diversifiant, une nouvelle culture se répand au sud de la Loire et à l'ouest du Rhône en France, des Pyrénées aux Cantabres, et le long du littoral levantin de l'Espagne : le Solutréen ; sa durée est relativement courte, de 21 000 à 18 000 ans B.P. environ. L'art solutréen n'est pas abondant. Rares sont les habitats ayant livré de nombreuses œuvres mobilières, mais ils sont remarquables : la grotte du Parpallo (province de Valencia, Espagne) recélait plusieurs centaines de plaquettes gravées du Solutréen levantin ; dans les Cantabres, le porche monumental de la grotte ornée d' El Castillo contenait également de superbes gravures sur pierre et omoplates (des têtes de biches, notamment). Dans la grotte ornée d' Isturitz (Pyrénées-Atlantiques), les niveaux solutréens, moins riches en art mobilier que ceux du Magdalénien, livrèrent des ébauches de bas-reliefs.
Des sculptures monumentales sur bloc attestent, comme la fabrication d'outils en silex portée à la perfection, la maîtrise technologique des Solutréens pour la taille de la pierre. Au Fourneau-du-Diable (Dordogne), deux blocs sculptés et un bloc peint ont été découverts au milieu de l'occupation solutréenne ; sur l'un d'eux, de près d'un mètre cube, trois bœufs se détachent en bas relief d'autres représentations animales partiellement ébauchées.
Treize blocs sculptés, adossés à une falaise et disposés en hémicycle, dominaient l'habitat solutréen du Roc de Sers (Charente) ; bouquetins affrontés (), homme portant sur l'épaule un gourdin et fuyant un bison en pleine charge, chevaux (), bisons et rennes, tous vigoureusement exécutés en forts bas-reliefs, forment un des ensembles figuratifs les plus puissants du Paléolithique supérieur.
L'imprécision des datations laisse sans doute de côté quelques sites pariétaux gravettiens du Périgord et du Quercy ; vers l'est, outre le panneau de la grotte de la Tête du Lion à Bidon, on attribua au Solutréen inférieur les gravures de la grotte Chabot (Gard) qui abrita diverses occupations de cette période. Plusieurs ensembles pariétaux cantabriques sont probablement solutréens, en rapport avec l'art mobilier local ; la certitude est acquise pour les peintures et gravures de la grotte de Chufin (province de Santander) où un habitat du Solutréen supérieur fut récemment fouillé et daté (du XVIIIe millénaire).
Le Magdalénien fut la plus brillante et la plus puissante des civilisations du Paléolithique supérieur ; elle se développa dans le Tardiglaciaire (Würm IV) pour s'achever avec lui. À son début, vers 17 500 B.P., le Magdalénien est encore peu dense, du moins dans l'ouest de l'Europe ; dans sa phase moyenne (Magdalénien III et IV), la multiplication des habitats dans toute l'Europe révèle une forte intensification démographique et des poussées en quelque sorte impérialistes se traduisant par une diversification régionale des traditions technologiques et artistiques, aboutissant finalement à une mosaïque de cultures fortement différenciées dispersées sur toute l'étendue du territoire européen libéré progressivement de sa chape glaciaire septentrionale et montagnarde (XIe millénaire).
L'essentiel des instruments et outils décorés, des œuvres mobilières et pariétales est magdalénien ; dans bien des appréciations générales portées sur l'art paléolithique, il serait plus fondé de parler d'art magdalénien. Les artistes magdaléniens perpétuent les techniques et les modes d'expression paléolithiques qui reflètent avant tout la continuité des conditions écologiques et économiques de leur vie ; mais ils inventent des formes nouvelles et mènent à la perfection l'art de la gravure et de la sculpture d'objets () aussi bien que celui de la peinture et du dessin sur les parois des cavernes.
Quatre tendances stylistiques, pouvant être contemporaines, éventuellement simultanées dans les mêmes habitats ou dispositifs pariétaux, caractérisent l'art magdalénien : le décoratif, le schématique, l'abstrait et le figuratif.
Les motifs ornementaux décoratifs intéressent exclusivement de petits objets, le plus généralement des fûts de bois de renne ou des diaphyses de membres. Un rapport constant existe entre ces supports organiques allongés et étroits et des motifs spiralés, ocellés, ou multilinéaires toujours finement incisés ; selon les régions et les époques, la tendance décorative prit une ampleur remarquable, comme en témoignent par exemple les « baguettes demi-rondes » en bois de renne du Magdalénien moyen ().
L'art schématique magdalénien est lui aussi exclusivement mobilier ; il s'agit principalement d'une schématisation, parfois très poussée, de têtes animales vues de face ou de profil, d'animaux entiers de profil, en de rares cas de silhouettes humaines devenues « fantomatiques » (os gravé de Raymonden, ). Souvent, la répétition linéaire du même dessin schématisé aboutit soit à la création d'un ensemble décoratif, soit à l'élaboration de motifs géométriques complètement abstraits.
L'abstraction graphique caractérise pleinement l'art magdalénien, depuis ses phases les plus anciennes. Auparavant, seule une partie de l'art gravettien mobilier de Moravie avait atteint un niveau comparable. L'altération de motifs figuratifs par la voie de la schématisation conduite à son extrémité explique la plupart des dessins géométriques mobiliers sur os. Cependant, aucune dérivation graphique n'est à l'origine de la quasi-totalité des signes pariétaux et mobiliers qui constituent dans le Magdalénien un système de communication extrêmement complexe, original et nouveau. Alignements de points ou de traits, chevrons, cercles, ovales, rectangles vides et clairsemés, lignes ramifiées, grilles, angles, etc. ont été gravés par milliers sur des supports mobiliers, osseux et lithiques, gravés et peints par milliers sur les parois des grottes magdaléniennes. Exceptionnellement isolés, les signes furent parfois assemblés en panneaux sans aucune intrusion figurative comme à Fontanet et à Niaux en Ariège, à El Castillo () ou à La Pasiega dans la région de Santander.
Moins nombreuses que les signes, les représentations figuratives magdaléniennes ont davantage stimulé les commentaires soit par leur beauté, soit par leur étrangeté. L'art animalier magdalénien de Lascaux, d' Altamira, de Font-de-Gaume ou de Niaux, parmi des dizaines d'autres dispositifs pariétaux, atteint une perfection incontestée ; ses qualités esthétiques majeures sont la maîtrise totale du dessin reposant sur la reproduction fidèle des proportions anatomiques associée à l'invention de la perspective graphique, une technique picturale parachevée et le sens des compositions monumentales. À l'opposé, les figurations humaines magdaléniennes semblent répondre à des critères plus sémantiques que graphiques, à l'exception tout à fait notable de la centaine de femmes et d'hommes gravés en incisions fines sur des dalles calcaires mobiles de la grotte de La Marche (Vienne) dans des lacis de traits parfois extrêmement difficiles à débrouiller.
Les grottes solutréennes et gravettiennes ne sont guère profondes, et leurs dispositifs pariétaux rarement denses ; les Magdaléniens, au contraire, cherchèrent à pénétrer le plus profondément dans les cavités qu'ils choisirent et s'approprièrent en étendant au maximum la distribution de leurs représentations. Des galeries basses et tortueuses, à peine pratiquables comme celles des Combarelles ou de La Mouthe, ont été décorées jusqu'à leurs extrémités finales ; une partie des représentations disséminées dans de vastes réseaux, comme Niaux, La Cullalvera ou Rouffignac, se trouvent à plusieurs kilomètres des entrées empruntées par les Paléolithiques ; ailleurs, les Magdaléniens ont enfoui des représentations dans des diverticules exigus, imposant des reptations pénibles, mais accessibles à partir de vastes galeries aisées à parcourir (Mas-d'Azil, Bédeilhac...). En définitive, l'art pariétal souterrain est essentiellement magdalénien, expression totalement originale et unique d'une recherche de l'obscurité, absolue et intemporelle, à l'écart du vécu quotidien.
Sous le nom générique de « gravure », les préhistoriens ont coutume de rassembler les représentations réalisées soit par incisions, fines (), larges, profondes, à bords symétriques ou asymétriques, etc., soit par raclages, larges, superficiels (), profonds, etc., sur des supports résistants mais tendres comme des calcaires ou des tissus organiques animaux (sans doute aussi végétaux), avec des instruments plus durs et coupants tels des éclats de silex à bords bruts ou retouchés. Les quelques représentations gravées aurignaciennes sur blocs et dalles calcaires, obtenues par un martelage ou un bouchardage préalable à l'exécution d'un sillon continu, traduisent une technique exceptionnelle pour l'art paléolithique mais parfois fréquente en d'autres aires préhistoriques (une partie de l'art rupestre de la zone saharienne par exemple). Les gravures magdaléniennes sont infiniment plus nombreuses que les peintures ; leur conservation est certes meilleure que celle des peintures mais ce phénomène ne suffit pas à lui seul pour expliquer leur grand nombre ; par contre, il faut prendre en compte la facilité de manipulation d'outils simples, les dimensions des gravures plus réduites que celles des représentations peintes. Il convient toutefois de remarquer que certaines grottes possèdent exclusivement (ou presque) des gravures, Combarelles ou Les Trois-Frères par exemple, ou des peintures comme Niaux. Les tracés digitaux figuratifs ou non (Arcy) sont assimilés par analogie de forme aux gravures ; ils n'intéressent que des supports pariétaux tendres (argileux), le plus souvent mal conservés.
La « sculpture » paléolithique recouvre en réalité deux modes d'expression bien distincts : d'un côté la ronde-bosse, de l'autre les reliefs sur fond relativement plan. La statuaire paléolithique n'est jamais ni monumentale ni souterraine : les rondes-bosses sont petites, faites dans des matériaux tendres, faciles à tailler et à polir comme des ivoires, des os et des pierres calcaires ou schisteuses. Les bas-reliefs, les reliefs exhaussés sont, selon leur ampleur, une accentuation des gravures dans la recherche d'une troisième dimension ou le résultat d'une modification en profondeur du support osseux ou rocheux : de nombreux outils magdaléniens ont été ainsi sculptés ; une expression plastique comparable est parfois attestée sur des parois rocheuses de grottes (tête du grand cheval de Comarque, Dordogne). Cependant, les meilleures illustrations de sculpture pariétale atteignent presque le haut-relief, elles se trouvent dans des abris : Cap-Blanc (Dordogne) et Angles-sur-l'Anglin (Vienne) au cours du Magdalénien. Plus difficiles et plus longues à réaliser que les gravures, les représentations pariétales « sculptées » sont plutôt rares, toujours figuratives (animalières), œuvres des Solutréens et des Magdaléniens.
Sous la rubrique « peinture », plusieurs types de représentations sont groupés, non sans quelque abus ou imprécision. Le caractère commun est celui de l'apposition sur un support lithique ou osseux de matières colorantes d'origine minérale (oxydes ferriques, manganèse, kaolin, argile) directement prélevées dans les sols ; les matières colorantes d'origine végétale, si elles furent employées, ne se sont pas conservées, à l'exception, quelquefois vérifiée, de charbons ( Niaux). Sur le plan technique et plastique, il y a lieu de distinguer les dessins, faits au trait, des peintures proprement dites, exécutées en aplats monochromes ou bichromes, avec ou sans contour tracé séparément. Les animaux du Salon noir de Niaux (), ceux plus anciens de la « frise noire » () de Pech-Merle (Lot) offrent les qualités les plus parfaites de l'art du dessin pariétal comme les chevaux d'Ekaïn (Espagne), les bisons de Font-de-Gaume ou d'Altamira, les taureaux et chevaux de Lascaux sont à l'apogée de l'art pictural des grottes magdaléniennes.
À la continuité quelque peu uniforme des techniques paléolithiques, il est possible d'opposer, au moins partiellement, une assez nette diversité stylistique. L'abbé Breuil fut le premier à tenter une classification des formes et des techniques : il imagina deux cycles, répétant une progression du plus simple au plus complexe, du trait à la polychromie par exemple, un cycle ancien « aurignaco-périgordien », un second plus récent et plus dense « solutréo-magdalénien ». Une abstraction logique excessive ajoutée aux incertitudes chronologiques ruina cette tentative pionnière (1952) qui avait toutefois bien mis en valeur certains critères stylistiques, telle la mise au point graphique de l'illusion de la perspective pour des représentations en deux dimensions vues de profil. D'animaux représentés en profil absolu, sauf les cornes vues de face, c'est-à-dire en « perspective tordue » (le bison gravé de La Grèze, par exemple), se différenciait le profil en « perspective » des animaux du Magdalénien moyen dégageant les membres ou les appendices crâniens selon des conventions graphiques de la perspective fuyante (bisons de Niaux).
André Leroi-Gourhan, en s'appuyant sur de meilleures approximations chronologiques, en insérant plus largement et plus précisément les données techno-stylistiques de l'art mobilier dans son analyse des représentations pariétales, aboutit en 1965 à une classification beaucoup plus fine et archéologiquement mieux fondée que celle de son prédécesseur. L'étude des contours cervico-dorsaux, de l'implantation des appendices céphaliques, des éléments graphiques internes comme le dessin de la croix scapulaire de certains chevaux, l'observation détaillée des modes de perspective lui permirent de distinguer cinq styles, parcourant une sorte de trajectoire continue et progressive d'un stade 0 « pré-figuratif » à un stade IV récent très élaboré, à la fin du Magdalénien : au Châtelperronien correspond la période pré-figurative, à l'Aurignacien le style I, au Gravettien et à l'Inter-Gravetto-Solutréen le style II, au Solutréen et au Magdalénien ancien le style III et au Magdalénien moyen et récent le style IV. Ainsi était surmonté le problème incompréhensible que posait la rupture entre deux cycles imaginée par H. Breuil ; ainsi était affirmée l'idée d'un progrès continu des formes figuratives vers une sorte d'académisme visuel ou photographique magdalénien.
Alors que le recul donné au préhistorien lui permet, en considérant l'archaïsme graphique de profils d'animaux gravettiens et l'élaboration parfaite d'animaux magdaléniens, de parler globalement d'une évolution stylistique de l'art pariétal et du mobilier paléolithique, rien ne l'autorise à induire une parenté généalogique de ces styles qui appartiennent à des cultures différentes les unes des autres et sans liens directs. Plus qu'une succession ordonnée de stades faisant supposer un parallélisme étroit entre chronologie et style, invraisemblable sur un espace et pour une durée aussi considérables, les travaux postérieurs à 1980 tendent à distinguer un premier ensemble, pré-magdalénien, fort disparate, groupant les styles I à III définis par André Leroi-Gourhan d'un second ensemble, magdalénien infiniment plus homogène et fourni, groupant les styles IV ancien et récent selon Leroi-Gourhan, mais offrant des diversifications stylistiques régionales notables. Dans le premier groupe, les séries stylistiques sont souvent trop faiblement représentées et datées pour qu'il soit possible de dégager des normes stylistiques générales valides, à l'exception sans doute des Vénus. Par contre, il est possible, au sein du Magdalénien, de distinguer des courants, des traditions, en rapport avec des objets ou des thèmes propres à certaines époques et régions culturelles : nul ne confondrait les bisons et chevaux des grottes pyrénéennes avec ceux, contemporains, des cavités périgourdines, alors que les mêmes moyens techniques furent utilisés.
Le vaste déploiement ethnographique des chercheurs européens dans le monde primitif influença fortement les préhistoriens du xixe siècle qui pensaient que les primitifs d'hier et ceux d'aujourd'hui étaient semblables. Cette hypothèse s'est révélée fausse tant en raison de la diversité des formes anthropologiques et culturelles que des phénomènes évolutifs propres et des variations climatiques et écologiques, mais elle introduisit alors l'idée que l'art préhistorique était magique ou que la magie était à son origine. Les statuettes féminines, avec leurs ventres énormes et leurs seins pendants, évoquaient à ces interprètes une magie de la « fécondité » orientée vers un culte de la « déesse mère », le moindre abdomen ballonné de cheval pariétal en faisait une jument mère tandis que les signes angulaires en V, avec ou sans axe médian, devenaient des « flèches » meurtrières pour expliquer une magie propitiatoire de la chasse.
En vérité, si l'image de la femme est un des paradigmes constants de la thématique paléolithique pariétale et mobilière, il est tout aussi clair que sa diversité morphologique ne correspond pas à une univalence symbolique ; en d'autres termes, la sexualité, la féminité, le matriarcat, etc. sont tout aussi envisageables que le fut la fécondité. De même, la magie de la chasse est bien peu imaginable si l'on note, comme le firent par la suite Max Raphaël et A. Leroi-Gourhan, que bien peu d'animaux sont « blessés » ou atteints de « flèches » et ce dans quelques grottes seulement ; en outre, les comparaisons précises entre la faune figurée et la faune chassée d'un même site indiquent sans conteste qu'une partie au moins des deux ensembles n'est pas commune : un seul renne a été figuré sur les parois de Lascaux parmi des centaines de chevaux, bovins, cerfs ; les neuf dixièmes des débris osseux trouvés dans la grotte proviennent de rennes, peut-être consommés par les artistes eux-mêmes.
Pendant plus d'un demi-siècle, l'abbé Breuil contribua directement aux découvertes de représentations mobilières et pariétales et à leur étude descriptive ; son œuvre, couronnée par une publication fameuse en 1952, Quatre Cents Siècles d'art pariétal, fut véritablement constitutive de la connaissance de l'art préhistorique, au moment même où les fouilles qui se multipliaient lui permirent d'établir les « subdivisions du Paléolithique supérieur » sur des bases chronostratigraphiques bien établies. Le comparatisme ethnographique pratiqué à l'époque des premières grandes découvertes de grottes ornées en Dordogne et en Espagne cantabrique est à la source des interprétations des représentations abstraites et figuratives faites par H. Breuil. Lui aussi invoque l'envoûtement magique d'animaux à chasser pour la survie de la communauté, la sublimation de la fécondité pour sa pérennité. Cependant, en bon dessinateur, il perçoit et met en valeur la beauté des animaux dont il ne trouve aucun équivalent dans d'autres arts préhistoriques et primitifs. Son concept du « grand art animalier occidental » le conduit à attribuer une certaine spiritualité à l'art pariétal, à imaginer des cérémonies initiatiques et à prêter un pouvoir surnaturel à des images extraordinaires comme le grand être mi-humain mi-animal peint et gravé, placé au-dessus des centaines d'animaux et signes gravés du « sanctuaire » de la caverne des Trois-Frères, qu'il baptise « Dieu cornu » ().
Pour expliquer les signes géométriques nombreux accompagnant les animaux dessinés dans un style « naturaliste », H. Breuil tente des rapprochements morphologiques avec des armes, des embarcations, des huttes utilisées dans des sociétés primitives actuelles. Des signes du Périgord sont appelés « tectiformes » par analogie avec des huttes et donc des toits (voir illustration concernant la grotte de Font-de-Gaume) ; d'autres, plus simples, des Pyrénées magdaléniennes, sont des « claviformes », par analogie avec des massues ; il existe aussi des « naviformes », des « scutiformes », etc. Finalement, l'interprétation de H. Breuil se fait en termes de réalisme visuel et rationnel : les hommes du Paléolithique supérieur agissaient et pensaient comme les Pygmées, les Bororos ou les Esquimaux..., mais ils peignaient et dessinaient mieux...
Dans un écrit pulié en 1945, Prehistoric Cave Paintings, mais qui resta ignoré en France jusqu'à sa publication en français en 1986, le théoricien de l'art allemand Max Raphaël s'écarta résolument de ce type d'interprétation rationaliste et ethnographique de l'art paléolithique en tentant de montrer que les représentations dans les grottes n'avaient pas été accumulées au gré de fantaisies ou d'expéditions de chasse mais qu'elles furent organisées, agencées délibérément en panneaux ou en files sur les parois souterraines. Ainsi tenta-t-il de comprendre la composition d'ensembles clairement organisés comme le grand plafond d' Altamira et l'interpréta-t-il en termes de totémisme. Cette idée de l'organisation pariétale des représentations changeait radicalement la conception de l'art paléolithique, de sa fonction sociale et de la mentalité prêtée aux artistes préhistoriques, plutôt occidentale et teintée d'exotisme ; cette idée est à la base des interprétations parallèles développées par Annette Laming-Emperaire dans son ouvrage La Signification de l'art rupestre paléolithique (1962) et surtout, par A. Leroi-Gourhan, Préhistoire de l'art occidental (1965).
Avec des orientations différentes assez marquées et des approches menées séparément, ces deux préhistoriens émirent l'hypothèse d'une bipartition sexuelle initiale sous-jacente à l'organisation des sanctuaires paléolithiques. Un principe « mâle » et un principe « femelle » formeraient une « dyade » (A. Leroi-Gourhan) fondamentale autour de laquelle se déploie l'ensemble des autres espèces et des signes représentés. L'hypothèse repose sur l'enregistrement statistique partiel (environ une soixantaine de grottes pour A. Leroi-Gourhan) des représentations pariétales en fonction de leurs « associations » spatiales – juxtaposition, proximité, éloignement, isolement – de leurs localisations dans les grottes – entrées, fonds, galeries. En effet, deux espèces leur apparurent majeures tant sur le plan quantitatif que sur celui de leurs localisations centrales dans les panneaux et ensembles structurés : le cheval et le bison. Des associations entre quelques représentations féminines et des bisons, considérées différemment, aboutirent à des interprétations inverses et croisées : A. Laming-Emperaire fit du bison un principe mâle, par complémentarité ; A. Leroi-Gourhan un principe femelle par identité. Mais l'une et l'autre interprétations renvoient à une même vision cosmogonique de l'univers paléolithique et de son expression pariétale.
L'interprétation du système des signes fut développée par A. Leroi-Gourhan à partir de 1958 ; il les considéra comme des « idéogrammes » et non comme des reproductions d'objets ou d'armes et les classa d'abord en deux groupes : celui des « signes pleins » et celui des « signes minces » ; par la suite, il créa un troisième groupe pour les signes ponctués qui, des points de vue morphologique et thématique (les associations), se distinguaient des autres. Comme il avait enregistré une association préférentielle des bisons et des chevaux dans les grottes, A. Leroi-Gourhan tenta de mettre en relief l'existence d'un couplage de signes minces avec des signes pleins, par exemple de bâtonnets ou de barres avec les rectangles ou des motifs ovoïdes. En s'appuyant sur l'analogie des formes et le parallélisme des associations, A. Leroi-Gourhan interpréta ce couplage comme la répétition, abstraite, de la dyade sexuelle figurée par les bisons et les chevaux, de sorte qu' une totale homogénéité symbolique caractérise les sanctuaires paléolithiques dans son analyse.
En inventoriant avec précision les représentations pariétales, en considérant avec soin les associations thématiques répétitives et fréquentes, en analysant les grandes compositions, A. Leroi-Gourhan, beaucoup plus distinctement encore que A. Laming-Emperaire et que M. Raphaël, démontra que les sanctuaires paléolithiques offraient une organisation élaborée, exprimant une conception complexe de l'Univers : l'art paléolithique était enfin considéré comme une sorte de langage, qui éclairait d'intelligence les cavernes obscures.
Aucune scène de chasse, de guerre, de rapports sexuels (humains ou animaux), de danse n'existe dans l'art paléolithique, alors que d'autres arts préhistoriques incluent, en proportions parfois élevées, ce type de récits graphiques. L'art paléolithique est un art codé ; il n'est pas une illustration du monde vivant – l'absence totale de paysages et de végétaux ainsi que de références à une quelconque réalité domestique (ni outil, ni instrument, ni arme) renforce cette mise à l'écart du réel vécu, parfaitement révélée par le choix d'un lieu souterrain, clos, obscur. Les grottes paléolithiques sont des réceptacles de symboles qui n'existent que pour ceux qui les connaissent et qui y accèdent.
Animaux et humains constituent exclusivement le stock des représentations figuratives, de façon bien distincte. Les figures animales ont, dès l' Aurignacien (mobilier) et le Gravettien (pariétal et mobilier), tous les attributs figuratifs, amplifiés et détaillés ensuite par les Solutréens et les Magdaléniens. Sauf de rares représentations hybrides, ou monstrueuses, les animaux figurés sont à l'image des animaux réels ; les artistes magdaléniens ont même régulièrement donné à leurs bêtes des attitudes ou des allures conformes à ce qu'ils voyaient dans la nature : la proximité des hommes du Paléolithique supérieur avec les animaux est manifeste et témoigne de la place fondamentale occupée par les animaux dans la vie quotidienne des hommes et donc dans leurs rêves et leurs mythes. On se souvient que les représentations humaines sont étranges, particulières ou segmentaires : symboles sexuels féminins, rarement masculins, fréquents dans l'Aurignacien et le Magdalénien, silhouettes et statuettes stylisées, visages déformés, êtres fantomatiques et composites, mains négatives. Les règles suivies pour représenter l'animal et l'homme pendant le Paléolithique sont antinomiques, tandis qu'elles sont souvent identiques dans d'autres cultures préhistoriques, en particulier quand se développe le schématisme.
Les signes paléolithiques abondent et offrent une diversité morphologique importante, inégalée ailleurs : plusieurs dizaines de types, en grande majorité magdaléniens, recouvrant des structures élémentaires, comme le point ou le tiret, et des structures complexes, tels les grands signes quadrangulaires à remplissages croisés de la région cantabrique. Il est difficile de distinguer des signes dans l'Aurignacien, tels qu'on les conçoit à partir des types magdaléniens ; les groupes de cupules creusées dans des dalles calcaires et simulant des empreintes de carnassiers ont peut-être une fonction symbolique issue du figuratif et orientée vers une abstraction purement géométrique. Les quelques grottes gravettiennes connues n'offrent pas davantage de signes, alors que les thèmes animaliers et, sans doute, les mains négatives y sont bien représentés : des traits rectilignes non organisés dans des panneaux de Pairnon-Pair, de Gargas sont des témoins graphiques trop frustes pour être retenus. Des traits gravés élémentaires, des signes ponctués peints sont bien attestés dans certaines grottes rhodaniennes attribuées au Solutréen ( Chabot, Tête du Lion) ; ils forment un corpus encore réduit de représentations abstraites, complètement absentes des dispositifs pariétaux solutréens en abri.
La variété et la quantité des signes pariétaux magdaléniens permettent de distinguer au moins trois familles de types : les signes élémentaires ponctués, les signes élémentaires linéaires et les signes géométriques élaborés. Le type point et ses dérivés que sont les alignements simples ou doubles, les nappes, etc. sont peints – il est peu commode en effet de graver un point –, généralement en rouge dans les grottes des Pyrénées, des Cantabres et, plus modérément, au Périgord ; ils sont plus souvent placés dans des galeries servant de passage que dans des salles concentrant des représentations animales. Les types linéaires simples (tiret, bâtonnet, barre) et leurs dérivés (paire, alignement, groupement, etc.) sont aussi abondants et omniprésents que les signes ponctués ; peints – plutôt en noir – ou gravés, ils intéressent autant les salles que les galeries et sont fréquemment liés aux animaux.
Les signes élaborés n'ont ni la fréquence ni la distribution des signes élémentaires. Les types les mieux définis appartiennent à une seule région, voire à quelques grottes réalisées simultanément dans une phase culturelle sans nul doute brève : Cougnac (Dordogne) et Pech-Merle sont, par exemple, les seules grottes à posséder de grands signes rectangulaires étroits à appendices externes, absolument identiques et symboliquement placés à proximité de figurations humaines. Il arrive aussi fréquemment que des dispositifs pariétaux intègrent, en un nombre limité d'exemplaires ou même en un unique exemplaire, un ou plusieurs types de signes qui leur sont propres : grands signes rouges du Portel (Ariège), naviforme rouge de Font-de-Gaume, etc.
Les théories interprétatives développées jusqu'à ces dernières années en considérant l'art paléolithique dans la totalité de son extension et de sa durée ont présupposé qu'il était homogène dans ses significations : il suffit pourtant de considérer simplement l'extrême discrétion des signes au cours du Solutréen, leur absence auparavant, leur abondance pendant le Magdalénien, pour concevoir clairement que l'on ne peut mettre en équivalence symbolique les dispositifs pariétaux, très construits, du Magdalénien avec ceux, réduits, du Gravettien ou ceux, particuliers, du Solutréen. De même, la diversification typologique régionale et locale de signes élaborés magdaléniens atteste de telles expressions symboliques différentes et particulières, qu'il n'est plus envisageable d'adopter un seul système explicatif. Les études détaillées des grottes, conduites ces dernières années avec des moyens d'observation et d'enregistrement très supérieurs à ce qu'ils étaient, mettent en évidence la parfaite originalité de la construction symbolique de chaque dispositif pariétal, même lorsqu'il s'agit de dispositifs (au sein d'une même grotte ou appartenant à plusieurs grottes) possédant une majorité de thèmes figuratifs et abstraits semblables ; l'exemple des quatre grottes à tectiformes du Périgord est particulièrement net sur ce point : à Bernifal, le panneau central est situé dans le passage le plus étroit de la cavité, à mi-chemin du parcours : il est gravé de quatre ou cinq mammouths, placés au centre et surchargés d'autant de tectiformes ; à la périphérie : un bison, un renne avec tectiforme juxtaposé et, en marge supérieure, un signe ovoïde, identique à ceux qui sont gravés sur la paroi opposée, et associés à d'autres tectiformes, et un signe en grille. Aux Combarelles comme à Rouffignac, les quelques tectiformes représentés sont placés plutôt à l'écart des animaux : plus de cent vingt chevaux aux Combarelles, disposés tout au long de la galerie auxquels s'associent sporadiquement quelques dizaines de rennes, mammouths, bisons, bouquetins, cerfs, lions et rhinocéros et une quarantaine de profils féminins schématisés et discrets. Rouffignac est célèbre pour ses quelque cent cinquante mammouths qui dominent partout les assemblages où l'on retrouve chevaux, bisons, bouquetins et même des rhinocéros laineux. Dans des panneaux superbement composés et des files majestueuses, Font-de-Gaume offre aussi tous ces thèmes animaux : bisons en premier, toujours mis en valeur par les peintres, puis chevaux, mammouths, rennes, caprinés, félins et même un rhinocéros dans son étroit diverticule final. Des centaines de signes gravés ou peints se mêlent à ce bestiaire, dont une bonne vingtaine de signes tectiformes. Ceux-ci se trouvent associés au cheval, dans un panneau gravé de la galerie d'accès, plusieurs fois aux bisons, dans la galerie principale, et sont alors peints en rouge, ou encore isolés, dans les galeries latérale et terminale. On constate que, dans ces quatre dispositifs pariétaux magdaléniens, les mêmes grands thèmes figuratifs et abstraits ont été choisis mais ils furent différemment placés et reliés entre eux pour privilégier, notamment, des couples mammouth-tectiforme au centre de Bernifal, bison-tectiforme au centre de Font-de-Gaume, cheval-autre animal aux Combarelles, mammouth-autre animal à Rouffignac. En d'autres termes, les thèmes sont en partie communs, mais chaque dispositif pariétal est original ; chacun reflète la symbolique propre du groupe qui l'a créé, tout en participant de la culture à laquelle il appartient. C'est en considérant cette double propriété de chaque grotte d'être à la fois originale et paléolithique qu'on s'oriente vers une meilleure compréhension des significations à travers leurs manifestations symboliques, c'est-à-dire les représentations et leurs distributions sur les parois souterraines. D'un sanctuaire à un autre, les significations varient au gré des choix et des liaisons thématiques ; elles se profilent sur l'horizon de l'univers paléolithique et s'en détachent pour créer des cosmogonies nouvelles où se rencontrent symboliquement les animaux et les hommes.
La limite chronologique indiquant la fin des arts postglaciaires, qui devrait être marquée par l'irruption de l'écriture, est parfois assez floue, en raison de la nature de certaines de leurs manifestations, en particulier des graffiti rupestres parmi lesquels il est souvent malaisé de faire la distinction entre les tracés protohistoriques et ceux qui appartiennent à la période historique.
Les arts mésolithiques ont leur originalité propre et montrent une relative unité ; si l'on place dans le Mésolithique les cultures qui ne sont plus vraiment paléolithiques et pas encore nettement néolithiques, les arts de cette période s'étendent donc sur huit mille ans, des environs de — 11000 à ceux de — 3000.
Ces tracés, qui existaient dans l'art de l'Âge du renne, se développent parfois avec une grande complexité ; dans la grotte du Thaï (Drôme), associée à une industrie de type azilien (vers — 10800), une côte porte des incisions parallèles barrées interprétées par A. Marschack comme étant un système de notation (calendrier ?). Un peu avant — 10000, dans les Landes et les Pyrénées, commence à se développer l'art dit « azilien » ; la couche 4 de l'abri Dufaure à Sordes l'Abbaye, où une industrie de type azilien est encore associée au renne (Dryas II ou tout début d'Alleröd), a livré en effet deux galets gravés de motifs simples. Le gisement éponyme de l'art azilien est la grotte du Mas d'Azil (Ariège) où, dans les couches datant de l'Alleröd et du Dryas III, un millier de galets ornés ont été découverts ; ce sont des galets oblongs, longs de 40 à 70 mm, larges de 20 à 30 mm et épais de 6 à 9 mm, portant des barres, des points de peinture rouge, des incisions peu profondes pouvant se combiner en associations variées et complexes. Il en a été trouvé dans trente-sept gisements qui montrent, du XIe au VIIIe millénaire, une unité artistique réelle dans le choix des supports et la conception des œuvres, depuis l'Espagne cantabrique jusqu'au nord de la Suisse ; ils se situent dans le même courant interculturel d'azilianisation qui se manifeste dans des industries d'origines différentes.
Le Mésolithique provençal semble évoluer en dehors de ce courant ; les niveaux montadiens de l'abri Cornille (Istres, Bouches-du-Rhône), VIIIe millénaire, contiennent de l'ocre et un galet ocré ; à la Montade et à Ventabren (Bouches-du-Rhône), des galets sont gravés de cercles réguliers.
Dans une couche castelnovienne (vers — 5000), une grosse pierre verte peinte en rouge reposait sur une sépulture ; à Châteauneuf-lès-Martigues (Bouches-du-Rhône), la paroi de l'abri a probablement été peinte en rouge par les premiers occupants castelnoviens ; ceux-ci ont abandonné un petit fragment (2 cm de long) d'os calciné portant un décor géométrique en zigzag et un galet de schiste gravé sur les deux faces de motifs géométriques triangulaires, planté verticalement dans le sol comme ceux de Montclus. Dans le Bassin parisien, il existe de rares abris gréseux ornés au Tardenoisien (Ve-IVe millénaire) ; J. Hinout y a découvert dans les sols d'habitat, au pied des parois décorées, les outils émoussés en grès ou en silex qui ont servi à graver des grilles et des sillons et l'ocre avec laquelle ont été peintes des rangées d'ovales ; le mobilier comporte parfois des plaquettes lithiques gravées ou portant des taches d'ocre.
Des fragments d'ocre gros comme des pois ont été trouvés dans tous les niveaux de l'abri de Birsmatten (canton de Berne, Suisse), mais plus particulièrement dans ceux du Boréal (vers — 6000), où ce colorant enduit des pierres et des galets plats ; un fragment de côte décoré sur les deux faces d'un quadrillage incisé provient des niveaux du Mésolithique final (— 4000 ?). Dans les gisements du Mésolithique final breton de Téviec et de Hoëdic datés de 4600 avant J.-C., quatre stylets en os, déposés dans des sépultures, sont ornés de courtes incisions parallèles, se répétant rythmiquement par groupes de trois ou quatre ; deux autres objets funéraires en os portent des hachures croisées. À Volkerak (Pays-Bas), à l'entrée du Hollandsch Diep, une petite statuette anthropomorphe en bois, découverte dans la tourbe en dehors de tout contexte archéologique, a été datée de — 4500 ; elle est vraisemblablement mésolithique.
Pendant la culture de Kongemose qui lui fait suite (entre — 5600 et — 5000), l'art s'exprime également sous forme de décors géométriques de points et d'incisions associés en compositions complexes et par quelques œuvres figuratives : rares représentations humaines et animales schématiques ; les supports de ces décors sont, comme au Maglemosien, les pendeloques en ambre et les poignards en os à rainures, auxquels s'ajoutent les haches en bois de cerf ; le célèbre petit ours en ambre du Jutland (musée de Copenhague) porte un décor complexe typique de cette culture.
L'art de l' Ertebolle (entre — 4600 et — 3200) ne marque pas de rupture avec celui de Maglemose et de Kongemose ; il consiste en décors géométriques pointillés formés de lignes de petits trous très régulièrement creusés à l'aide d'une drille. Une pagaie de bois découverte à Tybring Vig (Danemark) est décorée d'incisions linéaires symétriques remplies d'une matière brune qui n'est pas encore identifiée, selon une technique jusqu'alors inconnue. Vers 3600 avant J.-C., le décor disparaît des objets d'os et de bois de cervidé.
Un courant interculturel comparable à celui de l'Azilien confère une unité certaine à l'art des diverses cultures des pays baignés par la Baltique ; il fut naguère qualifié abusivement d'« art maglemosien ». Au nord de la Russie d'Europe, l'industrie en os de la culture Kunda (entre — 7600 et — 3000) est souvent ornée de fins décors géométriques ou zoomorphes (tête d'élan d'Oleni Ostrov) qui évoquent l'art maglemosien. Certains des objets en bois du gisement de Vis 1 (dans la région du lac Sindor, à l'est d'Arkhangelsk, Russie ; vers — 6000), appartenant également à la culture Kunda, portent des ornements géométriques formés de lignes de points ; une tête d'élan, sculptée sur un ski, la plus vieille sculpture en bois connue, constitue le thème central d'un répertoire iconographique qui s'étend de la Norvège à l'Oural.
La plupart des abris sont situés entre 800 et 1 000 mètres d'altitude sur des versants montagneux et des canyons facilement accessibles et généralement proches du littoral méditerranéen (à moins d'une cinquantaine de kilomètres) ; les circulations des hommes préhistoriques furent donc toujours aisées dans ces régions. À l'exception d'abris gréseux rougeâtres près d'Albarracín, les abris choisis par les peintres s'ouvrent dans des roches calcaires en falaise. Ils sont petits et peu profonds, quelques mètres, sauf l'ensemble remarquable du Barranco de Gasulla (Castellón), qui sur plusieurs dizaines de mètres rassemble de 600 à 700 représentations. Peu de traces d'habitats ont été trouvées dans ces abris qui ne se prêtaient guère à des occupations prolongées et qui ont souffert de leur exposition aux intempéries. Les pigments des tracés furent altérés par les alternances d'ensoleillement et d'humidité et par les desquamations des parois.
Plusieurs milliers de représentations ont été peintes ou dessinées en rouge, brun, noir, exceptionnellement en blanc, tels les superbes bœufs de l'abri de Los Toricos (Teruel). Il n'existe pratiquement pas de gravures. La thématique est essentiellement figurative : des animaux présents dans tous les sites mais un peu moins nombreux que les humains. Cerfs et biches, caprinés, bouquetins et chèvres, comptent pour plus de la moitié des animaux. Les bovinés ne sont pas rares (environ 10 p. 100) souvent groupés mais sans signe figuré attestant leur domestication ; les autres animaux furent sporadiquement figurés et en faible quantité ; ce sont des chevaux et des ânes, des chiens et des loups, des sangliers fuyant des chasseurs, des oiseaux, exceptionnellement des poissons ; mais on remarque surtout des dessins succinctement figuratifs d'arthropodes telles des abeilles placées dans des scènes de collecte de miel. Deux grands modes d'expression caractérisent les figures animales : d'un côté, les animaux les plus grands (jusqu'à un mètre), naturalistes et hiératiques, disposés sans référence spatiale explicite, sont à peu près exclusivement des cerfs (Olivanas) et des bœufs ; de l'autre, les animaux petits, dessinés en quelques traits, sont agités de mouvements et participent à des scènes très vivantes. Les représentations humaines sont aussi différenciées ; certains personnages-fourmis sont miniaturisés (moins de 5 cm) et schématisés à l'extrême ; d'autres silhouettes sont longilignes et gracieuses : femmes à la taille fine, vêtues de longues jupes en cloche ; elles sont parfois accompagnées d'archers au corps élancé portant des coiffes emplumées. Cependant, l'archétype des représentations humaines du Levant est le petit archer, chasseur ou guerrier, muni de son arc, de flèches. À l'arrêt ou courant, isolé ou en file, il est partout, héros vainqueur, chasseur comblé. Les représentations humaines, vêtues, parées, armées... souvent placées en situation de danse, de guerre, de collecte fourmillent d'indications sur les changements sociaux et économiques qui caractérisent le Mésolithique, le Néolithique puis l'Âge des métaux. De grandes incertitudes demeurent pour dater correctement l'art du Levant. Toutefois, la série des animaux « naturalistes » dans laquelle n'intervient pas l'homme paraît antérieure à la néolithisation qui devient sensible ensuite dans les scènes, les habits, la domestication (chiens, chevaux) et même des travaux agricoles ; entre le IXe et le Ve millénaire doit donc se situer une première partie de l'art du Levant ; la seconde, d'abord néolithique, s'achève dans le processus généralisé de schématisation graphique qui gagna toute la péninsule Ibérique et provoqua l'avènement de l'écriture à l'aube de l'Histoire.
Il n'est pas possible de citer toutes les contributions de voyageurs et de chercheurs, amateurs ou professionnels, qui ont fait connaître des documents rupestres provenant de l'ensemble du Sahara, car elles sont très nombreuses, et d'inégale importance. Cependant, il importe de rappeler que la découverte des peintures du Tassili-n-Ajjer revient au capitaine Cortier, qui les signala pour la première fois en 1909. Ces peintures furent ensuite documentées par le lieutenant Brenans, dont les carnets de terrain furent publiés par l'abbé Breuil en 1954, dans un article qui décida un jeune zoologiste, Henri Lhote, à consacrer sa vie à l'étude des arts rupestres du Sahara. À partir de 1956, celui-ci releva de nombreuses fresques au cours de ses expéditions au Tassili-n-Ajjer, puis organisa à Paris, dès 1957, une exposition sur les « Peintures préhistoriques du Sahara » (musée des Arts décoratifs).
Les peintures photographiées et relevées au cours des missions confiées de 1946 à 1949 à Yolande Tschudi par le musée d'Ethnographie de Neuchâtel, avaient été publiées en 1956 dans un ouvrage intitulé Les Peintures rupestres du Tassili-n-Ajjer. Mais cet ouvrage fut éclipsé par le récit qu'Henri Lhote fit de ses propres recherches en 1958, À la découverte des fresques du Tassili, bientôt traduit en plus de dix langues, et qui familiarisera le grand public avec l'art rupestre de cette région. Pour Henri Lhote, ce livre marquera aussi le début d'une longue carrière essentiellement consacrée à l'art rupestre saharien, avec la production de plusieurs centaines de publications. Cependant, les croquis qu'il publia ne sont pas toujours très fiables, ce qui conduisit Jean-Dominique Lajoux, l'un de ses anciens collaborateurs, à retourner sur le terrain pour y réaliser de remarquables photographies.
Les premières gravures rupestres sahariennes furent découvertes en 1850 à Tilizzaghen au Messak (Fezzan, Libye) par l'explorateur Heinrich Barth, alors en route vers Tombouctou. À son retour, il ne présenta que trois gravures dans le récit de son voyage, gravures qui ne soulevèrent guère d'intérêt avant 1932, date à laquelle l'anthropologue et préhistorien Leo Frobenius décida de consacrer une expédition à l'étude de ces œuvres. Un riche répertoire iconographique fut alors découvert, dont l'inventaire se poursuit encore de nos jours. En 1948, Roger Frison-Roche photographia les gravures de l'Adrar Iktebīn, dans la même région, y trouvant l'inspiration d'un récit romancé : La Montagne aux écritures. Les recherches se développèrent à la fin des années 1960, quand deux missions italiennes conduites par Paolo Graziosi, permirent à ce dernier de faire de nouvelles explorations au Messak. Dans cette zone, les découvertes étonnantes se sont multipliées ces dernières années, particulièrement grâce aux minutieuses prospections de Gérard Jacquet, Jan Jelínek, Giancarlo Negro, et enfin Rüdiger et Gabriele Lutz. Mais c'est surtout depuis 1990, date à laquelle Axel et Anne-Michèle van Albada ont fait connaître les premiers résultats de leurs recherches, que nos connaissances ont évolué de façon décisive, notamment en ce qui concerne les personnages masqués, les cynocéphales mythiques, les scènes de sacrifice et de partage d'antilope, etc.
Autre province rupestre importante, l'Akākūs, située dans l'extrême sud-ouest de la Libye entre le Messak et le Tassili, recèle des gravures et des peintures, mais ce sont surtout ces dernières qui ont attiré l'attention des chercheurs.
Le Tassili-n-Ajjer, lui aussi, est surtout connu pour ses peintures, les publications d'Henri Lhote ayant rendu célèbres celles de localités comme Séfar, Jabbaren ou Iheren, mais de nombreux ensembles restent encore à découvrir ou à publier. Parmi les études importantes pour cette région, il convient de citer les travaux de Ginette Aumassip sur le site de Ti-n-Hanakaten, et ceux d'Alfred Muzzolini, Aldo Bocazzi et Augustin Holl sur celui de Tikadiouine.
Le Tassili-n-Ajjer est également riche en gravures, l'oued Djerāt, découvert par le lieutenant Brenans en 1932, constituant à cet égard un site capital, presque aussi important, par le nombre et la qualité des œuvres, que les vallées du Messak libyen.
D'autres sites à gravures, signalés au Sahara central, ont été partiellement inventoriés, mais l'intérêt du livre que Théodore Monod a consacré à l'Ahnet dépasse largement celui des gravures qui y sont décrites, dans la mesure où les conceptions chronologiques qui y étaient développées dès 1932 connurent une très longue postérité. Elles influent toujours d'ailleurs sur les cadres de pensée des chercheurs qui travaillent actuellement sur l'ensemble du Sahara (cf. infra, Classification et datation).
Dans l'Ahaggar (Hoggar), depuis l'ouvrage rédigé en 1938 par F. de Chasseloup-Laubat à l'issue de l'expédition alpine française du Haut-Mertutek, l'essentiel de nos connaissances est dû aux minutieuses prospections et aux magnifiques monographies de Franz Trost sur l'Ahaggar central, publiées en 1981 et 1997.
Depuis les découvertes de Marc Milburn dans le nord-ouest de l'Aïr en 1976-1977, de Jean-Pierre Roset dans l'Aïr septentrional en 1971, et de Gérard Quéchon et Jean-Pierre Roset dans le massif de Termit en 1974, les figurations rupestres de la partie méridionale du Sahara sont beaucoup mieux connues, surtout grâce aux importants corpus réalisés en 1979 et 1987 par Henri Lhote pour l'Aïr, et en 1991 par Christian Dupuy pour l'adrar des Ifoghas (Iforas). Dans leur immense majorité, ces gravures appartiennent à l'école dite du « guerrier libyen », nom donné aux innombrables représentations de personnages géométriques stéréotypés qui couvrent les rochers de ces régions.
Par sa thématique et son style, le monde des gravures de l'Atlas saharien est souvent proche de celui du Sahara central, mais la plupart des ensembles connus n'ont été que très partiellement décrits et, depuis soixante ans, on publie régulièrement les photographies des mêmes œuvres. Depuis 1990, des sites de peintures ont été découverts en Tunisie, notamment dans la région de Ghoumrassen, attirant l'attention sur une zone jusqu'alors absente des cartes de répartition des arts rupestres sahariens. Du point de vue de l'art rupestre, le Haut Atlas marocain, le Rio de Oro et l'Adrar mauritanien semblent appartenir à un autre monde que les ensembles du Sahara septentrional et central. Au Maroc et au Rio de Oro, on remarque en particulier des gravures de poignards, de haches nervurées (dites « hallebardes ») et d'un type particulier de haches à manche coudé (dites haches peltes), qui ne se retrouvent nulle part ailleurs au Sahara, et qui signalent une période récente, où le façonnage du métal était évidemment acquis. De l'Adrar de Mauritanie et de l'Aouker, on retiendra surtout la présence de nombreuses gravures de chars schématiques souvent attelés à des bœufs, ce qui reste rare dans les autres provinces rupestres.
Dans le désert Libyque oriental, les gravures du Karkūr et-Talh ont été signalées en 1923 par Hassanan Bey alors que, de 1924 à 1926, le prince Kémāl ed-Dīn poursuivait le relevé de celles d'Awenāt. En 1933, un archéologue italien, di Caporiacco, découvrait les peintures d'Aïn Dūwa alors que, la même année, Hans Rhotert entreprenait la première étude générale de l'art rupestre de l'ensemble de la région, dans une monographie qui ne fut éditée qu'en 1952. De nombreuses peintures et gravures inédites du Karkūr et-Talh seront signalées en 1936 par le célèbre aventurier hongrois Lazlo de Almazy (héros du film Le patient anglais), et leur inventaire systématique sera entrepris par Hans Winkler deux ans plus tard. Enfin, une expédition belge dirigée par Francis Van Noten repérera de nombreuses peintures et gravures dans les vallées de la région d'Awenāt et du Gilf Kebīr, moisson qui se concrétisera en 1978 par la publication d'une synthèse magnifiquement illustrée. Hormis un énigmatique panneau de peintures représentant des Têtes rondes à Bū Hlēga dans le Karkur Drīs, les figurations observées à Awenāt représentent surtout des bovins, des chèvres et des personnages souvent comparables aux peintures du massif de l'Ennedi (nord-est du Tchad), avec lequel des relations devaient exister aux alentours du IIe millénaire avant J.-C.
La plupart des sites anciennement signalés dans l'Ennedi par D'Alverny, Gérard Bailloud et Paul Huard ont été revus en 1996-1997 par Adriana et Sergio Scarpa Falce, Jacques et Brigitte Choppy, Aldo et Donatella Bocazzi. À part quelques peintures qui évoquent les Têtes rondes du Tassili, l'ensemble ne peut guère être antérieur au IIe millénaire avant J.-C.
Le Djado a fait l'objet de recherches approfondies de la part de Karl Heinz Striedter et Michel Tauveron, alors que le Tibesti est désormais bien connu grâce à une publication collective dirigée par Giancarlo Negro, Roberta Simonis et Adriana Ravenna. Dans ces deux zones, il existe des gravures apparemment anciennes, qui pourraient correspondre à une extension méridionale extrême du style bubalin. Dans leur grande majorité, les peintures et gravures du massif sont pastorales au sens large, leur phase la plus ancienne étant représentée par le style dit de Karnasahi où abondent les archers en mouvement à tête zoomorphe.
Les découvertes se multipliant, il devenait indispensable d'introduire un ordre dans la masse grandissante des documents – bientôt connus par dizaines de milliers sur l'ensemble de l'hémi-continent – et l'on convint de les classer par périodes. Mais si les œuvres tassiliennes sont généralement les plus connues, et si leur étude a permis l'établissement de plusieurs systèmes chronologiques, il faut rappeler que la toute première classification des gravures fut proposée au milieu du xixe siècle par Heinrich Barth, qui distinguait les figurations « à grands animaux » des gravures « très mal et très négligemment tracées ». Cette distinction fut ultérieurement reprise par le géographe Émile Félix Gautier, lequel écrira dans la première décennie du xxe siècle : « Tout ce qui n'est pas belle gravure ancienne [...] est immonde graffiti libyco-berbère ». Ainsi, dès les premières tentatives de classification, apparaissait la regrettable intrusion de critères artistiques imputables au goût des classificateurs, et dont l'archéologie et l'histoire de l'art n'ont pas encore réussi à se dégager totalement.
Dès les premières découvertes, on avait remarqué que plusieurs époques étaient concernées, puisque certains des « graffiti » représentaient des dromadaires – d'introduction récente au Sahara – tandis que d'autres montraient des espèces disparues de la région (comme l'hippopotame, l'éléphant, la girafe ou le rhinocéros) voire définitivement éteintes (comme le grand buffle antique). L'habitude de classer les gravures rupestres en fonction des espèces animales représentées s'imposa donc et, à la suite de Théodore Monod, on considéra certaines figurations animales comme des sortes de fossiles directeurs. Les périodes les plus récentes, caractérisées par la présence de dromadaires et de chevaux, furent dites « cameline » et « caballine », tandis que les images représentant des bœufs domestiques étaient dites « pastorales » ou « bovidiennes », alors que la catégorie du « bubalin », considérée comme la plus ancienne, se fondait sur les figurations d'une espèce disparue de buffle géant, dite « grand bubale ».
Les premiers spécialistes de l'art rupestre, formés à l'école des anthropologues du xixe siècle et du début du xxe siècle, crurent alors découvrir, dans les œuvres qu'ils étudiaient, les témoignages du passage d'une culture de chasseurs à une civilisation de pasteurs. Aux premiers furent attribuées les gravures du « bubalin », et aux seconds les œuvres dites « pastorales », notamment les innombrables peintures de bovins domestiques. Ainsi, les premières observations de Lhote au Djerāt lui firent-elles « admettre l'existence, au Sahara central, d'un groupe archaïque néolithique où la faune est exclusivement éthiopienne ». À l'occasion de l'exposition parisienne des relevés qu'il avait effectués au cours de ses missions, il affirma que les gravures de la période dite par lui « des chasseurs » ou « du bubale » devaient être situées entre 6000 à 8000 ans avant J.-C. », alors que celles des « Pasteurs à bovidés » auraient débuté au Ve millénaire. Mais, reprenant le dossier du Djerāt plusieurs années après ses premiers séjours au Tassili, il reconnut qu'il y avait lieu « de revenir sur la conception qui n'admettait pas le bœuf (domestique ?) dans le groupe des gravures de style naturaliste, défini parfois sous le nom de groupe des chasseurs ou du bubale ou du bubalin ».
La périodisation des figurations anciennes en productions d'abord « bubalines » ou « des chasseurs » puis « pastorales », ne fut donc qu'une simple hypothèse construite à partir de quelques cas jugés exemplaires, et choisis sur une poignée de sites de l'Atlas, du Tassili et du Fezzān. Cette proposition fut progressivement figée en une théorie abusivement élargie à l'ensemble du Sahara, du Sud marocain et du Rio de Oro à l'Algérois et au Constantinois, de l'Ahaggar et du Tassili au Fezzān, voire jusque dans la vallée du Nil. Partout, les voyageurs trouvaient de nouveaux sites rupestres dont les productions graphiques étaient aussitôt attribuées, selon leur sujet, soit aux « chasseurs », soit aux « pasteurs ». Mais caractériser une « période des chasseurs » par l'absence totale de représentations d'animaux domestiques, ainsi qu'on le faisait alors (et comme on le fait encore trop souvent), expose au risque d'effectuer le raisonnement circulaire suivant :
1. L'art des « chasseurs » (ou du « bubalin ») est défini comme figurant essentiellement des animaux sauvages, et celui des « pasteurs » comme figurant surtout des animaux domestiques ;
2. Par conséquent, lors de l'étude des sites, faune sauvage et animaux d'apparence domestique sont traités séparément, de façon à constituer deux ensembles thématiques ;
3. Sans autre argument, ces deux ensembles – construits de toutes pièces par les chercheurs – sont alors considérés comme appartenant bien à deux entités culturelles différentes et successives.
On a parfois repoussé au-delà du Néolithique l'âge des gravures « bubalines » supposées appartenir à un monde de chasseurs paléolithiques. De nos jours encore, certains leur attribuent volontiers 10 000 ans d'ancienneté, voire 20 000 ans ou plus. Depuis les années 1970, les prises de position se sont succédé à propos des différents « étages » de l'art rupestre du Sahara et de leur âge, mais les chronologies qui en résultent sont fragilisées par nombre de défauts méthodologiques, dont les plus fréquents sont : l'attribution de gravures à des groupes stylistiques définis sur des peintures (ou l'inverse), l'absence de définition précise des styles, l'association systématique d'un style et d'un « étage », la définition a priori de chaque grande période par la présence d'un seul animal caractéristique, l'interprétation des différences de patine en termes de « quelques millénaires » supposés s'écouler entre chaque phase, l'attribution systématique et non étayée de tout « bubale » à une « période bubaline » et enfin l'amalgame entre les notions de style, d'époque et d'ethnie.
Par la sédimentologie. Des observations conduites dans la Tadrart algérienne concernent des gravures rupestres partiellement recouvertes par des sédiments holocènes, ce qui a permis d'intéressantes tentatives de datation. En effet, deux niveaux de terrasses ont été reconnus dans cette vallée : c'est le niveau le plus ancien qui se trouve au contact des gravures, alors que le plus récent résulte d'écoulements ayant entamé et déplacé des dépôts antérieurs. L'intensité des écoulements reconnus dans le niveau récent permet de supposer que sa formation précéda l'Aride généralisé dans l'ensemble du Sahara à partir de 4000-3500 B.P. L'autre niveau est donc plus ancien, mais toute la question est de savoir dans quelle mesure. On a proposé de le mettre en relation avec une accumulation de matériels détritiques antérieure à 7500 B.P. Si cette estimation était confirmée, il en résulterait que les gravures de bovinés en partie sous-jacentes à cette terrasse auraient forcément été réalisées avant cette date. En outre, comme le trait incisé des pattes de ces bovins fut repris par piquetage à une époque inconnue, mais également antérieure au dépôt de terrasse, il a été supposé que le trait original aurait été exécuté avant le premier Humide holocène, c'est-à-dire au Pléistocène final. Mais même si la date de 7500 B.P. était confirmée pour la formation de la terrasse ancienne, il resterait à mesurer l'intervalle entre la date de la reprise piquetée et celle des œuvres incisées originales. Et même en supposant que la reprise visait à restaurer l'œuvre originale en partie effacée, on resterait dans l'incapacité de délimiter avec certitude le laps de temps nécessaire à cet effacement. Ce temps pourrait se mesurer en millénaires, mais tout aussi bien en siècles ou en décennies, car il n'est aucunement prouvé que l'érosion des gravures nécessite toujours l'action de plusieurs millénaires, de périodes entières de la succession des « Arides » et des « Humides ». En fonction de la localisation des œuvres, très peu de temps pourrait y suffire, lors d'un épisode de corrasion (érosion éolienne) court mais intense, et il faut redire qu'il n'existe actuellement aucun moyen de reconnaître la durée d'un processus d'érosion à partir de son action sur un trait gravé, une action importante ne correspondant pas forcément à une longue durée du processus.
Par le carbone 14. Afin d'employer les techniques de datation utilisant la spectrométrie de masse par accélérateur pour dater des peintures en n'utilisant qu'une très petite quantité de matière, il faut disposer d'échantillons contenant des matières organiques, ce qui est rare au Sahara. Une date de 6145 ± 70 ans B.P. a été obtenue sur une peinture peut-être bovidienne de l'abri Lancusi dans l'Akākūs (sud-ouest du Sahara libyen), et l'on peut supposer que de nouveaux résultats seront bientôt disponibles sur d'autres sites.
Les chronologies traditionnelles des arts rupestres sahariens illustrent donc un état ancien des études anthropologiques, popularisé à la fin du xixe siècle par Lewis Henry Morgan, présupposant un progrès linéaire de l'humanité par complexification progressive des cultures et impliquant l'existence d'un ordre immanent dans la succession des phénomènes économiques et culturels. Ces chronologies, qui se plaisent à reconnaître parmi les gravures rupestres sahariennes des témoignages de la succession : « chasseurs », puis « pasteurs », prolongent aussi la thèse du père Wilhelm Schmidt qui, en 1926, affirmait dans Der Ursprung der Gottesidee, qu'il faut distinguer Urkultur (culture des chasseurs nomades) et Primärkultur (culture des pasteurs), la seconde succédant nécessairement à la première. Le postulat évolutionniste sous-jacent transparaît clairement dans le vocabulaire utilisé pour le Sahara. En effet, des chasseurs tardifs (Late Hunters) y succèdent régulièrement aux chasseurs précoces (Early Hunters), on évoque volontiers la « diminution de la qualité artistique », ou bien l'on commente l'évolution d'un « style des chasseurs » allant du « décoratif » au « simplifié » en passant par le « classique » quand certaines œuvres ou périodes ne sont pas qualifiées de « décadentes », voire de « grossières » et de « primitives », tandis que le « subnaturalisme » y succède forcément au « naturalisme ». Pourtant, contre le préjugé d'un évolutionnisme culturel linéaire et universel, se sont d'abord élevées les voix d'Eduard Hahn, de Franz Boas et de Robert Lowie, puis celles de Bronislaw Malinowski, Wilhelm Koppers et Alfred Reginald Radcliffe-Brown, pour ne citer que les auteurs les plus connus. De nos jours, les anthropologues ont donc très généralement abandonné la théorie selon laquelle les sociétés passeraient nécessairement par des phases historiques liées aux ressources alimentaires, techniques et intellectuelles mises en œuvre pour répondre aux pressions de l'environnement. Il est désormais admis qu'il s'agissait d'une idée reçue, largement controuvée par les observations ethnologiques et qui, sur le terrain, a souvent conduit à ne prendre en compte que les singularités culturelles jugées susceptibles d'indiquer des écarts historiques. C'est ainsi que, dans l'étude des arts rupestres du Sahara, ce présupposé conduit à ne s'intéresser aux figurations de bovinés que dans la mesure où elles pourraient livrer des indices de domestication, ou bien à ne relever les représentations de la grande faune sauvage et les scènes cynégétiques (ou supposées telles) que parce qu'elles révéleraient la présence de « chasseurs ».
Les styles de gravures. Dans l'attente de l'application généralisée d'un ou plusieurs procédés objectifs de datation absolue des images rupestres, les seuls arguments valides pour l'instant sont d'ordre stylistique et culturel. Du point de vue stylistique, on distingue trois grandes « écoles » de gravures : le « Bubalin », l'école dite « de Tazina » et celle dite du « guerrier libyen.
Le Bubalin. La plupart des auteurs ont affirmé jusqu'à présent que les gravures « bubalines » ou des « chasseurs » seraient d'un autre style que les œuvres proprement pastorales, mais des recherches précises, portant sur plusieurs milliers de figurations, font rejeter cette assertion.
Si l'on s'en tient à l'étude des seuls témoignages graphiques que nous ont laissés les anciens habitants du Sahara, il est impossible d'en déduire l'existence d'une « culture des chasseurs » qui aurait laissé place à des pasteurs. La fréquence des animaux sauvages représentés dans l'art bubalin a souvent été surévaluée, de même que celle des scènes de chasse véritable. En outre, la présence de ce type d'image n'implique aucunement qu'elles soient le fait d'une société de « chasseurs ». Le grand buffle antique traditionnellement dénommé « bubale » ne peut caractériser un « Bubalin » très ancien puisqu'il est désormais attesté qu'en plusieurs points du Sahara, il a vécu très tardivement, au moins jusque vers 4000 B.P. S'il est parfaitement exact qu'il fut chassé et consommé par certains Néolithiques du Sahara, on constate que l'appellation de « bubalin » a été utilisée, surtout dans l'Atlas saharien et au Sahara central, pour définir des ensembles rupestres où cet animal n'est pas toujours présent, et que ce dernier a disparu longtemps après la fin de la phase qu'il est supposé caractériser. Ce terme de « bubalin » ne saurait donc être conservé que comme une étiquette commode pour désigner le style des gravures sur lesquelles le grand buffle antique apparaît le plus souvent, mais en aucun cas pour qualifier un étage particulier.
Les gravures de ce style, souvent détaillées, sont essentiellement « naturalistes » et comportent des représentations de la grande faune sauvage (éléphants, rhinocéros, hippopotames, girafes) dont certains représentants ont disparu beaucoup plus tard qu'on ne le pensait il y a une vingtaine d'années (des ossements d'hippopotames abondent par exemple dans les restes de cuisine du Ténéréen, vers 3500-2000 avant notre ère). Mais la présence de bovins et d'ovins domestiques y est également bien attestée, ainsi que le prouvent les bœufs richement parés, tenus en longe, ornés de pendeloques à décor géométrique maintenues par un collier, et portant des selles décorées munies d'un pommeau en « V » sculpté, connus dans l'art bubalin du Messak libyen, pourtant considéré comme un des « foyers » de la « culture des chasseurs ». Aucun animal indéniablement domestique n'étant connu au Sahara avant le Ve millénaire avant J.-C., les peintures ou gravures qui en représentent ne peuvent être antérieures, à moins de supposer l'existence, en plein Sahara central, d'une zone de primo-domestication plus ancienne. Placer ces œuvres dans le Ve millénaire avant J.-C. les fait concorder parfaitement avec les estimations signalées plus haut à partir de l'étude des états de patine.
Comme, par ailleurs, aucun des critères de superpositions, style ou technique ne permet de dissocier objectivement les images d'animaux domestiques et les représentations de la grande faune sauvage, il faut bien admettre que l'art gravé de style (et non d'âge) bubalin ne correspond pas à la production artistique de prétendus « chasseurs », mais constitue bien l'œuvre gravé d'un seul et unique groupe culturel qui, il y a environ 6500 ans, avait élaboré une haute civilisation pastorale. Bref, le fait d'inclure, au sein d'un ensemble pleinement pastoral, les œuvres habituellement considérées comme bubalines ou « des chasseurs » ne devrait pas réellement surprendre. Henri Lhote et Paolo Graziosi avaient déjà suggéré un tel regroupement, et cela ne fait que confirmer une remarquable intuition de Théodore Monod qui, dès 1932, posait la question de savoir si certains groupes de gravures de l'ensemble « préhistorique bovin » ne seraient pas à intégrer au « Bubalin », dont ils auraient été « plus ou moins contemporains ».
Le style de Tazina. Ce style tire son nom d'une station située dans les monts des Ksour, en Algérie, et il est essentiellement caractérisé par de petites gravures de gazelles et de girafes finement incisées, plus rarement d'autruches ou de grands fauves, dont les extrémités sont prolongées de manière parfois très fantaisiste. La très large répartition de ce type de représentations pose des problèmes difficiles à résoudre, car elles dominent numériquement de larges ensembles du Sahara occidental (Haut Atlas marocain, Rio de Oro, Adrar mauritanien) et du Sahara centro-méridional (Messak libyen, Djado).
Les Guerriers libyens. Il s'agit d'un type de gravures le plus souvent piquetées, qui se trouvent en grand nombre dans l'Adrar des Ifoghas et de l'Aïr, moins fréquemment en Ahaggar, mais tout à fait exceptionnellement au Fezzan, au Djado et au Tibesti. Elles correspondent vraisemblablement à la première occupation berbère du Sahara, et représentent surtout des hommes dessinés en position frontale, arborant volontiers des lances aux armatures (lames) exagérément agrandies, qui sont souvent munis d'un bouclier rond et tiennent des chevaux par une longe. Des figures comparables existent dans l'Adrar de Mauritanie et l'Aouker. Toutes ces œuvres sont à situer entre le Ier millénaire avant notre ère et le Ier millénaire après.
Les styles de peintures. La zone du Sahara pour laquelle on dispose des meilleures données est celle du Tassili-Akākūs ; ailleurs, le regroupement en écoles est soit en cours (Tibesti oriental), soit n'a aucune assise chronologique fiable, soit encore souffre d'une multiplication excessive de petits styles très localisés et mal définis (Ennedi).
Les Têtes rondes. L'école des « Têtes rondes », essentiellement tassilienne, est surtout connue par la présence des « Martiens », sortes de personnages en aplat clair cerné d'un contour sombre, à grosse tête arrondie sans indication des traits du visage, et qui caractérisent les peintures les plus anciennes. La faune, dont l'identification est souvent malaisée, est surtout composée d'antilopes. Des réalisations probablement plus récentes mais dues à cette école, sont connues dans l'Akākūs, et il est bien difficile d'en préciser la position chronologique par rapport aux peintures du Bovidien ancien local. Dans les phases plus tardives, l'aplat clair cède la place au remplissage à l'ocre.
Le Bovidien. Pour le Bovidien ancien, il s'agit essentiellement de peintures de personnages négroïdes en aplats ocres, qu'Alfred Muzzolini a proposé de regrouper sous l'appellation d'« école de Sefar-Ozanéaré ». Elles n'ont été reconnues qu'au Tassili, et leur thème de prédilection est celui dit de « la conversation devant l'enclos », où des hommes et des femmes, aux cuisses volumineuses, sont assis ou allongés devant des habitations de plan elliptique ou sub-rectangulaire dont l'aménagement intérieur est en partie visible.
En ce qui concerne le Bovidien récent, les peintures de l'école d'Abaniora, en aplats ocres, comportent des personnages dont le profil évoque celui des Peuls actuels, ce qui a contribué à l'élaboration de théories interprétatives visant à expliquer très imprudemment l'art rupestre saharien par les traditions culturelles de ce peuple. Enfin, l'école d'Iheren-Tahilahi, caractérisée par les dessins au trait fin, nous a laissé de nombreuses peintures pastorales complexes (déplacement des campements, montage des tentes) où dominent les bœufs et les moutons, mais aussi des scènes de chasse au lion. Cette école trouve des correspondances dans l'Akākūs, notamment avec le style de Wa-n-Amil, avant de se prolonger insensiblement dans la « période du cheval » qui verra bientôt l'apparition des premiers chars « au galop volant ».
Caballin et camélin. Aucune rupture franche n'apparaît entre le monde des derniers pasteurs (par exemple l'école de Ti-n-Anneuin, caractérisée par des personnages rigides, longilignes, peints en blancs avec un manteau ocre) et celui des « Caballins » ou « Équidiens », qui affectionnent les personnages bi-triangulaires, dont la tête peut être réduite à un simple bâtonnet. Après le cheval, on voit apparaître les chars vraisemblablement introduits par l'intermédiaire de Cyrène, à partir du viie siècle avant J.-C. L'alphabet libyque, préfigurant les actuels caractères tifinaghs, n'apparaît probablement pas au Sahara central avant les ve-vie siècles avant J.-C. Enfin, le chameau fait son apparition dans le dernier quart du Ier millénaire avant J.-C. et permet la reconquête d'un Sahara que ses anciens habitants, chassés par la détérioration du climat, avaient presque totalement abandonné. De nos jours, les Touaregs continuent à graver ou à peindre dans leur environnement, surtout autour des gueltas (points d'eau temporaires), des figurations camélines et des caractères tifinaghs.
C'est ainsi qu'en suivant la lecture de trois fresques tassiliennes proposée par l'ethnologue malien Hamadou Hampāté Bā, à la lumière des traditions ésotériques peules, on a pu espérer découvrir une clé de lecture susceptible de conduire aux significations profondes des images non descriptives, fréquentes sur nombre de sites. Mais là encore, il s'agissait d'une projection sans lendemain puisque, après cette intéressante tentative, aucune autre fresque n'a jamais pu être « lue » de cette façon. Il n'en est pas moins resté la thèse éminemment discutable et pourtant toujours citée, selon laquelle les auteurs des fresques tassiliennes auraient été des « proto-Peuls ».
Quant à la douzaine de rapprochements effectués depuis un siècle entre des œuvres du Sahara et de l'Égypte ancienne, ils s'appuient généralement sur des dossiers contestables et ne peuvent pas conforter l'idée d'une influence directe entre les deux zones. Mais quelques cas, énigmatiques, comme celui des béliers ornés d'un disque pourraient s'expliquer par l'hypothèse d'un héritage commun.
Il est bien plus fécond de revenir à une analyse interne des sites, où l'on a trop longtemps négligé les interrelations existant entre les figures. On a aussi prêté trop peu d'attention au rapport que celles-ci entretiennent avec les parois rocheuses, car le choix d'un support faisait partie intrinsèque de la réalisation des œuvres, qui ne peuvent en être extraites. Des recherches de ce type, actuellement en cours au Messak libyen, ont permis à quelques auteurs, non pas de révéler la signification profonde de l'ensemble des œuvres, ce que plus personne ne songe à faire, mais d'approcher les connotations probables de plusieurs d'entre elles. Des résultats encourageants ont été ainsi obtenus pour certains signes abstraits du Messak libyen, dont Axel et Anne-Michèle van Albada ont bien montré qu'ils correspondaient à des schématisations extrêmes du corps féminin.
Mais parmi les ensembles bubalins actuellement inventoriés, figure aussi une grande quantité d'images dans lesquelles nous ne pouvons reconnaître que de simples représentations animalières. Qu'au sein de la société des artistes préhistoriques elles aient été ou non le support d'un symbolisme particulier, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Toujours est-il que la liste des espèces représentées sur les parois ne correspond aucunement à un reflet fidèle de la faune de l'époque, et encore moins de l'ensemble du milieu naturel environnant (par exemple, les plantes et les insectes sont pratiquement absents du répertoire graphique). L'essentiel de l'art bubalin correspond donc à un immense bestiaire imagé, où certaines espèces ont été favorisées au détriment d'autres pour des raisons qui nous échappent, mais qui résultent des choix culturels ayant présidé à l'élaboration des dispositifs.
Le poids de ces choix est encore plus sensible dans le monde des « Têtes rondes », où l'on serait bien en peine de reconnaître une seule scène de la vie quotidienne. Tout n'est que personnages étirés ou flottant horizontalement dans les airs, « martiens » géants munis d'excroissances anatomiques monstrueuses, « orantes » aux têtes circulaires couvertes de motifs géométriques, animaux à longues pattes linéaires, ou motifs circulaires abstraits que, faute de mieux, on a baptisés « méduses » et « verseaux ». Presque tout dans cet art demeure absolument opaque à nos yeux et, pour expliquer l'atmosphère d'étrangeté qui s'en dégage, on a parfois supposé l'influence de substances psychotropes tirées de certaines convolvulacées sahariennes (Ipomaea purpurua, Turbina corymbosa).
Aucune école de gravure ne rappelle l'atmosphère mystérieuse des peintures des « Têtes rondes » dans leur ensemble, mais plusieurs analogies notables se retrouvent par contre entre gravures et peintures pastorales. Dans ces deux groupes en effet, on connaît – au Tassili et en Libye – des représentations de femmes se déplaçant montées sur des bovins, ou des scènes montrant la vie paisible d'un campement de pasteurs. Mais cela n'empêche pas la présence de figures énigmatiques qui devaient se référer à des conceptions symboliques ou religieuses désormais perdues.
Ainsi, les arts peints et gravés des périodes anciennes sont toujours emprunts de religiosité, bien qu'à des degrés divers selon les écoles. Le contraste est total avec les périodes plus récentes, celles dites « caméline » et « caballine », où prédominent les représentations de guerriers en pied, munis de leur armement, et régulièrement montrés à la chasse ou au combat. L'apparition du métal et du bouclier, l'exaltation des armes et la représentation magnifiée d'individus stéréotypés témoignent d'un autre monde, qui n'a plus grand-chose en commun avec celui que présentent les images anciennes. Certes, ces représentations ont pu être investies d'une symbolique particulière, et l'on sait que des armes comme les poignards, par exemple, sont souvent riches de connotations cosmogoniques chez les populations qui les emploient. Mais, sur les ensembles rupestres, on ne trouve aucun indice de religiosité. Surtout, le contraste est si net entre la richesse imaginaire ou la liberté graphique des œuvres anciennes, d'une part, et le caractère statique ou la monotonie des productions récentes, d'autre part, que cette opposition doit bien correspondre à quelque chose comme une sorte de « laïcisation » de l'art ou à tout le moins, à des modifications consécutives à l'arrivée des premières populations méditerranéennes, porteuses d'une idéologie en rupture avec le fonds de croyance des anciennes populations sahariennes.
En Afrique australe, la situation est très différente, car les figurations rupestres y sont apparemment plus proches, dans leur conception graphique, des normes artistiques occidentales, et leur caractère éminemment symbolique laisse place à de nombreuses possibilités d'interprétation. Les peintures pariétales, surtout concentrées dans les abris de montagne, s'y comptent par dizaines de milliers, de la Namibie au Mozambique et du Zimbabwe au Cap, mais il existe aussi des sites à gravures remarquables sur le plateau central sud-africain au Botswana. Les deux modes d'expression (peinture et gravure) sont au service d'un art essentiellement animalier, où figurent la plupart des représentants de la grande faune africaine, avec une écrasante majorité pour les figurations de la grande antilope appelée « éland du Cap ».
Lorsque les premiers auteurs n'y virent pas le produit du délassement des San (alors appelés « Bushmen ») supposés occuper ainsi leur oisiveté, ils crurent y reconnaître les indices d'une magie imitative à vocation cynégétique. Au xviiie siècle, sir John Barrow attribuait aux peintures du Cap un rôle comparable, au sein de la société san, à celui que tiennent les tableaux dans nos musées, mais des explications aussi simplistes sont abandonnées de nos jours, comme du reste toute tentative d'élucidation globale et unique de cet art. Une longue tradition interprétative, dite « narrative » et fondée dans les années 1860 par le géologue George William Stow, préféra considérer les fresques comme autant de témoignages sur la vie quotidienne des San, leur culture matérielle et leurs techniques de chasse. Mais dès les premières études, il était apparu qu'un certain nombre de figures (séries de points, cercles, lignes reliant des personnages) résistaient à toute tentative d'interprétation, alors qu'elles devaient pourtant bien receler un sens précis. On s'aperçut également que toutes les superpositions n'avaient pas de valeur chronologique, que certaines d'entre elles avaient été pratiquées volontairement, et qu'elles devaient donc être chargées de sens. Quant à l'interprétation par la magie de la chasse, elle ne résultait que de la lecture forcée de quelques scènes montées en épingle à partir de l'a priori selon lequel les artistes auraient dépeint en quelque sorte leur vie quotidienne. En réalité, on sait maintenant que les vraies scènes de chasse sont particulièrement rares et que le bestiaire figuré, privilégiant l'éland du Cap, ne coïncide pas avec le régime alimentaire des San, dans lequel le gibier est essentiellement composé de petits animaux pris au piège. L'art figuré témoigne donc d'une sur-représentation de l'éland du Cap, et d'une sous-représentation des espèces réellement consommées. En outre, plus de 60 p. 100 de l'alimentation des San est habituellement constituée de plantes dont la récolte est une activité traditionnellement féminine, alors que les figurations de femmes sont rarissimes dans les peintures. Au bout du compte, la multiplication de ce type d'observations a finalement conduit à l'abandon de la théorie associant l'art rupestre sud-africain aux techniques d'acquisition de la nourriture.
Comme dans le domaine saharien, l'histoire de la recherche sur l'art rupestre de l'Afrique australe a été marquée par bien des tentatives naïves de lecture qui, en réalité, n'étaient qu'autant de projections. C'est ainsi que dans la première moitié du xxe siècle, Raymond Dart et l'abbé Breuil crurent percevoir des réminiscences phéniciennes, sinon babyloniennes, perses et sumériennes, dans des peintures du Drakensberg. Quant à C. van Riet Lowe, il avait même considéré que l'instrument tenu par un « théranthrope » (être mi-homme, mi-animal) peint dans cette région n'était autre qu'un aulos (double flûte) grec, et que l'instrumentiste rappelait la figure d'Anubis.
Tout en permettant de s'affranchir de conceptions à ce point eurocentriques, les recherches ultérieures ont montré que l'art rupestre sud-africain était bien descriptif, mais d'une façon très différente de celle supposée jusqu'alors. En effet, l'étude détaillée des publications laissées par les ethnographes, les voyageurs et les missionnaires du xixe siècle a montré que les rituels fondamentaux des San utilisaient le phénomène de la transe collective provoquée. Or plusieurs détails des peintures, jusqu'alors inexplicables, peuvent se comprendre dans un tel cadre. On peut citer en exemple la position contractée ou révulsée de certains danseurs, et le saignement de nez qui accompagne généralement la transe, car ce sont autant de traits qui ont été notés par les peintres. De même, on peut supposer que les nombreuses figures de théranthropes tendent à rendre visible le processus de transformation surréelle survenant au cours de la transe, alors qu'elles seraient totalement incompréhensibles dans le cadre d'un art vériste n'ayant pour but que de décrire la vie quotidienne des chasseurs.
Bref, les peintures rupestres, même les plus énigmatiques en apparence, représentent donc bien quelque chose mais, plus que le gibier convoité ou son mode d'acquisition, elles évoquent le monde spirituel des anciens peintres, leurs croyances et, en partie, leurs rites destinés à se concilier le pouvoir des esprits-animaux. Depuis les travaux fondamentaux du linguiste allemand Wilhelm Bleek, de sa belle-sœur Lucy Lloyd et de sa fille Dorothea qui, vers la fin du xixe siècle, consacrèrent leur vie au recueil et à l'étude de témoignages contemporains des derniers dépositaires de l'ancienne tradition picturale, il est admis que le seul moyen de comprendre les peintures rupestres d'Afrique du Sud est de les replacer dans le cadre élargi des données mythologiques et linguistiques recueillies chez les anciens San.
Mais à partir des années 1960, il devint patent qu'il n'était guère possible d'analyser les œuvres à partir des seuls relevés – incomplets, partiels, tronqués, arbitrairement sélectionnés et souvent « arrangés » – jusqu'alors publiés. Sous l'impulsion de Patricia Vinnicombe, un riche courant d'études quantitatives vit alors le jour, consacré à l'enregistrement détaillé des sites, tant dans l'espoir d'en comprendre ainsi la signification, que dans celui d'apporter une assise scientifique à ces études.
Ces espoirs ayant été quelque peu déçus, les chercheurs s'intéressèrent à nouveau aux San, d'une part grâce à la multiplication des travaux sur ceux du Kalahari, et surtout grâce au dépouillement systématique des quelque 12 000 pages de notes et de transcriptions intégrales de mythes laissées par les Bleek. Grâce à la perspicacité de chercheurs comme David Lewis-Williams, il apparut alors que les conceptions générales ayant présidé à l'élaboration de l'art rupestre avaient été miraculeusement préservées, et que de nombreux détails des peintures pouvaient s'expliquer grâce à elles. Contrairement à ce qui s'était passé lors de la « lecture » de trois peintures sahariennes à la lumière des traditions peules, il ne pouvait s'agir ici de coïncidences, car non seulement les concordances étaient multiples et précises, mais elles permettaient soudain d'approcher les conceptions complexes ayant présidé à la création de centaines d'œuvres. De plus, cette direction de travail allait également montrer que les symboles utilisés pour la composition des peintures présentaient une riche polysémie, interdisant toute lecture monolithique.
Du reste, toute tentative globale d'explication négligerait la très longue durée au cours de laquelle se développèrent les arts rupestres d'Afrique australe. De nombreuses peintures témoignent des contacts entre les San, les Khoi-Khoi (Hottentots) et les Bantous, ces dernières populations pratiquant l'élevage, mais on a certainement exagéré l'impact qu'aurait eu sur l'art le contact, voire l'antagonisme, établi entre tous ces groupes.
Sur les peintures les plus récentes apparaissent, par contre, des images qui témoignent de l'arrivée des colons européens, et du calvaire que durent alors subir les San, jusqu'à leur quasi-extermination : on connaît plusieurs représentations de cavaliers tirant au fusil sur des petits hommes qui tentent de s'enfuir en courant... Ce sont là les dernières manifestations d'un art dont les origines sont à situer en plein Pléistocène. En effet, à Apollo Cave, un abri des montagnes Huns au sud de la Namibie, cinq plaquettes de pierre portant des peintures d'animaux en noir et en rouge, furent découvertes dans des couches d'occupation où la date la plus ancienne était de 26700 ± 650 B.P. Cela ferait de ces œuvres les peintures les plus vieilles d'Afrique, et certains auteurs en ont déduit que l'art rupestre sud-africain pourrait bien être aussi ancien que son homologue européen. Mais il convient de remarquer d'une part qu'il s'agissait ici d'art mobilier et non d'art rupestre à proprement parler, et de l'autre que l'argument serait plus convaincant si ces dates étaient confirmées.
Quoi qu'il en soit, David Lewis-Williams a judicieusement utilisé cette découverte pour réfuter localement une hypothèse implicite naguère en vogue, et selon laquelle l'art des peintures rupestres aurait connu une évolution complexifiante en ayant d'abord été monochrome, puis bichrome et enfin polychrome. Une fois de plus, il s'avérait donc que cette idée n'était rien d'autre qu'une notion née des préjugés évolutionnistes cultivés par certains chercheurs occidentaux.
Au niveau de graviers de Kehe, qui appartiendrait au premier stade du Paléolithique inférieur, succède l'argile rouge caractéristique du Pléistocène moyen en Chine du Nord. Les gisements principaux sont à Zhoukoudian et dans la vallée du moyen Huanghe.
b) La culture de Zhoukoudian. Le site de Zhoukoudian, à quarante-deux kilomètres au sud-ouest de Pékin, est certainement le mieux connu. Les grottes et anfractuosités calcaires, signalées dès 1918, ont été fouillées de 1921 à 1937 (Bei Wenzhong et Teilhard de Chardin) et de nouveau depuis 1959.
Trois niveaux chronologiques au moins sont décelables à Zhoukoudian : la localité 13, la plus ancienne, la localité 1, enfin les localités 15, 3 et 4. La localité 13 n'a livré qu'un chopping tool, mais la localité 1, la plus riche par le nombre et la continuité des séries, montre une industrie du quartz taillé ( galets aménagés et éclats) associée à des restes fossiles du Sinanthropus pekinensis (l'homme de Pékin) et à une faune variée.
Le sinanthrope, que les anthropologues rapprochent du pithécanthrope de Java, est caractérisé par la station debout, une capacité crânienne de 1 000 centimètres cubes en moyenne et l'aptitude à fabriquer et à utiliser des outils. Vivant en groupe dans des grottes naturelles, le sinanthrope se nourrissait des produits de la chasse et de la cueillette, faisait du feu, pratiquait vraisemblablement le cannibalisme et employait des os comme outils sans pour autant les façonner.
L'outillage en pierre, qui s'apparente à une pebble culture évoluée, se compose de pièces sur galets ou fragments de galets, dont la pointe ou l'un des bords fut généralement utilisé. Les éclats, de débitage clactonien, furent parfois retouchés en racloirs.
c) Le moyen fleuve Jaune. De nombreux sites du Paléolithique inférieur, parmi lesquels Tongguan au Shaanxi, Shaanxian au Henan, Yuanqu au Shanxi, ont livré dans le niveau de terre rouge une industrie de galets et d'éclats semblable à celle du sinanthrope.
d) L'homme de Lantian. Une mâchoire inférieure d' hominidé a été découverte en 1963 à Lantian au Shaanxi, associée à un grand nombre de mammifères fossiles typiques du Paléolithique inférieur. Un crâne complet fut trouvé en 1964 à Gongwangling près de Lantian. Les traits morphologiques de ces deux fossiles montrent une nette parenté avec le sinanthrope, mais présentent des caractères plus primitifs qui les rapprocheraient plutôt du Pithecanthropus robustus de Java. Il est possible qu'ils correspondent à un stade un peu plus ancien que celui de l'homme de Pékin et soient contemporains de la localité 13 de Zhoukoudian. L'outillage associé aux fossiles comprend des choppers et des chopping tools en quartz et en quartzite, certains relativement grands et prismatiques.
e) « Gigantopithecus » et « Sinanthropus » en Chine du Sud. La présence en Chine du Sud du Gigantopithecus identifié par G. H. R. von Kœnigswald est confirmée par la découverte récente de nombreux fossiles trouvés in situ dans les dépôts jaunes des grottes du Guangxi, associés à une faune typique du Paléolithique inférieur.
On a également recueilli des dents d'un hominidé dont les traits primitifs sont comparables à ceux du Sinanthropus pekinensis. Mais le matériel trouvé autour de ce Sinanthropus officinalis reste trop peu abondant pour que l'on sache si la Chine du Sud était habitée par un Sinanthropus.
L'Ordos, qui englobe le Ningxia oriental, le sud-ouest de la Mongolie-Intérieure, le nord du Shaanxi et le nord-ouest du Shanxi, est la région de Chine où les industries du Paléolithique moyen sont le mieux connues. Un des sites les plus intéressants, celui de Shuidonggou, sur la rive orientale du Huanghe, a été fouillé en 1922 par le père Teilhard et le père Licent.
Les chasseurs de Shuidonggou fabriquaient des choppers, des pointes, des racloirs à partir de galets de quartzite. La plupart des outils sont massifs, mais certains sont très petits et des lames longues apparaissent.
Cette situation de transition n'est pas limitée à l'Ordos. Des fouilles récentes au Henan et au Shanxi ont livré, associés à une faune lœssique typique du Pléistocène supérieur, des outils microlithiques, surtout des silex, taillés selon ce qui sera la tradition du Gobi. Des porteurs de cette tradition avaient donc leur habitat dans la vallée du Huanghe dès le Paléolithique supérieur.
b) L'homme et la culture de Dingcun. Les fouilles effectuées en 1954 sur le site de Dingcun, dans le Shanxi méridional, ont mis au jour des fossiles humains associés à une industrie de galets et d'éclats. Attribuée d'abord au Paléolithique inférieur, puis au Paléolithique moyen, la culture de Dingcun est actuellement considérée comme une survivance de la fin du Paléolithique inférieur dans le lœss du Paléolithique supérieur. L'outillage (éclats, souvent de grande taille et choppers) reste dans la tradition de Zhoukoudian, mais témoigne de progrès techniques et d'innovations : nucleus préparé, éclats finement retouchés, bifaces sur blocs et sur éclats, de style plutôt acheuléen.
c) La grotte supérieure de Zhoukoudian. Signalée en 1930 par Bei Wenzhong et fouillée en 1933-1934, cette grotte a livré une faune plus récente que celle de l'Ordos, des vestiges humains d'Homo sapiens de type mongoloïde associés à un outillage de silex et de quartzite. Pêcheur et chasseur, l'homme de la grotte supérieure façonnait des choppers et des chopping tools à partir de galets et adaptait des éclats de silex en racloirs. Il travaillait aussi l'os et les andouillers. Des perles de pierre habilement percées et peintes en rouge avec de l'hématite étaient utilisées comme parure, de même que des cailloux, des coquillages, des os et des dents perforés et polis. Des coutumes funéraires devaient exister et des échanges avec d'autres régions sont attestés.
d) Le Paléolithique supérieur en Chine du Sud. En 1951, des vestiges d'un Homo sapiens plus ancien que celui de la grotte supérieure, l'homme de Ziyang, furent découverts au Sichuan. D'autres vestiges d'Homo sapiens furent mis au jour au Guangxi, à Laibin et à Liujiang. Ces trois groupes sont mongoloïdes.
Le groupe de Shayuan au Shaanxi oriental montre des affinités avec le Microlithique du Gobi et des liens très nets avec les industries de l'Ordos du Paléolithique supérieur.
Vers l'est, la culture microlithique du Gobi s'étend jusqu'en Mandchourie avec deux sites principaux : Djalai-nor et Guxiangtun. Il semble bien qu'ici, comme dans les dunes de Mongolie, la tradition mésolithique persista très longtemps, même lorsque le Néolithique eut été introduit.
b) La Chine du Sud. De nombreux sites mésolithiques ont été signalés au Sichuan. L'industrie lithique de ces défricheurs de forêts semble rester dans la tradition du galet aménagé, mais un type caractéristique y apparaît que l'on peut appeler la « hache à épaulement », grande et lourde. Les microlithes sont inconnus. Des traits culturels semblables ont été relevés dans d'autres régions de la Chine du Sud-Ouest et s'apparentent aux niveaux hoabinhiens d'Indochine. Actuellement, on attribuerait plutôt ces niveaux au début du Néolithique, malgré l'absence de céramique et d'outils en pierre polie.
À côté d'un outillage en pierre et en os polis, les techniques céramiques sont déjà diversifiées. À la cuisine sont destinées des poteries en argile grossière mêlée de sable, faites à la main à l'aide de moules en vannerie ou en corde, moules qui ont laissé leur empreinte sur les parois des vases. Leur couleur n'est pas uniforme et varie du rougeâtre au grisâtre.
Montée à la main, à l'aide de boudins d'une argile mieux épurée et cuite à environ 1 000 0C, une céramique rouge semble réservée aux liquides et à la conservation des grains. Les formes comprennent de grandes jarres à fond pointu munies de deux petites anses, des pots, des bassins, des bols et des bouteilles. La surface est lissée. Certaines pièces sont ornées d'un décor noir, plus rarement rouge, peint avant la cuisson. Ce décor se compose de motifs géométriques : tresses, triangles (à Banpocun), lignes onduleuses (à Miaodigou). On y remarque aussi des représentations réalistes : poissons, masque humain à Banpocun, grenouille à Miaodigou.
On a donné à ce complexe néolithique le nom de culture de la poterie rouge ou de Yangshao, d'après le nom du site du Henan occidental où Andersson le distingua en 1921. La parenté de cette poterie rouge avec les céramiques néolithiques de l'Iran (Sialk, Anau) a incité certains archéologues occidentaux à attribuer l'origine de la poterie rouge chinoise à une influence étrangère. Mais les jalons intermédiaires manquent encore à l'appui de cette théorie. Les archéologues chinois pensent à une invention locale qui, apparue au Shaanxi, se serait propagée vers le Shanxi, le Henan et jusqu'au Shandong.
Vers le milieu du IIIe millénaire, la culture de la poterie rouge progresse vers l'ouest : au Gansu, les jarres globuleuses de la nécropole de Banshan sont décorées à l'épaule de décors peints en rouge et noir, où se mêlent motifs géométriques et figurations humaines très schématiques ; à côté de ces vases funéraires, les exemples retrouvés dans l'habitat voisin de Majiayao ont un décor plus simple et de couleur noire.
b) La culture de Longshan Si la poterie rouge se perpétue longtemps dans les provinces occidentales du Gansu et du Qinghai – sites de Machang, Qijia, Xindian, etc. –, elle disparaît lentement du bassin du fleuve Jaune pour faire place à une céramique grise ou noire qui correspond à la culture de Longshan, du nom du site où elle fut découverte en 1928 au Shandong.
La céramique de cette culture se caractérise par son extrême minceur, sa surface polie et brillante, son corps variant du noir au gris foncé. Le ton noir serait le résultat d'un enfumage du four en fin de cuisson. Les vases étaient ensuite polis au moyen d'une pierre ou d'un morceau de corne.
Cette culture de Longshan fut peut-être créée par les tenants de la culture de la poterie rouge, l'amélioration des fours ayant facilité cette évolution. Les sites de Miaodigou II et de Sanliqiao au Henan sembleraient l'indiquer et seraient antérieurs aux sites du Shandong. La céramique y est moins fine et moins abondante que dans le Longshan du Shandong. Les tons gris dominent. Certaines formes apparaissent, qui annoncent celles des bronzes rituels (tripodes à pieds pleins, coupes sur haut pied rond ajouré et cannelé, verseuses). Les traces du tour sont souvent utilisées comme décoration (filets en relief ou sillon sur les parois).
Le Longshan du Henan pourrait s'échelonner de 2500 environ à 1800 environ avant J.-C., tandis que le Longshan du Shandong serait un peu postérieur.
L'horizon de la céramique cordée, touche les régions suivantes : Hubei occidental, Sichuan, Guangxi, Guangdong, Yunnan et Taiwan, peut-être aussi le Guizhou et le sud-ouest du Hunan.
Cet horizon est caractérisé par une économie fondée sur la chasse, la pêche, la cueillette et le ramassage des coquillages, par des outils en pierre taillée et par une céramique à impressions de cordes. Cette phase culturelle prend fin vers le milieu du IIe millénaire, lorsque des influences Shang atteignent ces régions.
L'horizon longshanoïde désigne l'extension de la culture septentrionale vers la vallée du fleuve Huai, la basse vallée du Yangzi et les vallées côtières du sud-est.
Cet horizon est marqué par des habitats situés sur des buttes ou montés sur pilotis, par la culture du riz et du millet, la domestication des animaux, la pratique de la scapulomancie, l'usage important de l'os et des coquilles, l'absence de métallurgie, enfin par l'emploi de haches, d'herminettes, de couteaux et de faucilles en pierre polie. La céramique, inspirée de la culture de Longshan en Chine du Nord, comprend un certain nombre de formes typiques telles que tripodes, vases verseurs, par exemple.
Cet horizon méridional apparaît comme une extension des débuts de la culture de Longshan en Chine du Nord. Il est difficile encore de situer ses débuts. Développé assez vite en phases régionales (culture de Qingliangang au Jiangsu, par exemple), il a dû se perpétuer pendant une période très longue, au moins jusqu'au milieu du IIe millénaire avant notre ère.
L'horizon géométrique, qui désigne la prépondérance d'un décor géométrique estampé sur la céramique, semble être une tradition distincte du Sud-Est, qui succède, dans cette région, à l'horizon longshanoïde. La plupart des traits culturels longshanoïdes se continuent, mais les tripodes, la céramique faite au tour et les décors peints diminuent ; ils sont remplacés par des urnes à fond rond, le façonnage à la main et le décor par impressions géométriques. Dans certaines régions – Anhui, Jiangsu, Zhejiang –, la métallurgie du bronze apparaît et de nombreux motifs de la céramique géométrique imitent des décors du bronze. La densité des sites archéologiques de cet horizon croît considérablement par rapport à l'horizon précédent ; l'aire de dispersion reste la même, mais il faut y ajouter le Hunan.
Il est vraisemblable que cet horizon s'est développé grâce à l'impulsion des civilisations contemporaines du Nord (Shang et Zhou) sur un substrat local longshanoïde. Ses débuts doivent se situer vers 1500 avant J.-C., tandis que le passage à l'âge du bronze, influencé par les Zhou orientaux, varie et se situe entre 700 et 300 avant J.-C. selon les régions.
La transition avec le début de l'Holocène (env. 11000-6000 av. notre ère) est l'une des phases les moins bien connues de la préhistoire coréenne. D'après les études des années 1990, les hommes ne semblent pas avoir abandonné la péninsule à cette époque comme le prétend la théorie traditionnelle. Les sites, répartis sur l'ensemble du territoire, ont révélé la pratique d'une industrie microlithique sur lame à nucléus cunéiformes. Les plus anciennes céramiques connues en Corée datent peut-être de la fin de cette période. Bien qu'il y ait de nombreuses polémiques à ce sujet, de telles données s'intègrent parfaitement dans l'horizon postglaciaire du Nord-Est asiatique, caractérisé, entre autres, par l'apparition d'une céramique grise décorée qui indique une évolution progressive vers le Néolithique.
L'art mobilier se développe au cours de cette période : bracelets de coquillage, petits anneaux en néphrite ou en marbre, perles de toutes sortes dont certaines en jade, épingles à cheveux décorées, petits masques et figurines zoomorphes et anthropomorphes.
Vers 2000 avant J.-C., la société coréenne subit de nouvelles transformations qui marquent la fin du Néolithique. Pour les périodes protohistoriques et historiques, on se reportera à l'article corée (Les arts de la Corée).
Aux pièces à fond pointu succéderont des bassins profonds à fond plat, proches de ceux du littoral sibérien. C'est à l'époque du Jōmon moyen que, sur le littoral du Pacifique (région de Tōkyō), le plus favorisé par le climat, apparaissent, avec des habitats plus denses aux demeures semi-souterraines pourvues d'un foyer et aux importants amas de coquillages (kaizuka), de hauts bassins à l'ouverture rehaussée de boudins d'argile et de masques d'animaux en relief, d'un parti stylistique parfaitement original. Les figurines modelées dans la terre ( dōgu), traitées jusqu'alors de façon réaliste, se schématisent et se revêtent d'un décor de spirales et d'impressions cordées. Ce style nouveau se répandra dans l'île de Hondo (ou Honshū) et, avec certaines modifications, se perpétuera très longtemps dans la partie septentrionale de cette dernière. L'apparition à la même période d'un outillage en os (harpons, poissons-leurres, parures), qui s'inspire de modèles sibériens, témoigne de rapports renouvelés avec le continent, rapports dont le mécanisme et la localisation n'ont pas encore été éclaircis.
Contrairement aux datations très hautes obtenues après la guerre par la méthode du carbone 14, ces rapports attestés avec le continent inclinent aujourd'hui les archéologues japonais à harmoniser leur chronologie avec celle établie par les savants continentaux et à rabaisser l'apparition du Néolithique au IIIe millénaire avant notre ère.
Dans le nord-ouest du Kyūshū, vers les iiie-iie siècles avant J.-C., de nouvelles techniques, transmises par l'intermédiaire de la Corée du Sud (riziculture, métallurgie, tissage, etc.), transformeront les chasseurs-pêcheurs en agriculteurs, c'est ainsi que les premières poteries Yayoi voisineront avec des spécimens du Jōmon tardif. Au cours des siècles qui suivront, agriculture et métallurgie se répandront rapidement dans l'île de Hondo. Seul, l'extrême nord de l'île restera longtemps fidèle aux techniques néolithiques.
Ce lien en quelque sorte organique entre le cerveau évolué de l'homme préhistorique moderne et la création artistique dont il est l'auteur s'inscrit dans la perspective des comportements métaphysiques proprement et exclusivement humains attestés par des sépultures aménagées dès le Paléolithique moyen, deux à trois dizaines de millénaires auparavant : une bonne trentaine d'inhumations individuelles ou collectives, réalisées par des Néandertaliens (Homo sapiens neandertalensis) en Europe et au Moyen-Orient.
Cependant, l'acte de représenter, c'est-à-dire d'inventer entre soi et son univers une forme, de l'inscrire pour durer dans la pierre ou l'os, bref d'introduire de l'imaginaire pur dans la matérialité concrète des objets et des parois rocheuses, est absolument nouveau et conduit à notre modernité, celle du visuel et de l'abstrait.
Nouveau, le phénomène artistique est également universel. Jusqu'aux années 1970, l'ancienneté et la multitude des travaux consacrés à l'art paléolithique franco-cantabrique d'une part, la rareté des recherches appliquées ailleurs – à l'exception de l'Afrique saharienne et australe – s'étaient conjuguées pour laisser croire que les origines de l'art préhistorique étaient européennes ; il n'en est rien. En Australie, des travaux ont donné des datations absolues au carbone 14 archéologiquement bien fondées ; celles-ci montrent que d'assez nombreux ensembles gravés ou peints en abris et en grottes sont contemporains de l'art pariétal magdalénien de France et d'Espagne ; certains sites ont même plus de vingt mille ans ; ils sont donc plus anciens que l'essentiel de l'« art occidental préhistorique ». Il en est de même sans doute en Amérique du Sud, au Brésil notamment, mais aussi en Argentine et au Chili, où les sites correctement datés au-delà de 10 000 B.P. (before present), voire 15 000 B.P. et plus, se multiplient sous l'effet de recherches intensives développées à partir de 1980. L'Afrique et l'Asie – l'Inde en particulier – offrent aussi une multitude de sites d'art rupestre appartenant à des cultures anciennes dont les modes de vie permettent de les comparer aux cultures du Paléolithique supérieur européen.
Sites d'art pariétal et d'art mobilier paléolithiques en Europe Répartition des sites d'art pariétal et d'art mobilier paléolithiques en Europe.
L'universalité du phénomène artistique résulte bien entendu de celle de son auteur, c'est-à-dire du type humain sapiens, qui, précisément, achève de conquérir le monde au cours de ces quatre dernières dizaines de millénaires ; en même temps qu'il s'approprie de nouveaux espaces, Homo sapiens les peuple d'images.
Le choix des supports montre aussi la richesse des comportements symboliques des hommes préhistoriques : armes et outils furent parfois richement décorés comme pour souligner la valeur et l'importance qu'ils revêtaient pour l'accomplissement des tâches quotidiennes ; mais les « objets d'art », sans fonction utilitaire, sont également nombreux dès les périodes les plus anciennes comme le prouvent les statuettes animales et humaines modelées en terre et cuites par des Gravettiens d'Europe centrale, il y a plus de 25 000 ans.
Partout dans le monde, l'art monumental est un mode d'expression de plein air, qu'il s'agisse de représentations en abri, sur roches ou même sur dalles au sol ; la seule exception fut celle, merveilleuse, de l'art pariétal paléolithique, un art des profondeurs, celui des grottes et des cavernes.
Plus que tout autre vestige archéologique, l'art préhistorique reflète directement la pensée, le rêve de ses auteurs, les cosmogonies et les symboles de leurs groupes. Il est un lien privilégié de compréhension entre les hommes préhistoriques et nous-mêmes.
1. Europe
• Historique des découvertes
La découverte en 1940 de la grotte de Lascaux en Dordogne conféra à l'art paléolithique pariétal une célébrité mondiale et lui donna la première place dans l'histoire universelle de l'art. Cependant, un siècle de trouvailles et de recherches avait précédé la révélation de Lascaux – et l'on ne cesse de découvrir d'autres grottes décorées (une quinzaine en France entre 1975 et 1986) grâce à des prospections et à des observations systématiques dans les cavités karstiques des régions à forte densité d'occupation du Paléolithique supérieur (Périgord, Quercy, Pyrénées, Pays basque, Cantabres et Asturies).Les objets gravés de figures animales et de motifs abstraits ou géométriques trouvés avant les grandes recherches et classifications d'Édouard Lartet, Henry Christy, Félix Garrigou en Périgord et dans les piémonts pyrénéens, au cours des années 1860, passèrent pour « celtiques », tel l'os gravé de deux biches du Chaffaud (Vienne), dégagé vers 1834. Les fouilles des grands gisements comme Laugerie-Basse, La Madeleine le long de la Vézère en Dordogne, celles de Bruniquel (Tarn-et-Garonne), de Brassempouy (Landes), de Lourdes (Hautes-Pyrénées), puis d'Isturitz (Pyrénées-Atlantiques), du Mas-d'Azil (Ariège) permirent d'établir des classifications chronologiques relatives, à partir des séquences stratigraphiques mises au jour. Ainsi l'idée de l'ancienneté pré-historique d'un art d'objets s'imposa peu à peu aux savants pionniers (Édouard Piette, en particulier) de la seconde moitié du xixe siècle, parallèlement donc aux découvertes d'hommes fossiles et leurs habitats, industries et sépultures. D'entrée, les préhistoriens avaient été frappés par les représentations d'animaux appartenant à des espèces éteintes ou disparues de nos régions : des mammouths, des bisons, des rennes ; l'abondance des débris osseux de rennes consommés par les chasseurs les inclina à attribuer à un « Âge du renne » les couches d'habitats qui recélaient ces vestiges, associés à des objets gravés. Alors même que l'ancienneté « antédiluvienne » de l'Âge du renne ne pouvait être évaluée correctement ni bien sûr datée, l' art mobilier des chasseurs préhistoriques avait été reconnu sans difficultés majeures. Lorsque, en 1879, don Marcelino de Sautuola découvrit les peintures du plafond de la grotte d' Altamira (Cantabrie) où il pratiquait des fouilles en amateur éclairé, l'homme préhistorique était encore envisagé comme un sauvage, bon ou mauvais, mais en tout cas pas comme l'auteur des splendides bisons bichromes d'Altamira ! L'art mobilier avait été admis ; c'était principalement un art de gravure, parfois de sculpture ou de découpage de lames osseuses, toujours de dimensions réduites ; on n'avait pas encore compris l'extraordinaire niveau esthétique et artistique atteint par ces chasseurs primitifs. Ce n'est qu'au début de ce siècle, en 1902, qu' Émile Cartailhac, premier titulaire d'une chaire d'enseignement de la préhistoire, reconnut dans son célèbre écrit Mea culpa d'un sceptique l'authenticité des peintures d'Altamira qu'il avait intempestivement contestée. En réalité, une vingtaine de grottes découvertes à partir de 1895 avaient conduit à la reconnaissance de l'art monumental souterrain : la grotte Chabot dans le canyon de l'Ardèche avec ses vigoureuses gravures de mammouths, la grotte de Pair-non-Pair au milieu du vignoble girondin, offrant plusieurs panneaux de gravures d'animaux profondément incisés, la longue et étroite galerie de Marsoulas (Haute-Garonne) possédant de multiples signes peints et gravés, ainsi que des représentations de bisons et de chevaux, les gravures variées de la galerie sinueuse et basse de La Mouthe (Dordogne) dont les sédiments livrèrent une lampe en calcaire décorée d'un bouquetin (voir ) contribuèrent d'abord à l'identification de l'art pariétal et à son extension dans tout le sud-ouest de la France jusque sur la rive droite du Rhône ; les deux découvertes presque simultanées à la fin de l'été de 1901 des Combarelles et de Font-de-Gaume, près des Eyzies-de-Tayac au cœur du Périgord noir, emportèrent ensuite et définitivement la conviction générale ; elles étaient dues à Denis Peyrony dont les fouilles en Périgord furent fondamentales pour l'établissement d'une chronologie stratigraphique renouvelée et encore en partie valide, et furent aussitôt mises en valeur par Henri Breuil qui en fit les relevés ; elles comptent, comme Lascaux, parmi les « géants » de l'art préhistorique pour reprendre le vocable d'Henri Breuil, avec leurs centaines de gravures (Combarelles) et de gravures et peintures (Font-de-Gaume) attribuées à la phase classique du Magdalénien.
Plaque réprésentant un Bouquetin, art magdalénien Plaque en calcaire gravée d'un bouquetin. Art magdalénien. Vers 12000 avant J.-C.
• Datations de l'art paléolithique
• Datations de l'art paléolithique
Lorsqu'un objet préhistorique est découvert en surface comme la « Vénus » de Sireuil (), hors de tout contexte stratigraphique ou culturel, son attribution reste conjecturale et, dans le meilleur des cas, ne repose que sur une comparaison morphologique et stylistique ; dans cet exemple, la ressemblance de la Vénus de Sireuil avec celle effectivement gravettienne de l'abri du Facteur à Tursac (voir) autorise à l'introduire dans l'ensemble des « Vénus gravettiennes » trouvées dans toute l'Europe jusqu'en Ukraine (Kostienki).
L'appartenance à une couche archéologique datée, soit relativement dans une séquence stratigraphique, soit absolument par le carbone 14, est bien entendu déterminante pour des blocs gravés ou sculptés comme ceux (V) du Roc de Sers (Charente), solutréens, ou pour tout objet d'art ; a fortiori lorsqu'il s'agit d'un type d'objets trouvés en de multiples exemplaires dans des gisements différents et plusieurs fois datés comme, par exemple, les figurines animales en « contour découpé » (Saint-Michel d'Arudy, voir), les rondelles osseuses perforées ( Mas-d'Azil, voir), les propulseurs sculptés (La Madeleine, Enlène - Trois-Frères, Bruniquel, voirIII), tous caractéristiques du Magdalénien moyen. En définitive, les milliers d'objets décorés ou sculptés trouvés en fouilles sont pour la plupart datés ou placés de façon valide dans la chronologie du Paléolithique supérieur étendu à l'Europe entière.
Il n'existe de datation directe de l'art pariétal que dans les cas d'un rapport stratigraphique dûment établi : une paroi décorée enfouie dans une (ou plusieurs) couche archéologique déterminée et datée, ou un élément décoré de paroi trouvé dans une couche archéologique également bien définie ; moins de dix grottes paléolithiques pourraient prétendre encore aujourd'hui à une datation de cette qualité ; la petite grotte à gravures fines sur calcaire concrétionné de la Mairie à Teyjat (Dordogne) serait de celles-ci ; elle est datée de la fin du Magdalénien. Les dessins aux traits rouges de la grotte de la Tête du Lion à Bidon (Ardèche), un bovidé, une tête de bouquetin et une de cerf, une nappe de points, sont pratiquement les seuls à être datés directement : en effet, des éclaboussures des colorants utilisés furent décelées sur le sol préhistorique à proximité d'un foyer, datés au 14C de 20 650 A 800 ans B.P. (laboratoire de Lyon, Ly. 848) : ils appartiennent donc au Solutréen ancien rhodanien.
Il arrive enfin que l'attribution chronologique soit avancée de façon incontestable lorsque le contexte archéologique trouvé dans la grotte ornée ou à son entrée le permet. La grotte de Fontanet (Ariège) dont l'entrée paléolithique fut bouchée naturellement, vraisemblablement à la fin du Paléolithique, contient des foyers datés, des outils, des restes osseux d'animaux consommés, ainsi que des empreintes humaines et animales, du Magdalénien moyen ; or c'est précisément à cette culture bien développée dans cette région pyrénéenne que renvoient toutes les comparaisons techno-stylistiques appliquées aux quelques dizaines de splendides gravures et peintures parfaitement conservées sur ses parois.
Les comparaisons techno-stylistiques et thématiques restent le dernier recours pour une éventuelle attribution chronologique et culturelle ; elles ne sont véritablement fondées que dans le cas d'une uniformité des représentations de la cavité concernée en correspondance avec une homogénéité culturelle régionale, par exemple Niaux () appartenant au Magdalénien de l'Ariège.
• Réflexions méthodologiques
L'analyse des colorants utilisés conjuguée à la recherche de leurs origines géologiques, les observations directes et photographiques en lumière normale, en infrarouge et en ultraviolet des tracés, des états de surface, de leur évolution, l'inventaire précis et rigoureux de toutes les représentations, y compris les tracés incomplets ou les vestiges, l'étude descriptive des cavités, de la localisation exacte des représentations et de tous les vestiges et traces qui s'y rencontrent ont complètement transformé la recherche préhistorique consacrée à l'art paléolithique et à sa conservation.Désormais, il apparaît clairement que les analyses, descriptions, inventaires et classifications doivent précéder les interprétations des représentations mobilières et pariétales ; il est plus fondé de faire apparaître ces documents dans tous leurs caractères propres et leurs liens archéologiques et chronologiques que de prêter à leurs auteurs, muets, nos discours et nos théories.
• L'art paléolithique dans son cadre géographique et paléoclimatique
La carte de répartition des principaux sites d'art paléolithique montre nettement la concentration de l'art pariétal dans l'ouest de l'Europe et la dispersion de l'art mobilier dans l'ensemble du continent jusqu'aux limites septentrionales définies par l'inlandsis polaire et celles des grands glaciers würmiens dans les Alpes. Les deux phénomènes artistiques sont partiellement concomitants, surtout pendant le Magdalénien, mais distincts. L'art pariétal est essentiellement celui des grottes situées en Aquitaine et dans les régions du littoral atlantique nord de l'Espagne ; quelques abris à l'air libre font exception dans cette zone. Il existe toutefois un nombre non négligeable de grottes ornées paléolithiques sur la Meseta centrale de la péninsule Ibérique jusqu'à sa façade méridionale, ainsi que quelques autres en Italie ; mais là, les traditions artistiques se différencient de celles de la région « classique », la région franco-cantabrique, comme celles d'ailleurs de sites périphériques français de l'Ardèche et du nord de la Loire. Les quelques peintures rouges découvertes en 1960 dans la grotte de Kapova dans l'Oural, mais insuffisamment publiées, sont demeurées isolées jusqu'à présent dans cette extrémité orientale de l'art paléolithique.Quelques courts épisodes tempérés, comme celui d'Arcy vers 31 000 ans B.P. ou celui de Lascaux (17 000 ans B.P.), s'intercalent dans la continuité climatique des deux derniers stades würmiens (35 000-10 000 ans B.P.) caractérisés par un froid rigoureux, particulièrement à la fin du stade III après l'oscillation tempérée de Tursac, entre 22 500 ans et 19 500 ans B.P. Faune et flore bien adaptées à ces conditions périglaciaires ne se modifient guère jusqu'au retrait de l'inlandsis et jusqu'au réchauffement humide inaugurant la période géologique actuelle, l'Holocène. En somme, les paysages pléistocènes offrent aux chasseurs paléolithiques des moyens de subsistance et des conditions de vie relativement stables et identiques pendant tout le temps d'éclosion de l'art paléolithique.
• Fonds technologique et cultures paléolithiques
La pratique systématique du débitage laminaire des nucléus de silex, l'invention d'outils ou d'armes en pierre mieux appropriés, la création d'un outillage diversifié en os et bois de renne donnèrent aux chasseurs paléolithiques des possibilités nouvelles et améliorèrent sensiblement leurs techniques d'approvisionnement. Mieux équipés, ils collectèrent plus aisément leur nourriture animale et végétale, en contrôlant davantage leurs prélèvements ; leurs habitats devinrent plus élaborés et témoignent souvent d'occupations plus denses, en rapport avec une certaine intensification démographique, au moins pendant le Magdalénien.C'est sur ce fonds technologique nouveau que furent distinguées les quatre grandes cultures d' Homo sapiens sapiens en Europe paléolithique. Les distinctions ont d'abord été faites à partir des industries et en fonction des données stratigraphiques par l'abbé Breuil notamment (1912) ; elles sont complétées de nos jours par les observations paléontologiques, paléoclimatiques et écologiques, ainsi que par les données spécifiques des formes d'art pariétal et mobilier.
L'art figuratif apparaît dans la plus ancienne culture reconnue d'Homo sapiens sapiens en Europe, l'Aurignacien, qui s'étendit dans toute l'Europe de l'Oural aux Asturies entre 33 000 et 26 000 ans B.P. Deux sites du haut Danube, Vogelherd et Hohlenstein-Stadel (Allemagne), ont livré notamment une demi-douzaine d'animaux et une statuette humaine masculine sculptés dans de l'ivoire de mammouth ; leurs caractères figuratifs parfaitement attestés interdisent de se référer à une quelconque « primitivité » pour les décrire. Un habitat de Basse-Autriche, Galgenberg, a fourni une figurine humaine en pierre d'une élégance comparable. Plusieurs gisements aurignaciens du Périgord, sensiblement contemporains, ont fourni également des documents mobiliers mais qui n'ont cependant pas les mêmes données figuratives. Au contraire, hormis un phallus sculpté dans une cheville osseuse de boviné, ce sont des objets présentant des motifs gravés abstraits, en particulier des alignements de petites cupules et de traits (abri Lartet, ) pour lesquels les chercheurs évoquèrent des systèmes de compte ou des calendriers.
Outre ces objets mobiliers en os, les Aurignaciens de la Vézère exécutèrent des représentations semi-pariétales sur des blocs et des dalles calcaires placés dans leurs abris rocheux. À l'exception du profil animal de Belcayre, les figurations animales, une dizaine, sont rudimentaires ; par contre, la quarantaine de représentations vulvaires sont soit réalistes soit déjà abstraitement formulées.
C'est l'image de la femme qui caractérise la majeure partie de l' art mobilier gravettien (30 000-21 000 ans B.P.). L'aire de répartition du Gravettien est identique à celle de l'Aurignacien, mais on note une extension tardive dans la péninsule italique et surtout une forte implantation, ancienne, en Europe centrale, particulièrement en Moravie.
À Dolni Vestonice et à Pavlov, les Gravettiens modelèrent avec la terre, qu'ils firent cuire ensuite, des dizaines de petites figurines animales : ours, félins, loups, mammouths, etc., et aussi une bonne trentaine de femmes. La plupart furent traitées selon le canon stylistique propre à tout le Gravettien : de lourds seins sur lesquels sont plaqués des avant-bras frêles ; des ventres rebondis et des volumes fessiers excessifs, des jambes courtes, potelées et séparées par un sillon médian prolongeant la fente vulvaire incisée ; elles rappellent, souvent fortement, la trentaine de statuettes russes (Kostienki, Gagarino), une partie de la trentaine de celles trouvées en France (Brassempouy, Lespugue, Laussel, ), et en Italie (Baoussé Roussé, ), et bien sûr celle proche de Willendorf (Autriche, ). D'autres statuettes moraves sont au contraire complètement schématisées ; un corps en baguette plus ou moins allongé portant deux lourds seins.
La Vénus de Willendorf La Vénus de Willendorf, art gravettien, 30000-25000 av. J.-C. Calcaire. Hauteur: 10, 4 cm. Musée d'Histoire naturelle, Vienne, Autriche.
Ces stylisations extrêmes des volumes corporels féminins (ni tête ni membres) dénotent une aptitude maîtrisée à l'abstraction qui se retrouve dans le Magdalénien : plusieurs dizaines de silhouettes féminines finement gravées dans des grottes (Combarelles, Vieux-Mareuil) et trois à quatre cents soigneusement gravées sur des plaquettes schisteuses du gisement du Magdalénien supérieur rhénan de Gönnersdorf sont réduites à une sorte de fuseau allongé ne faisant ressortir que le massif fessier et parfois les seins.
C'est également avec la plus grande vraisemblance que l'on date du Gravettien les gravures incisées profondément de Pair-non-Pair (Gironde) dont l'unique accès fut comblé précisément par des Gravettiens. Comme ceux des Pyrénées centrales et de l'Espagne cantabrique (Hornos de la Peña), les artistes gravettiens de Pair-non-Pair sont les premiers à avoir réalisé des représentations en grotte ; ce sont les créateurs de l'art pariétal souterrain.
Tandis qu'en Europe centrale, en Europe orientale, dans la péninsule italique, la civilisation gravettienne se maintient en se diversifiant, une nouvelle culture se répand au sud de la Loire et à l'ouest du Rhône en France, des Pyrénées aux Cantabres, et le long du littoral levantin de l'Espagne : le Solutréen ; sa durée est relativement courte, de 21 000 à 18 000 ans B.P. environ. L'art solutréen n'est pas abondant. Rares sont les habitats ayant livré de nombreuses œuvres mobilières, mais ils sont remarquables : la grotte du Parpallo (province de Valencia, Espagne) recélait plusieurs centaines de plaquettes gravées du Solutréen levantin ; dans les Cantabres, le porche monumental de la grotte ornée d' El Castillo contenait également de superbes gravures sur pierre et omoplates (des têtes de biches, notamment). Dans la grotte ornée d' Isturitz (Pyrénées-Atlantiques), les niveaux solutréens, moins riches en art mobilier que ceux du Magdalénien, livrèrent des ébauches de bas-reliefs.
Des sculptures monumentales sur bloc attestent, comme la fabrication d'outils en silex portée à la perfection, la maîtrise technologique des Solutréens pour la taille de la pierre. Au Fourneau-du-Diable (Dordogne), deux blocs sculptés et un bloc peint ont été découverts au milieu de l'occupation solutréenne ; sur l'un d'eux, de près d'un mètre cube, trois bœufs se détachent en bas relief d'autres représentations animales partiellement ébauchées.
Treize blocs sculptés, adossés à une falaise et disposés en hémicycle, dominaient l'habitat solutréen du Roc de Sers (Charente) ; bouquetins affrontés (), homme portant sur l'épaule un gourdin et fuyant un bison en pleine charge, chevaux (), bisons et rennes, tous vigoureusement exécutés en forts bas-reliefs, forment un des ensembles figuratifs les plus puissants du Paléolithique supérieur.
L'imprécision des datations laisse sans doute de côté quelques sites pariétaux gravettiens du Périgord et du Quercy ; vers l'est, outre le panneau de la grotte de la Tête du Lion à Bidon, on attribua au Solutréen inférieur les gravures de la grotte Chabot (Gard) qui abrita diverses occupations de cette période. Plusieurs ensembles pariétaux cantabriques sont probablement solutréens, en rapport avec l'art mobilier local ; la certitude est acquise pour les peintures et gravures de la grotte de Chufin (province de Santander) où un habitat du Solutréen supérieur fut récemment fouillé et daté (du XVIIIe millénaire).
Le Magdalénien fut la plus brillante et la plus puissante des civilisations du Paléolithique supérieur ; elle se développa dans le Tardiglaciaire (Würm IV) pour s'achever avec lui. À son début, vers 17 500 B.P., le Magdalénien est encore peu dense, du moins dans l'ouest de l'Europe ; dans sa phase moyenne (Magdalénien III et IV), la multiplication des habitats dans toute l'Europe révèle une forte intensification démographique et des poussées en quelque sorte impérialistes se traduisant par une diversification régionale des traditions technologiques et artistiques, aboutissant finalement à une mosaïque de cultures fortement différenciées dispersées sur toute l'étendue du territoire européen libéré progressivement de sa chape glaciaire septentrionale et montagnarde (XIe millénaire).
L'essentiel des instruments et outils décorés, des œuvres mobilières et pariétales est magdalénien ; dans bien des appréciations générales portées sur l'art paléolithique, il serait plus fondé de parler d'art magdalénien. Les artistes magdaléniens perpétuent les techniques et les modes d'expression paléolithiques qui reflètent avant tout la continuité des conditions écologiques et économiques de leur vie ; mais ils inventent des formes nouvelles et mènent à la perfection l'art de la gravure et de la sculpture d'objets () aussi bien que celui de la peinture et du dessin sur les parois des cavernes.
Quatre tendances stylistiques, pouvant être contemporaines, éventuellement simultanées dans les mêmes habitats ou dispositifs pariétaux, caractérisent l'art magdalénien : le décoratif, le schématique, l'abstrait et le figuratif.
Les motifs ornementaux décoratifs intéressent exclusivement de petits objets, le plus généralement des fûts de bois de renne ou des diaphyses de membres. Un rapport constant existe entre ces supports organiques allongés et étroits et des motifs spiralés, ocellés, ou multilinéaires toujours finement incisés ; selon les régions et les époques, la tendance décorative prit une ampleur remarquable, comme en témoignent par exemple les « baguettes demi-rondes » en bois de renne du Magdalénien moyen ().
L'art schématique magdalénien est lui aussi exclusivement mobilier ; il s'agit principalement d'une schématisation, parfois très poussée, de têtes animales vues de face ou de profil, d'animaux entiers de profil, en de rares cas de silhouettes humaines devenues « fantomatiques » (os gravé de Raymonden, ). Souvent, la répétition linéaire du même dessin schématisé aboutit soit à la création d'un ensemble décoratif, soit à l'élaboration de motifs géométriques complètement abstraits.
L'abstraction graphique caractérise pleinement l'art magdalénien, depuis ses phases les plus anciennes. Auparavant, seule une partie de l'art gravettien mobilier de Moravie avait atteint un niveau comparable. L'altération de motifs figuratifs par la voie de la schématisation conduite à son extrémité explique la plupart des dessins géométriques mobiliers sur os. Cependant, aucune dérivation graphique n'est à l'origine de la quasi-totalité des signes pariétaux et mobiliers qui constituent dans le Magdalénien un système de communication extrêmement complexe, original et nouveau. Alignements de points ou de traits, chevrons, cercles, ovales, rectangles vides et clairsemés, lignes ramifiées, grilles, angles, etc. ont été gravés par milliers sur des supports mobiliers, osseux et lithiques, gravés et peints par milliers sur les parois des grottes magdaléniennes. Exceptionnellement isolés, les signes furent parfois assemblés en panneaux sans aucune intrusion figurative comme à Fontanet et à Niaux en Ariège, à El Castillo () ou à La Pasiega dans la région de Santander.
Moins nombreuses que les signes, les représentations figuratives magdaléniennes ont davantage stimulé les commentaires soit par leur beauté, soit par leur étrangeté. L'art animalier magdalénien de Lascaux, d' Altamira, de Font-de-Gaume ou de Niaux, parmi des dizaines d'autres dispositifs pariétaux, atteint une perfection incontestée ; ses qualités esthétiques majeures sont la maîtrise totale du dessin reposant sur la reproduction fidèle des proportions anatomiques associée à l'invention de la perspective graphique, une technique picturale parachevée et le sens des compositions monumentales. À l'opposé, les figurations humaines magdaléniennes semblent répondre à des critères plus sémantiques que graphiques, à l'exception tout à fait notable de la centaine de femmes et d'hommes gravés en incisions fines sur des dalles calcaires mobiles de la grotte de La Marche (Vienne) dans des lacis de traits parfois extrêmement difficiles à débrouiller.
Les grottes solutréennes et gravettiennes ne sont guère profondes, et leurs dispositifs pariétaux rarement denses ; les Magdaléniens, au contraire, cherchèrent à pénétrer le plus profondément dans les cavités qu'ils choisirent et s'approprièrent en étendant au maximum la distribution de leurs représentations. Des galeries basses et tortueuses, à peine pratiquables comme celles des Combarelles ou de La Mouthe, ont été décorées jusqu'à leurs extrémités finales ; une partie des représentations disséminées dans de vastes réseaux, comme Niaux, La Cullalvera ou Rouffignac, se trouvent à plusieurs kilomètres des entrées empruntées par les Paléolithiques ; ailleurs, les Magdaléniens ont enfoui des représentations dans des diverticules exigus, imposant des reptations pénibles, mais accessibles à partir de vastes galeries aisées à parcourir (Mas-d'Azil, Bédeilhac...). En définitive, l'art pariétal souterrain est essentiellement magdalénien, expression totalement originale et unique d'une recherche de l'obscurité, absolue et intemporelle, à l'écart du vécu quotidien.
• Techniques et styles
L'utilisation de moyens techniques analogues et de supports naturels identiques pendant tout le Paléolithique supérieur donne une certaine uniformité techno-stylistique à l'art paléolithique et le distingue nettement d'autres formes artistiques préhistoriques.Sous le nom générique de « gravure », les préhistoriens ont coutume de rassembler les représentations réalisées soit par incisions, fines (), larges, profondes, à bords symétriques ou asymétriques, etc., soit par raclages, larges, superficiels (), profonds, etc., sur des supports résistants mais tendres comme des calcaires ou des tissus organiques animaux (sans doute aussi végétaux), avec des instruments plus durs et coupants tels des éclats de silex à bords bruts ou retouchés. Les quelques représentations gravées aurignaciennes sur blocs et dalles calcaires, obtenues par un martelage ou un bouchardage préalable à l'exécution d'un sillon continu, traduisent une technique exceptionnelle pour l'art paléolithique mais parfois fréquente en d'autres aires préhistoriques (une partie de l'art rupestre de la zone saharienne par exemple). Les gravures magdaléniennes sont infiniment plus nombreuses que les peintures ; leur conservation est certes meilleure que celle des peintures mais ce phénomène ne suffit pas à lui seul pour expliquer leur grand nombre ; par contre, il faut prendre en compte la facilité de manipulation d'outils simples, les dimensions des gravures plus réduites que celles des représentations peintes. Il convient toutefois de remarquer que certaines grottes possèdent exclusivement (ou presque) des gravures, Combarelles ou Les Trois-Frères par exemple, ou des peintures comme Niaux. Les tracés digitaux figuratifs ou non (Arcy) sont assimilés par analogie de forme aux gravures ; ils n'intéressent que des supports pariétaux tendres (argileux), le plus souvent mal conservés.
La « sculpture » paléolithique recouvre en réalité deux modes d'expression bien distincts : d'un côté la ronde-bosse, de l'autre les reliefs sur fond relativement plan. La statuaire paléolithique n'est jamais ni monumentale ni souterraine : les rondes-bosses sont petites, faites dans des matériaux tendres, faciles à tailler et à polir comme des ivoires, des os et des pierres calcaires ou schisteuses. Les bas-reliefs, les reliefs exhaussés sont, selon leur ampleur, une accentuation des gravures dans la recherche d'une troisième dimension ou le résultat d'une modification en profondeur du support osseux ou rocheux : de nombreux outils magdaléniens ont été ainsi sculptés ; une expression plastique comparable est parfois attestée sur des parois rocheuses de grottes (tête du grand cheval de Comarque, Dordogne). Cependant, les meilleures illustrations de sculpture pariétale atteignent presque le haut-relief, elles se trouvent dans des abris : Cap-Blanc (Dordogne) et Angles-sur-l'Anglin (Vienne) au cours du Magdalénien. Plus difficiles et plus longues à réaliser que les gravures, les représentations pariétales « sculptées » sont plutôt rares, toujours figuratives (animalières), œuvres des Solutréens et des Magdaléniens.
Sous la rubrique « peinture », plusieurs types de représentations sont groupés, non sans quelque abus ou imprécision. Le caractère commun est celui de l'apposition sur un support lithique ou osseux de matières colorantes d'origine minérale (oxydes ferriques, manganèse, kaolin, argile) directement prélevées dans les sols ; les matières colorantes d'origine végétale, si elles furent employées, ne se sont pas conservées, à l'exception, quelquefois vérifiée, de charbons ( Niaux). Sur le plan technique et plastique, il y a lieu de distinguer les dessins, faits au trait, des peintures proprement dites, exécutées en aplats monochromes ou bichromes, avec ou sans contour tracé séparément. Les animaux du Salon noir de Niaux (), ceux plus anciens de la « frise noire » () de Pech-Merle (Lot) offrent les qualités les plus parfaites de l'art du dessin pariétal comme les chevaux d'Ekaïn (Espagne), les bisons de Font-de-Gaume ou d'Altamira, les taureaux et chevaux de Lascaux sont à l'apogée de l'art pictural des grottes magdaléniennes.
Taureau et chevaux, Lascaux Taureau et chevaux, peintures magdaléniennes (15 000 ans av. J.-C.) dans la grotte de Lascaux, en Dordogne, France.
Les expérimentations récemment faites sur les matières colorantes et les problèmes posés par leur application ont permis de comprendre et d'imaginer avec vraisemblance l'exécution des dessins paléolithiques ; en bien des cas, l'utilisation de « crayons » naturels d'ocre ou de manganèse, de « fusains » est clairement attestée ; l'emploi de pinceaux, faits de végétaux ou de poils, est moins nettement mis en évidence. Les figures peintes posent le problème de la préparation des colorants, de leur application et de leur fixation dans des conditions parfois défavorables (verticalité des supports, humidité ambiante). Des liants adjoints aux poudres, il ne reste aucune trace décelable ; la technique du soufflage est envisageable pour certaines peintures, comme les mains négatives, mais elle semble avoir été rarement employée. L'application au tampon de colorants est incontestable pour des représentations du Magdalénien ancien de Lascaux ou du Pech-Merle (). L'utilisation parfois invoquée de caches ou de patrons n'a pu être indubitablement vérifiée, mais paraît possible à Lascaux où les artistes ont su introduire une vision en perspective par le procédé de l'épargne : en ménageant par exemple un espace entre le corps peint de l'animal et la patte située en arrière-plan. Quelques vestiges pariétaux ocrés de l'Aurignacien, les rares représentations peintes qui sont conservées du Gravettien, le cheval de l' abri Labattut, notamment, montrent l'ancienneté de la technique picturale dans les abris du Périgord ; ce qui n'a rien de surprenant si l'on considère la longue tradition de l'emploi de l' ocre rouge dans des habitats et des sépultures du Paléolithique moyen et du début du Paléolithique supérieur. L'utilisation de colorants au cours du Solutréen est peu attestée dans les quelques sites reconnus. En fait, peintures et dessins sont principalement magdaléniens, surtout de la phase ancienne et moyenne, en France et en Espagne ; leurs qualités graphiques et plastiques équivalent à celles des gravures avec lesquelles les colorants sont parfois très délicatement associés.
André Leroi-Gourhan, en s'appuyant sur de meilleures approximations chronologiques, en insérant plus largement et plus précisément les données techno-stylistiques de l'art mobilier dans son analyse des représentations pariétales, aboutit en 1965 à une classification beaucoup plus fine et archéologiquement mieux fondée que celle de son prédécesseur. L'étude des contours cervico-dorsaux, de l'implantation des appendices céphaliques, des éléments graphiques internes comme le dessin de la croix scapulaire de certains chevaux, l'observation détaillée des modes de perspective lui permirent de distinguer cinq styles, parcourant une sorte de trajectoire continue et progressive d'un stade 0 « pré-figuratif » à un stade IV récent très élaboré, à la fin du Magdalénien : au Châtelperronien correspond la période pré-figurative, à l'Aurignacien le style I, au Gravettien et à l'Inter-Gravetto-Solutréen le style II, au Solutréen et au Magdalénien ancien le style III et au Magdalénien moyen et récent le style IV. Ainsi était surmonté le problème incompréhensible que posait la rupture entre deux cycles imaginée par H. Breuil ; ainsi était affirmée l'idée d'un progrès continu des formes figuratives vers une sorte d'académisme visuel ou photographique magdalénien.
Alors que le recul donné au préhistorien lui permet, en considérant l'archaïsme graphique de profils d'animaux gravettiens et l'élaboration parfaite d'animaux magdaléniens, de parler globalement d'une évolution stylistique de l'art pariétal et du mobilier paléolithique, rien ne l'autorise à induire une parenté généalogique de ces styles qui appartiennent à des cultures différentes les unes des autres et sans liens directs. Plus qu'une succession ordonnée de stades faisant supposer un parallélisme étroit entre chronologie et style, invraisemblable sur un espace et pour une durée aussi considérables, les travaux postérieurs à 1980 tendent à distinguer un premier ensemble, pré-magdalénien, fort disparate, groupant les styles I à III définis par André Leroi-Gourhan d'un second ensemble, magdalénien infiniment plus homogène et fourni, groupant les styles IV ancien et récent selon Leroi-Gourhan, mais offrant des diversifications stylistiques régionales notables. Dans le premier groupe, les séries stylistiques sont souvent trop faiblement représentées et datées pour qu'il soit possible de dégager des normes stylistiques générales valides, à l'exception sans doute des Vénus. Par contre, il est possible, au sein du Magdalénien, de distinguer des courants, des traditions, en rapport avec des objets ou des thèmes propres à certaines époques et régions culturelles : nul ne confondrait les bisons et chevaux des grottes pyrénéennes avec ceux, contemporains, des cavités périgourdines, alors que les mêmes moyens techniques furent utilisés.
• Interprétations de l'art paléolithique
Avant les premiers grands travaux de l'abbé Breuil, au début de ce siècle, peu de grottes avaient été étudiées et décrites, de sorte que les appréciations théoriques concernaient principalement les objets découverts en fouille. Peu à peu s'était dégagée l'idée que l'homme préhistorique avait été un artiste authentique, qu'il avait créé des œuvres d'art, et que, finalement, ces objets et statuettes témoignaient de son goût pur pour le beau : la théorie de « l'art pour l'art » vint ainsi en premier caractériser les œuvres préhistoriques et imposer le vocable « art préhistorique ». Passablement anachronique et peu convaincante, cette interprétation s'étiola rapidement avec les découvertes des représentations pariétales souterraines, la recherche du beau dans l'obscurité totale et des conditions de vie hostiles ne correspondant pas à ce qu'imaginaient les apôtres de l'art pour l'art.Le vaste déploiement ethnographique des chercheurs européens dans le monde primitif influença fortement les préhistoriens du xixe siècle qui pensaient que les primitifs d'hier et ceux d'aujourd'hui étaient semblables. Cette hypothèse s'est révélée fausse tant en raison de la diversité des formes anthropologiques et culturelles que des phénomènes évolutifs propres et des variations climatiques et écologiques, mais elle introduisit alors l'idée que l'art préhistorique était magique ou que la magie était à son origine. Les statuettes féminines, avec leurs ventres énormes et leurs seins pendants, évoquaient à ces interprètes une magie de la « fécondité » orientée vers un culte de la « déesse mère », le moindre abdomen ballonné de cheval pariétal en faisait une jument mère tandis que les signes angulaires en V, avec ou sans axe médian, devenaient des « flèches » meurtrières pour expliquer une magie propitiatoire de la chasse.
En vérité, si l'image de la femme est un des paradigmes constants de la thématique paléolithique pariétale et mobilière, il est tout aussi clair que sa diversité morphologique ne correspond pas à une univalence symbolique ; en d'autres termes, la sexualité, la féminité, le matriarcat, etc. sont tout aussi envisageables que le fut la fécondité. De même, la magie de la chasse est bien peu imaginable si l'on note, comme le firent par la suite Max Raphaël et A. Leroi-Gourhan, que bien peu d'animaux sont « blessés » ou atteints de « flèches » et ce dans quelques grottes seulement ; en outre, les comparaisons précises entre la faune figurée et la faune chassée d'un même site indiquent sans conteste qu'une partie au moins des deux ensembles n'est pas commune : un seul renne a été figuré sur les parois de Lascaux parmi des centaines de chevaux, bovins, cerfs ; les neuf dixièmes des débris osseux trouvés dans la grotte proviennent de rennes, peut-être consommés par les artistes eux-mêmes.
Pendant plus d'un demi-siècle, l'abbé Breuil contribua directement aux découvertes de représentations mobilières et pariétales et à leur étude descriptive ; son œuvre, couronnée par une publication fameuse en 1952, Quatre Cents Siècles d'art pariétal, fut véritablement constitutive de la connaissance de l'art préhistorique, au moment même où les fouilles qui se multipliaient lui permirent d'établir les « subdivisions du Paléolithique supérieur » sur des bases chronostratigraphiques bien établies. Le comparatisme ethnographique pratiqué à l'époque des premières grandes découvertes de grottes ornées en Dordogne et en Espagne cantabrique est à la source des interprétations des représentations abstraites et figuratives faites par H. Breuil. Lui aussi invoque l'envoûtement magique d'animaux à chasser pour la survie de la communauté, la sublimation de la fécondité pour sa pérennité. Cependant, en bon dessinateur, il perçoit et met en valeur la beauté des animaux dont il ne trouve aucun équivalent dans d'autres arts préhistoriques et primitifs. Son concept du « grand art animalier occidental » le conduit à attribuer une certaine spiritualité à l'art pariétal, à imaginer des cérémonies initiatiques et à prêter un pouvoir surnaturel à des images extraordinaires comme le grand être mi-humain mi-animal peint et gravé, placé au-dessus des centaines d'animaux et signes gravés du « sanctuaire » de la caverne des Trois-Frères, qu'il baptise « Dieu cornu » ().
Pour expliquer les signes géométriques nombreux accompagnant les animaux dessinés dans un style « naturaliste », H. Breuil tente des rapprochements morphologiques avec des armes, des embarcations, des huttes utilisées dans des sociétés primitives actuelles. Des signes du Périgord sont appelés « tectiformes » par analogie avec des huttes et donc des toits (voir illustration concernant la grotte de Font-de-Gaume) ; d'autres, plus simples, des Pyrénées magdaléniennes, sont des « claviformes », par analogie avec des massues ; il existe aussi des « naviformes », des « scutiformes », etc. Finalement, l'interprétation de H. Breuil se fait en termes de réalisme visuel et rationnel : les hommes du Paléolithique supérieur agissaient et pensaient comme les Pygmées, les Bororos ou les Esquimaux..., mais ils peignaient et dessinaient mieux...
Dans un écrit pulié en 1945, Prehistoric Cave Paintings, mais qui resta ignoré en France jusqu'à sa publication en français en 1986, le théoricien de l'art allemand Max Raphaël s'écarta résolument de ce type d'interprétation rationaliste et ethnographique de l'art paléolithique en tentant de montrer que les représentations dans les grottes n'avaient pas été accumulées au gré de fantaisies ou d'expéditions de chasse mais qu'elles furent organisées, agencées délibérément en panneaux ou en files sur les parois souterraines. Ainsi tenta-t-il de comprendre la composition d'ensembles clairement organisés comme le grand plafond d' Altamira et l'interpréta-t-il en termes de totémisme. Cette idée de l'organisation pariétale des représentations changeait radicalement la conception de l'art paléolithique, de sa fonction sociale et de la mentalité prêtée aux artistes préhistoriques, plutôt occidentale et teintée d'exotisme ; cette idée est à la base des interprétations parallèles développées par Annette Laming-Emperaire dans son ouvrage La Signification de l'art rupestre paléolithique (1962) et surtout, par A. Leroi-Gourhan, Préhistoire de l'art occidental (1965).
Avec des orientations différentes assez marquées et des approches menées séparément, ces deux préhistoriens émirent l'hypothèse d'une bipartition sexuelle initiale sous-jacente à l'organisation des sanctuaires paléolithiques. Un principe « mâle » et un principe « femelle » formeraient une « dyade » (A. Leroi-Gourhan) fondamentale autour de laquelle se déploie l'ensemble des autres espèces et des signes représentés. L'hypothèse repose sur l'enregistrement statistique partiel (environ une soixantaine de grottes pour A. Leroi-Gourhan) des représentations pariétales en fonction de leurs « associations » spatiales – juxtaposition, proximité, éloignement, isolement – de leurs localisations dans les grottes – entrées, fonds, galeries. En effet, deux espèces leur apparurent majeures tant sur le plan quantitatif que sur celui de leurs localisations centrales dans les panneaux et ensembles structurés : le cheval et le bison. Des associations entre quelques représentations féminines et des bisons, considérées différemment, aboutirent à des interprétations inverses et croisées : A. Laming-Emperaire fit du bison un principe mâle, par complémentarité ; A. Leroi-Gourhan un principe femelle par identité. Mais l'une et l'autre interprétations renvoient à une même vision cosmogonique de l'univers paléolithique et de son expression pariétale.
L'interprétation du système des signes fut développée par A. Leroi-Gourhan à partir de 1958 ; il les considéra comme des « idéogrammes » et non comme des reproductions d'objets ou d'armes et les classa d'abord en deux groupes : celui des « signes pleins » et celui des « signes minces » ; par la suite, il créa un troisième groupe pour les signes ponctués qui, des points de vue morphologique et thématique (les associations), se distinguaient des autres. Comme il avait enregistré une association préférentielle des bisons et des chevaux dans les grottes, A. Leroi-Gourhan tenta de mettre en relief l'existence d'un couplage de signes minces avec des signes pleins, par exemple de bâtonnets ou de barres avec les rectangles ou des motifs ovoïdes. En s'appuyant sur l'analogie des formes et le parallélisme des associations, A. Leroi-Gourhan interpréta ce couplage comme la répétition, abstraite, de la dyade sexuelle figurée par les bisons et les chevaux, de sorte qu' une totale homogénéité symbolique caractérise les sanctuaires paléolithiques dans son analyse.
En inventoriant avec précision les représentations pariétales, en considérant avec soin les associations thématiques répétitives et fréquentes, en analysant les grandes compositions, A. Leroi-Gourhan, beaucoup plus distinctement encore que A. Laming-Emperaire et que M. Raphaël, démontra que les sanctuaires paléolithiques offraient une organisation élaborée, exprimant une conception complexe de l'Univers : l'art paléolithique était enfin considéré comme une sorte de langage, qui éclairait d'intelligence les cavernes obscures.
• Contenus et constructions symboliques
Pour quelques dizaines de milliers de représentations, on dénombre moins d'une dizaine de « scènes », c'est-à-dire d'associations spatiales de figures ayant explicitement un sens narratif : ours et hommes deux ou trois fois confrontés sur os ou plaquette (), bison attaquant l'homme comme sur le bloc sculpté du Roc de Sers et sur une paroi de la grotte de Villars (Dordogne), sans doute contemporaine de Lascaux où le « puits » recèle la scène la plus complexe : un chasseur à tête d'oiseau, entouré de signes et culbuté par le bison qu'il vient d'éventrer.Aucune scène de chasse, de guerre, de rapports sexuels (humains ou animaux), de danse n'existe dans l'art paléolithique, alors que d'autres arts préhistoriques incluent, en proportions parfois élevées, ce type de récits graphiques. L'art paléolithique est un art codé ; il n'est pas une illustration du monde vivant – l'absence totale de paysages et de végétaux ainsi que de références à une quelconque réalité domestique (ni outil, ni instrument, ni arme) renforce cette mise à l'écart du réel vécu, parfaitement révélée par le choix d'un lieu souterrain, clos, obscur. Les grottes paléolithiques sont des réceptacles de symboles qui n'existent que pour ceux qui les connaissent et qui y accèdent.
Animaux et humains constituent exclusivement le stock des représentations figuratives, de façon bien distincte. Les figures animales ont, dès l' Aurignacien (mobilier) et le Gravettien (pariétal et mobilier), tous les attributs figuratifs, amplifiés et détaillés ensuite par les Solutréens et les Magdaléniens. Sauf de rares représentations hybrides, ou monstrueuses, les animaux figurés sont à l'image des animaux réels ; les artistes magdaléniens ont même régulièrement donné à leurs bêtes des attitudes ou des allures conformes à ce qu'ils voyaient dans la nature : la proximité des hommes du Paléolithique supérieur avec les animaux est manifeste et témoigne de la place fondamentale occupée par les animaux dans la vie quotidienne des hommes et donc dans leurs rêves et leurs mythes. On se souvient que les représentations humaines sont étranges, particulières ou segmentaires : symboles sexuels féminins, rarement masculins, fréquents dans l'Aurignacien et le Magdalénien, silhouettes et statuettes stylisées, visages déformés, êtres fantomatiques et composites, mains négatives. Les règles suivies pour représenter l'animal et l'homme pendant le Paléolithique sont antinomiques, tandis qu'elles sont souvent identiques dans d'autres cultures préhistoriques, en particulier quand se développe le schématisme.
Les signes paléolithiques abondent et offrent une diversité morphologique importante, inégalée ailleurs : plusieurs dizaines de types, en grande majorité magdaléniens, recouvrant des structures élémentaires, comme le point ou le tiret, et des structures complexes, tels les grands signes quadrangulaires à remplissages croisés de la région cantabrique. Il est difficile de distinguer des signes dans l'Aurignacien, tels qu'on les conçoit à partir des types magdaléniens ; les groupes de cupules creusées dans des dalles calcaires et simulant des empreintes de carnassiers ont peut-être une fonction symbolique issue du figuratif et orientée vers une abstraction purement géométrique. Les quelques grottes gravettiennes connues n'offrent pas davantage de signes, alors que les thèmes animaliers et, sans doute, les mains négatives y sont bien représentés : des traits rectilignes non organisés dans des panneaux de Pairnon-Pair, de Gargas sont des témoins graphiques trop frustes pour être retenus. Des traits gravés élémentaires, des signes ponctués peints sont bien attestés dans certaines grottes rhodaniennes attribuées au Solutréen ( Chabot, Tête du Lion) ; ils forment un corpus encore réduit de représentations abstraites, complètement absentes des dispositifs pariétaux solutréens en abri.
La variété et la quantité des signes pariétaux magdaléniens permettent de distinguer au moins trois familles de types : les signes élémentaires ponctués, les signes élémentaires linéaires et les signes géométriques élaborés. Le type point et ses dérivés que sont les alignements simples ou doubles, les nappes, etc. sont peints – il est peu commode en effet de graver un point –, généralement en rouge dans les grottes des Pyrénées, des Cantabres et, plus modérément, au Périgord ; ils sont plus souvent placés dans des galeries servant de passage que dans des salles concentrant des représentations animales. Les types linéaires simples (tiret, bâtonnet, barre) et leurs dérivés (paire, alignement, groupement, etc.) sont aussi abondants et omniprésents que les signes ponctués ; peints – plutôt en noir – ou gravés, ils intéressent autant les salles que les galeries et sont fréquemment liés aux animaux.
Les signes élaborés n'ont ni la fréquence ni la distribution des signes élémentaires. Les types les mieux définis appartiennent à une seule région, voire à quelques grottes réalisées simultanément dans une phase culturelle sans nul doute brève : Cougnac (Dordogne) et Pech-Merle sont, par exemple, les seules grottes à posséder de grands signes rectangulaires étroits à appendices externes, absolument identiques et symboliquement placés à proximité de figurations humaines. Il arrive aussi fréquemment que des dispositifs pariétaux intègrent, en un nombre limité d'exemplaires ou même en un unique exemplaire, un ou plusieurs types de signes qui leur sont propres : grands signes rouges du Portel (Ariège), naviforme rouge de Font-de-Gaume, etc.
Les théories interprétatives développées jusqu'à ces dernières années en considérant l'art paléolithique dans la totalité de son extension et de sa durée ont présupposé qu'il était homogène dans ses significations : il suffit pourtant de considérer simplement l'extrême discrétion des signes au cours du Solutréen, leur absence auparavant, leur abondance pendant le Magdalénien, pour concevoir clairement que l'on ne peut mettre en équivalence symbolique les dispositifs pariétaux, très construits, du Magdalénien avec ceux, réduits, du Gravettien ou ceux, particuliers, du Solutréen. De même, la diversification typologique régionale et locale de signes élaborés magdaléniens atteste de telles expressions symboliques différentes et particulières, qu'il n'est plus envisageable d'adopter un seul système explicatif. Les études détaillées des grottes, conduites ces dernières années avec des moyens d'observation et d'enregistrement très supérieurs à ce qu'ils étaient, mettent en évidence la parfaite originalité de la construction symbolique de chaque dispositif pariétal, même lorsqu'il s'agit de dispositifs (au sein d'une même grotte ou appartenant à plusieurs grottes) possédant une majorité de thèmes figuratifs et abstraits semblables ; l'exemple des quatre grottes à tectiformes du Périgord est particulièrement net sur ce point : à Bernifal, le panneau central est situé dans le passage le plus étroit de la cavité, à mi-chemin du parcours : il est gravé de quatre ou cinq mammouths, placés au centre et surchargés d'autant de tectiformes ; à la périphérie : un bison, un renne avec tectiforme juxtaposé et, en marge supérieure, un signe ovoïde, identique à ceux qui sont gravés sur la paroi opposée, et associés à d'autres tectiformes, et un signe en grille. Aux Combarelles comme à Rouffignac, les quelques tectiformes représentés sont placés plutôt à l'écart des animaux : plus de cent vingt chevaux aux Combarelles, disposés tout au long de la galerie auxquels s'associent sporadiquement quelques dizaines de rennes, mammouths, bisons, bouquetins, cerfs, lions et rhinocéros et une quarantaine de profils féminins schématisés et discrets. Rouffignac est célèbre pour ses quelque cent cinquante mammouths qui dominent partout les assemblages où l'on retrouve chevaux, bisons, bouquetins et même des rhinocéros laineux. Dans des panneaux superbement composés et des files majestueuses, Font-de-Gaume offre aussi tous ces thèmes animaux : bisons en premier, toujours mis en valeur par les peintres, puis chevaux, mammouths, rennes, caprinés, félins et même un rhinocéros dans son étroit diverticule final. Des centaines de signes gravés ou peints se mêlent à ce bestiaire, dont une bonne vingtaine de signes tectiformes. Ceux-ci se trouvent associés au cheval, dans un panneau gravé de la galerie d'accès, plusieurs fois aux bisons, dans la galerie principale, et sont alors peints en rouge, ou encore isolés, dans les galeries latérale et terminale. On constate que, dans ces quatre dispositifs pariétaux magdaléniens, les mêmes grands thèmes figuratifs et abstraits ont été choisis mais ils furent différemment placés et reliés entre eux pour privilégier, notamment, des couples mammouth-tectiforme au centre de Bernifal, bison-tectiforme au centre de Font-de-Gaume, cheval-autre animal aux Combarelles, mammouth-autre animal à Rouffignac. En d'autres termes, les thèmes sont en partie communs, mais chaque dispositif pariétal est original ; chacun reflète la symbolique propre du groupe qui l'a créé, tout en participant de la culture à laquelle il appartient. C'est en considérant cette double propriété de chaque grotte d'être à la fois originale et paléolithique qu'on s'oriente vers une meilleure compréhension des significations à travers leurs manifestations symboliques, c'est-à-dire les représentations et leurs distributions sur les parois souterraines. D'un sanctuaire à un autre, les significations varient au gré des choix et des liaisons thématiques ; elles se profilent sur l'horizon de l'univers paléolithique et s'en détachent pour créer des cosmogonies nouvelles où se rencontrent symboliquement les animaux et les hommes.
Denis VIALOU
• Les arts postglaciaires
Après la dernière glaciation, une période de huit mille ans a vu l'humanité transformer son économie, ses techniques et son environnement de la façon la plus radicale, passant de la prédation à la production alimentaire et de la taille du silex à la fonte des métaux ; dans cette même période, les petits groupes d'archers mésolithiques perdus dans l'immense forêt d'Europe devaient faire place aux sociétés fortement structurées des aristocraties barbares de l'Âge du fer. Aussi les arts postglaciaires, contrairement à l'art des cavernes, ne présentent-ils aucune unité ; ils regroupent de façon artificielle l'art mésolithique, les peintures rupestres du Levant espagnol, l'art dolménique, l'art arctique, les statues-menhirs de la Corse, les gravures rupestres du mont Bego et du val Camonica, etc.La limite chronologique indiquant la fin des arts postglaciaires, qui devrait être marquée par l'irruption de l'écriture, est parfois assez floue, en raison de la nature de certaines de leurs manifestations, en particulier des graffiti rupestres parmi lesquels il est souvent malaisé de faire la distinction entre les tracés protohistoriques et ceux qui appartiennent à la période historique.
L'art mésolithique
L'expression « arts postglaciaires » ne devrait s'appliquer qu'aux manifestations artistiques des cultures préhistoriques postérieures à la fin de la dernière glaciation (— 8000) ; en fait, les profonds bouleversements culturels qui marquent les trois derniers millénaires de la glaciation de Würm, entre — 11000 et — 8000, comprennent une mutation du langage esthétique qui privilégie, dans la majeure partie de l'Europe, l'expression schématique et géométrique aux dépens des représentations figuratives prépondérantes dans l'art des cavernes ; c'est pourquoi il semble paradoxalement logique d'inclure dans les arts postglaciaires les productions de l' Azilien et des autres cultures épimagdaléniennes (Épipaléolithique ou Mésolithique ancien), pourtant bien ancrées dans la fin de la dernière glaciation.Les arts mésolithiques ont leur originalité propre et montrent une relative unité ; si l'on place dans le Mésolithique les cultures qui ne sont plus vraiment paléolithiques et pas encore nettement néolithiques, les arts de cette période s'étendent donc sur huit mille ans, des environs de — 11000 à ceux de — 3000.
Les arts du Mésolithique ancien
Dans les niveaux de l'extrême fin du Magdalénien de l'abri Morin (Pessac-sur-Dordogne, Gironde) ou du tout début du Mésolithique ancien (Laborien) de la Borie del Rey (Blanquefort-sur-Briolance, Lot-et-Garonne), des figurations semi-schématiques de bovidés, tracées sur des os, sont hachurées de fines incisions parallèles ; ce mode de représentation évoque celui des animaux de la grotte de Gouy (Seine-Maritime), ornée à l'extrême fin du Paléolithique supérieur, ainsi que celui des silhouettes féminines schématiques à remplissage strié ou quadrillé du gisement magdalénien de Gönnersdorf, près de Neuwied en Rhénanie. Après ces ultimes œuvres figuratives des environs de — 9000, le contour identifiable disparaît et seules subsistent des hachures, des stries et des faisceaux de traits énigmatiques.Ces tracés, qui existaient dans l'art de l'Âge du renne, se développent parfois avec une grande complexité ; dans la grotte du Thaï (Drôme), associée à une industrie de type azilien (vers — 10800), une côte porte des incisions parallèles barrées interprétées par A. Marschack comme étant un système de notation (calendrier ?). Un peu avant — 10000, dans les Landes et les Pyrénées, commence à se développer l'art dit « azilien » ; la couche 4 de l'abri Dufaure à Sordes l'Abbaye, où une industrie de type azilien est encore associée au renne (Dryas II ou tout début d'Alleröd), a livré en effet deux galets gravés de motifs simples. Le gisement éponyme de l'art azilien est la grotte du Mas d'Azil (Ariège) où, dans les couches datant de l'Alleröd et du Dryas III, un millier de galets ornés ont été découverts ; ce sont des galets oblongs, longs de 40 à 70 mm, larges de 20 à 30 mm et épais de 6 à 9 mm, portant des barres, des points de peinture rouge, des incisions peu profondes pouvant se combiner en associations variées et complexes. Il en a été trouvé dans trente-sept gisements qui montrent, du XIe au VIIIe millénaire, une unité artistique réelle dans le choix des supports et la conception des œuvres, depuis l'Espagne cantabrique jusqu'au nord de la Suisse ; ils se situent dans le même courant interculturel d'azilianisation qui se manifeste dans des industries d'origines différentes.
Le Mésolithique provençal semble évoluer en dehors de ce courant ; les niveaux montadiens de l'abri Cornille (Istres, Bouches-du-Rhône), VIIIe millénaire, contiennent de l'ocre et un galet ocré ; à la Montade et à Ventabren (Bouches-du-Rhône), des galets sont gravés de cercles réguliers.
L'art du Mésolithique moyen et récent
Dans le Montclusien de la Baume de Montclus (Gard), vers — 6000, des galets cylindriques ont été découverts plantés verticalement et formant un cercle d'un diamètre de 0,50 à 0,80 m.Dans une couche castelnovienne (vers — 5000), une grosse pierre verte peinte en rouge reposait sur une sépulture ; à Châteauneuf-lès-Martigues (Bouches-du-Rhône), la paroi de l'abri a probablement été peinte en rouge par les premiers occupants castelnoviens ; ceux-ci ont abandonné un petit fragment (2 cm de long) d'os calciné portant un décor géométrique en zigzag et un galet de schiste gravé sur les deux faces de motifs géométriques triangulaires, planté verticalement dans le sol comme ceux de Montclus. Dans le Bassin parisien, il existe de rares abris gréseux ornés au Tardenoisien (Ve-IVe millénaire) ; J. Hinout y a découvert dans les sols d'habitat, au pied des parois décorées, les outils émoussés en grès ou en silex qui ont servi à graver des grilles et des sillons et l'ocre avec laquelle ont été peintes des rangées d'ovales ; le mobilier comporte parfois des plaquettes lithiques gravées ou portant des taches d'ocre.
Des fragments d'ocre gros comme des pois ont été trouvés dans tous les niveaux de l'abri de Birsmatten (canton de Berne, Suisse), mais plus particulièrement dans ceux du Boréal (vers — 6000), où ce colorant enduit des pierres et des galets plats ; un fragment de côte décoré sur les deux faces d'un quadrillage incisé provient des niveaux du Mésolithique final (— 4000 ?). Dans les gisements du Mésolithique final breton de Téviec et de Hoëdic datés de 4600 avant J.-C., quatre stylets en os, déposés dans des sépultures, sont ornés de courtes incisions parallèles, se répétant rythmiquement par groupes de trois ou quatre ; deux autres objets funéraires en os portent des hachures croisées. À Volkerak (Pays-Bas), à l'entrée du Hollandsch Diep, une petite statuette anthropomorphe en bois, découverte dans la tourbe en dehors de tout contexte archéologique, a été datée de — 4500 ; elle est vraisemblablement mésolithique.
L'art mésolithique nordique
L'art maglemosien scandinave (entre — 7600 et — 5600) est connu par une centaine d'objets décorés ; il consiste principalement en motifs géométriques sur des outils en os, ou en bois de cerf, sur l'ambre et le cortex des éclats de silex ; une tête d'élan en ambre découverte à Egemarke (Danemark) est une des œuvres les plus remarquables de cette culture.Pendant la culture de Kongemose qui lui fait suite (entre — 5600 et — 5000), l'art s'exprime également sous forme de décors géométriques de points et d'incisions associés en compositions complexes et par quelques œuvres figuratives : rares représentations humaines et animales schématiques ; les supports de ces décors sont, comme au Maglemosien, les pendeloques en ambre et les poignards en os à rainures, auxquels s'ajoutent les haches en bois de cerf ; le célèbre petit ours en ambre du Jutland (musée de Copenhague) porte un décor complexe typique de cette culture.
L'art de l' Ertebolle (entre — 4600 et — 3200) ne marque pas de rupture avec celui de Maglemose et de Kongemose ; il consiste en décors géométriques pointillés formés de lignes de petits trous très régulièrement creusés à l'aide d'une drille. Une pagaie de bois découverte à Tybring Vig (Danemark) est décorée d'incisions linéaires symétriques remplies d'une matière brune qui n'est pas encore identifiée, selon une technique jusqu'alors inconnue. Vers 3600 avant J.-C., le décor disparaît des objets d'os et de bois de cervidé.
Un courant interculturel comparable à celui de l'Azilien confère une unité certaine à l'art des diverses cultures des pays baignés par la Baltique ; il fut naguère qualifié abusivement d'« art maglemosien ». Au nord de la Russie d'Europe, l'industrie en os de la culture Kunda (entre — 7600 et — 3000) est souvent ornée de fins décors géométriques ou zoomorphes (tête d'élan d'Oleni Ostrov) qui évoquent l'art maglemosien. Certains des objets en bois du gisement de Vis 1 (dans la région du lac Sindor, à l'est d'Arkhangelsk, Russie ; vers — 6000), appartenant également à la culture Kunda, portent des ornements géométriques formés de lignes de points ; une tête d'élan, sculptée sur un ski, la plus vieille sculpture en bois connue, constitue le thème central d'un répertoire iconographique qui s'étend de la Norvège à l'Oural.
Michel ORLIAC
Abris peints du Levant espagnol
L'art paléolithique espagnol disparut, comme en France, après sa grande phase magdalénienne, brillante et dense, durant la fin de la glaciation würmienne. Cependant, à la différence d'autres régions d'Europe occidentale, la péninsule Ibérique garda vivace pendant plusieurs millénaires une tradition d'art pariétal, en plein air, dans le Levant, vaste région montagneuse s'étendant de l'embouchure de l'Èbre à la province méridionale d'Almeria. Depuis les premières découvertes du début du siècle, Calapata, Cogul, Minateda, auxquelles participèrent des préhistoriens espagnols, comme Juan Cabré Aguilo, Eduardo Hernández Pacheco, et étrangers, en particulier Henri Breuil et Hugo Obermaier, plus de deux cents abris à peintures ont été inventoriés et étudiés (Antonio Beltrán, Lya Dams).La plupart des abris sont situés entre 800 et 1 000 mètres d'altitude sur des versants montagneux et des canyons facilement accessibles et généralement proches du littoral méditerranéen (à moins d'une cinquantaine de kilomètres) ; les circulations des hommes préhistoriques furent donc toujours aisées dans ces régions. À l'exception d'abris gréseux rougeâtres près d'Albarracín, les abris choisis par les peintres s'ouvrent dans des roches calcaires en falaise. Ils sont petits et peu profonds, quelques mètres, sauf l'ensemble remarquable du Barranco de Gasulla (Castellón), qui sur plusieurs dizaines de mètres rassemble de 600 à 700 représentations. Peu de traces d'habitats ont été trouvées dans ces abris qui ne se prêtaient guère à des occupations prolongées et qui ont souffert de leur exposition aux intempéries. Les pigments des tracés furent altérés par les alternances d'ensoleillement et d'humidité et par les desquamations des parois.
Plusieurs milliers de représentations ont été peintes ou dessinées en rouge, brun, noir, exceptionnellement en blanc, tels les superbes bœufs de l'abri de Los Toricos (Teruel). Il n'existe pratiquement pas de gravures. La thématique est essentiellement figurative : des animaux présents dans tous les sites mais un peu moins nombreux que les humains. Cerfs et biches, caprinés, bouquetins et chèvres, comptent pour plus de la moitié des animaux. Les bovinés ne sont pas rares (environ 10 p. 100) souvent groupés mais sans signe figuré attestant leur domestication ; les autres animaux furent sporadiquement figurés et en faible quantité ; ce sont des chevaux et des ânes, des chiens et des loups, des sangliers fuyant des chasseurs, des oiseaux, exceptionnellement des poissons ; mais on remarque surtout des dessins succinctement figuratifs d'arthropodes telles des abeilles placées dans des scènes de collecte de miel. Deux grands modes d'expression caractérisent les figures animales : d'un côté, les animaux les plus grands (jusqu'à un mètre), naturalistes et hiératiques, disposés sans référence spatiale explicite, sont à peu près exclusivement des cerfs (Olivanas) et des bœufs ; de l'autre, les animaux petits, dessinés en quelques traits, sont agités de mouvements et participent à des scènes très vivantes. Les représentations humaines sont aussi différenciées ; certains personnages-fourmis sont miniaturisés (moins de 5 cm) et schématisés à l'extrême ; d'autres silhouettes sont longilignes et gracieuses : femmes à la taille fine, vêtues de longues jupes en cloche ; elles sont parfois accompagnées d'archers au corps élancé portant des coiffes emplumées. Cependant, l'archétype des représentations humaines du Levant est le petit archer, chasseur ou guerrier, muni de son arc, de flèches. À l'arrêt ou courant, isolé ou en file, il est partout, héros vainqueur, chasseur comblé. Les représentations humaines, vêtues, parées, armées... souvent placées en situation de danse, de guerre, de collecte fourmillent d'indications sur les changements sociaux et économiques qui caractérisent le Mésolithique, le Néolithique puis l'Âge des métaux. De grandes incertitudes demeurent pour dater correctement l'art du Levant. Toutefois, la série des animaux « naturalistes » dans laquelle n'intervient pas l'homme paraît antérieure à la néolithisation qui devient sensible ensuite dans les scènes, les habits, la domestication (chiens, chevaux) et même des travaux agricoles ; entre le IXe et le Ve millénaire doit donc se situer une première partie de l'art du Levant ; la seconde, d'abord néolithique, s'achève dans le processus généralisé de schématisation graphique qui gagna toute la péninsule Ibérique et provoqua l'avènement de l'écriture à l'aube de l'Histoire.
Denis VIALOU
2. Afrique
• L'art rupestre du Sahara
Historique et répartition des découvertes
Sahara septentrional et central
L'un des tout premiers auteurs à avoir attiré l'attention du monde savant sur les gravures rupestres de plein air du nord de l'Afrique fut F. Jacquot, dans des articles consacrés, en 1847, aux stations de Tiout et de Moghrar et-Tahtāni en Algérie, l'année même où Jacques Boucher de Crèvecœur de Perthes publiait le premier volume des Antiquités celtiques et antédiluviennes, bien avant les premières découvertes de grottes ornées. Mais ces œuvres, jugées « affreusement indécentes » par Jacquot lui-même, n'éveillèrent qu'un écho discret, voire scandalisé, et les trouvailles ne se multiplièrent vraiment qu'au cours du xxe siècle.Il n'est pas possible de citer toutes les contributions de voyageurs et de chercheurs, amateurs ou professionnels, qui ont fait connaître des documents rupestres provenant de l'ensemble du Sahara, car elles sont très nombreuses, et d'inégale importance. Cependant, il importe de rappeler que la découverte des peintures du Tassili-n-Ajjer revient au capitaine Cortier, qui les signala pour la première fois en 1909. Ces peintures furent ensuite documentées par le lieutenant Brenans, dont les carnets de terrain furent publiés par l'abbé Breuil en 1954, dans un article qui décida un jeune zoologiste, Henri Lhote, à consacrer sa vie à l'étude des arts rupestres du Sahara. À partir de 1956, celui-ci releva de nombreuses fresques au cours de ses expéditions au Tassili-n-Ajjer, puis organisa à Paris, dès 1957, une exposition sur les « Peintures préhistoriques du Sahara » (musée des Arts décoratifs).
Tassili-n-Ajjer Peinture rupestre représentant une scène de chasse, Tassili-n -Ajjer (Sahara algérien).
Crédits: Istituto Geografico De Agostini Consulter
Les premières gravures rupestres sahariennes furent découvertes en 1850 à Tilizzaghen au Messak (Fezzan, Libye) par l'explorateur Heinrich Barth, alors en route vers Tombouctou. À son retour, il ne présenta que trois gravures dans le récit de son voyage, gravures qui ne soulevèrent guère d'intérêt avant 1932, date à laquelle l'anthropologue et préhistorien Leo Frobenius décida de consacrer une expédition à l'étude de ces œuvres. Un riche répertoire iconographique fut alors découvert, dont l'inventaire se poursuit encore de nos jours. En 1948, Roger Frison-Roche photographia les gravures de l'Adrar Iktebīn, dans la même région, y trouvant l'inspiration d'un récit romancé : La Montagne aux écritures. Les recherches se développèrent à la fin des années 1960, quand deux missions italiennes conduites par Paolo Graziosi, permirent à ce dernier de faire de nouvelles explorations au Messak. Dans cette zone, les découvertes étonnantes se sont multipliées ces dernières années, particulièrement grâce aux minutieuses prospections de Gérard Jacquet, Jan Jelínek, Giancarlo Negro, et enfin Rüdiger et Gabriele Lutz. Mais c'est surtout depuis 1990, date à laquelle Axel et Anne-Michèle van Albada ont fait connaître les premiers résultats de leurs recherches, que nos connaissances ont évolué de façon décisive, notamment en ce qui concerne les personnages masqués, les cynocéphales mythiques, les scènes de sacrifice et de partage d'antilope, etc.
Autre province rupestre importante, l'Akākūs, située dans l'extrême sud-ouest de la Libye entre le Messak et le Tassili, recèle des gravures et des peintures, mais ce sont surtout ces dernières qui ont attiré l'attention des chercheurs.
Le Tassili-n-Ajjer, lui aussi, est surtout connu pour ses peintures, les publications d'Henri Lhote ayant rendu célèbres celles de localités comme Séfar, Jabbaren ou Iheren, mais de nombreux ensembles restent encore à découvrir ou à publier. Parmi les études importantes pour cette région, il convient de citer les travaux de Ginette Aumassip sur le site de Ti-n-Hanakaten, et ceux d'Alfred Muzzolini, Aldo Bocazzi et Augustin Holl sur celui de Tikadiouine.
Le Tassili-n-Ajjer est également riche en gravures, l'oued Djerāt, découvert par le lieutenant Brenans en 1932, constituant à cet égard un site capital, presque aussi important, par le nombre et la qualité des œuvres, que les vallées du Messak libyen.
D'autres sites à gravures, signalés au Sahara central, ont été partiellement inventoriés, mais l'intérêt du livre que Théodore Monod a consacré à l'Ahnet dépasse largement celui des gravures qui y sont décrites, dans la mesure où les conceptions chronologiques qui y étaient développées dès 1932 connurent une très longue postérité. Elles influent toujours d'ailleurs sur les cadres de pensée des chercheurs qui travaillent actuellement sur l'ensemble du Sahara (cf. infra, Classification et datation).
Dans l'Ahaggar (Hoggar), depuis l'ouvrage rédigé en 1938 par F. de Chasseloup-Laubat à l'issue de l'expédition alpine française du Haut-Mertutek, l'essentiel de nos connaissances est dû aux minutieuses prospections et aux magnifiques monographies de Franz Trost sur l'Ahaggar central, publiées en 1981 et 1997.
Sahara oriental, occidental et méridional
Certaines découvertes ont joué un rôle important dans les discussions concernant les œuvres rupestres du Sahara central en général. Ainsi, en 1864, l'explorateur et géographe Henri Duveyrier signalait l'existence, au col d'Anaï, de gravures de chars tirés par des bœufs, sur « la piste que suivaient les Garamantes vers l'Aïr », et donnait ainsi naissance au mythe de la « route des chars », qui eut la vie dure. Douze ans plus tard, le médecin explorateur allemand Gerhard Rohlfs découvrait le site de l'oued el-Khēl en Sud-Tripolitaine, qui sera publié en 1968 par Paolo Graziosi, et qui est célèbre par ses nombreuses gravures de « femmes ouvertes », femmes accroupies, vues de face, souvent évoquées dans les études sur la signification de l'art rupestre. Cette même année, le Libyen Fathallah Ezzedīn remarquait sur des dalles horizontales de Sīdi Sharīb, près de Tarhūna, en pleine Tripolitaine, des gravures qui seront toutes publiées par Jan Jelínek en 1982, et qui sont parmi les plus septentrionales connues dans leur style. En 1979, le général Huard fera connaître la station de Timissit, au sud de Ghadamès, remarquable par ses nombreuses spirales et empreintes gravées. Une dizaine de gravures découvertes à Gārat Umm el-Mançūr (près de Sinawen) par Umberto Paradisi, en 1963, sont particulièrement intéressantes pour l'étude de la répartition des ovins ornés, car elles témoignent d'une extension méridionale inattendue.Depuis les découvertes de Marc Milburn dans le nord-ouest de l'Aïr en 1976-1977, de Jean-Pierre Roset dans l'Aïr septentrional en 1971, et de Gérard Quéchon et Jean-Pierre Roset dans le massif de Termit en 1974, les figurations rupestres de la partie méridionale du Sahara sont beaucoup mieux connues, surtout grâce aux importants corpus réalisés en 1979 et 1987 par Henri Lhote pour l'Aïr, et en 1991 par Christian Dupuy pour l'adrar des Ifoghas (Iforas). Dans leur immense majorité, ces gravures appartiennent à l'école dite du « guerrier libyen », nom donné aux innombrables représentations de personnages géométriques stéréotypés qui couvrent les rochers de ces régions.
Par sa thématique et son style, le monde des gravures de l'Atlas saharien est souvent proche de celui du Sahara central, mais la plupart des ensembles connus n'ont été que très partiellement décrits et, depuis soixante ans, on publie régulièrement les photographies des mêmes œuvres. Depuis 1990, des sites de peintures ont été découverts en Tunisie, notamment dans la région de Ghoumrassen, attirant l'attention sur une zone jusqu'alors absente des cartes de répartition des arts rupestres sahariens. Du point de vue de l'art rupestre, le Haut Atlas marocain, le Rio de Oro et l'Adrar mauritanien semblent appartenir à un autre monde que les ensembles du Sahara septentrional et central. Au Maroc et au Rio de Oro, on remarque en particulier des gravures de poignards, de haches nervurées (dites « hallebardes ») et d'un type particulier de haches à manche coudé (dites haches peltes), qui ne se retrouvent nulle part ailleurs au Sahara, et qui signalent une période récente, où le façonnage du métal était évidemment acquis. De l'Adrar de Mauritanie et de l'Aouker, on retiendra surtout la présence de nombreuses gravures de chars schématiques souvent attelés à des bœufs, ce qui reste rare dans les autres provinces rupestres.
Dans le désert Libyque oriental, les gravures du Karkūr et-Talh ont été signalées en 1923 par Hassanan Bey alors que, de 1924 à 1926, le prince Kémāl ed-Dīn poursuivait le relevé de celles d'Awenāt. En 1933, un archéologue italien, di Caporiacco, découvrait les peintures d'Aïn Dūwa alors que, la même année, Hans Rhotert entreprenait la première étude générale de l'art rupestre de l'ensemble de la région, dans une monographie qui ne fut éditée qu'en 1952. De nombreuses peintures et gravures inédites du Karkūr et-Talh seront signalées en 1936 par le célèbre aventurier hongrois Lazlo de Almazy (héros du film Le patient anglais), et leur inventaire systématique sera entrepris par Hans Winkler deux ans plus tard. Enfin, une expédition belge dirigée par Francis Van Noten repérera de nombreuses peintures et gravures dans les vallées de la région d'Awenāt et du Gilf Kebīr, moisson qui se concrétisera en 1978 par la publication d'une synthèse magnifiquement illustrée. Hormis un énigmatique panneau de peintures représentant des Têtes rondes à Bū Hlēga dans le Karkur Drīs, les figurations observées à Awenāt représentent surtout des bovins, des chèvres et des personnages souvent comparables aux peintures du massif de l'Ennedi (nord-est du Tchad), avec lequel des relations devaient exister aux alentours du IIe millénaire avant J.-C.
La plupart des sites anciennement signalés dans l'Ennedi par D'Alverny, Gérard Bailloud et Paul Huard ont été revus en 1996-1997 par Adriana et Sergio Scarpa Falce, Jacques et Brigitte Choppy, Aldo et Donatella Bocazzi. À part quelques peintures qui évoquent les Têtes rondes du Tassili, l'ensemble ne peut guère être antérieur au IIe millénaire avant J.-C.
Le Djado a fait l'objet de recherches approfondies de la part de Karl Heinz Striedter et Michel Tauveron, alors que le Tibesti est désormais bien connu grâce à une publication collective dirigée par Giancarlo Negro, Roberta Simonis et Adriana Ravenna. Dans ces deux zones, il existe des gravures apparemment anciennes, qui pourraient correspondre à une extension méridionale extrême du style bubalin. Dans leur grande majorité, les peintures et gravures du massif sont pastorales au sens large, leur phase la plus ancienne étant représentée par le style dit de Karnasahi où abondent les archers en mouvement à tête zoomorphe.
Classification et datation
Les premières publications de « fresques » du Tassili suscitèrent un important mouvement d'intérêt de la part des préhistoriens et du grand public : on pensait qu'enfin se dévoilaient des témoignages de première main sur la vie quotidienne, les croyances et la culture matérielle de peintres et de graveurs ayant vécu « au temps où le Sahara verdoyait », et que les œuvres allaient nous livrer d'irremplaçables informations sur leurs cultures à jamais disparues. De plus, la qualité graphique de nombre de ces productions en faisait des œuvres de tout premier plan, capables de toucher notre propre sensibilité artistique, et dignes de figurer en bonne place dans toutes les anthologies et histoires de l'art.Les découvertes se multipliant, il devenait indispensable d'introduire un ordre dans la masse grandissante des documents – bientôt connus par dizaines de milliers sur l'ensemble de l'hémi-continent – et l'on convint de les classer par périodes. Mais si les œuvres tassiliennes sont généralement les plus connues, et si leur étude a permis l'établissement de plusieurs systèmes chronologiques, il faut rappeler que la toute première classification des gravures fut proposée au milieu du xixe siècle par Heinrich Barth, qui distinguait les figurations « à grands animaux » des gravures « très mal et très négligemment tracées ». Cette distinction fut ultérieurement reprise par le géographe Émile Félix Gautier, lequel écrira dans la première décennie du xxe siècle : « Tout ce qui n'est pas belle gravure ancienne [...] est immonde graffiti libyco-berbère ». Ainsi, dès les premières tentatives de classification, apparaissait la regrettable intrusion de critères artistiques imputables au goût des classificateurs, et dont l'archéologie et l'histoire de l'art n'ont pas encore réussi à se dégager totalement.
Dès les premières découvertes, on avait remarqué que plusieurs époques étaient concernées, puisque certains des « graffiti » représentaient des dromadaires – d'introduction récente au Sahara – tandis que d'autres montraient des espèces disparues de la région (comme l'hippopotame, l'éléphant, la girafe ou le rhinocéros) voire définitivement éteintes (comme le grand buffle antique). L'habitude de classer les gravures rupestres en fonction des espèces animales représentées s'imposa donc et, à la suite de Théodore Monod, on considéra certaines figurations animales comme des sortes de fossiles directeurs. Les périodes les plus récentes, caractérisées par la présence de dromadaires et de chevaux, furent dites « cameline » et « caballine », tandis que les images représentant des bœufs domestiques étaient dites « pastorales » ou « bovidiennes », alors que la catégorie du « bubalin », considérée comme la plus ancienne, se fondait sur les figurations d'une espèce disparue de buffle géant, dite « grand bubale ».
Les premiers spécialistes de l'art rupestre, formés à l'école des anthropologues du xixe siècle et du début du xxe siècle, crurent alors découvrir, dans les œuvres qu'ils étudiaient, les témoignages du passage d'une culture de chasseurs à une civilisation de pasteurs. Aux premiers furent attribuées les gravures du « bubalin », et aux seconds les œuvres dites « pastorales », notamment les innombrables peintures de bovins domestiques. Ainsi, les premières observations de Lhote au Djerāt lui firent-elles « admettre l'existence, au Sahara central, d'un groupe archaïque néolithique où la faune est exclusivement éthiopienne ». À l'occasion de l'exposition parisienne des relevés qu'il avait effectués au cours de ses missions, il affirma que les gravures de la période dite par lui « des chasseurs » ou « du bubale » devaient être situées entre 6000 à 8000 ans avant J.-C. », alors que celles des « Pasteurs à bovidés » auraient débuté au Ve millénaire. Mais, reprenant le dossier du Djerāt plusieurs années après ses premiers séjours au Tassili, il reconnut qu'il y avait lieu « de revenir sur la conception qui n'admettait pas le bœuf (domestique ?) dans le groupe des gravures de style naturaliste, défini parfois sous le nom de groupe des chasseurs ou du bubale ou du bubalin ».
La périodisation des figurations anciennes en productions d'abord « bubalines » ou « des chasseurs » puis « pastorales », ne fut donc qu'une simple hypothèse construite à partir de quelques cas jugés exemplaires, et choisis sur une poignée de sites de l'Atlas, du Tassili et du Fezzān. Cette proposition fut progressivement figée en une théorie abusivement élargie à l'ensemble du Sahara, du Sud marocain et du Rio de Oro à l'Algérois et au Constantinois, de l'Ahaggar et du Tassili au Fezzān, voire jusque dans la vallée du Nil. Partout, les voyageurs trouvaient de nouveaux sites rupestres dont les productions graphiques étaient aussitôt attribuées, selon leur sujet, soit aux « chasseurs », soit aux « pasteurs ». Mais caractériser une « période des chasseurs » par l'absence totale de représentations d'animaux domestiques, ainsi qu'on le faisait alors (et comme on le fait encore trop souvent), expose au risque d'effectuer le raisonnement circulaire suivant :
1. L'art des « chasseurs » (ou du « bubalin ») est défini comme figurant essentiellement des animaux sauvages, et celui des « pasteurs » comme figurant surtout des animaux domestiques ;
2. Par conséquent, lors de l'étude des sites, faune sauvage et animaux d'apparence domestique sont traités séparément, de façon à constituer deux ensembles thématiques ;
3. Sans autre argument, ces deux ensembles – construits de toutes pièces par les chercheurs – sont alors considérés comme appartenant bien à deux entités culturelles différentes et successives.
On a parfois repoussé au-delà du Néolithique l'âge des gravures « bubalines » supposées appartenir à un monde de chasseurs paléolithiques. De nos jours encore, certains leur attribuent volontiers 10 000 ans d'ancienneté, voire 20 000 ans ou plus. Depuis les années 1970, les prises de position se sont succédé à propos des différents « étages » de l'art rupestre du Sahara et de leur âge, mais les chronologies qui en résultent sont fragilisées par nombre de défauts méthodologiques, dont les plus fréquents sont : l'attribution de gravures à des groupes stylistiques définis sur des peintures (ou l'inverse), l'absence de définition précise des styles, l'association systématique d'un style et d'un « étage », la définition a priori de chaque grande période par la présence d'un seul animal caractéristique, l'interprétation des différences de patine en termes de « quelques millénaires » supposés s'écouler entre chaque phase, l'attribution systématique et non étayée de tout « bubale » à une « période bubaline » et enfin l'amalgame entre les notions de style, d'époque et d'ethnie.
La chronologie
Les méthodes objectives de datation
Par la patine. Comme des estimations chronologiques très différentes coexistent actuellement dans les publications spécialisées, le prodigieux imagier rupestre saharien semble avoir perdu beaucoup de son intérêt pour les préhistoriens. Plusieurs tentatives ont donc vu le jour, qui visaient à ancrer l'art rupestre dans un cadre chronologique acceptable. À cet effet, pour dater les gravures, on a d'abord cru pouvoir utiliser l'étude des patines, puisque la roche fraîchement incisée ou percutée est d'abord de teinte très claire, avant de foncer avec le temps jusqu'à reprendre la couleur sombre qui était la sienne au départ. L'intensité des teintes devrait donc être proportionnelle à l'ancienneté des œuvres, rendant presque immédiate la lecture de leur position chronologique relative. Malheureusement, il est maintenant attesté que le processus de « patinisation » ne s'effectue pas selon une fonction linéaire du temps et qu'une patine extrêmement foncée peut parfois survenir très rapidement. Tout espoir de datation par les patines s'est donc révélé illusoire. Pourtant, des recherches récemment conduites au Messak ont montré que la formation de la patine noire qui recouvre généralement les gravures les plus anciennes, et qui est liée à l'activité de bactéries fixant le manganèse, s'était déroulée durant l'Holocène moyen, vers la fin du VIe millénaire before present (B.P., c'est-à-dire par convention, avant 1950) et encore au début du Ve millénaire. Ce processus fut interrompu ou considérablement ralenti vers le IVe millénaire B.P., par suite de la détérioration climatique générale du Sahara à cette époque.Par la sédimentologie. Des observations conduites dans la Tadrart algérienne concernent des gravures rupestres partiellement recouvertes par des sédiments holocènes, ce qui a permis d'intéressantes tentatives de datation. En effet, deux niveaux de terrasses ont été reconnus dans cette vallée : c'est le niveau le plus ancien qui se trouve au contact des gravures, alors que le plus récent résulte d'écoulements ayant entamé et déplacé des dépôts antérieurs. L'intensité des écoulements reconnus dans le niveau récent permet de supposer que sa formation précéda l'Aride généralisé dans l'ensemble du Sahara à partir de 4000-3500 B.P. L'autre niveau est donc plus ancien, mais toute la question est de savoir dans quelle mesure. On a proposé de le mettre en relation avec une accumulation de matériels détritiques antérieure à 7500 B.P. Si cette estimation était confirmée, il en résulterait que les gravures de bovinés en partie sous-jacentes à cette terrasse auraient forcément été réalisées avant cette date. En outre, comme le trait incisé des pattes de ces bovins fut repris par piquetage à une époque inconnue, mais également antérieure au dépôt de terrasse, il a été supposé que le trait original aurait été exécuté avant le premier Humide holocène, c'est-à-dire au Pléistocène final. Mais même si la date de 7500 B.P. était confirmée pour la formation de la terrasse ancienne, il resterait à mesurer l'intervalle entre la date de la reprise piquetée et celle des œuvres incisées originales. Et même en supposant que la reprise visait à restaurer l'œuvre originale en partie effacée, on resterait dans l'incapacité de délimiter avec certitude le laps de temps nécessaire à cet effacement. Ce temps pourrait se mesurer en millénaires, mais tout aussi bien en siècles ou en décennies, car il n'est aucunement prouvé que l'érosion des gravures nécessite toujours l'action de plusieurs millénaires, de périodes entières de la succession des « Arides » et des « Humides ». En fonction de la localisation des œuvres, très peu de temps pourrait y suffire, lors d'un épisode de corrasion (érosion éolienne) court mais intense, et il faut redire qu'il n'existe actuellement aucun moyen de reconnaître la durée d'un processus d'érosion à partir de son action sur un trait gravé, une action importante ne correspondant pas forcément à une longue durée du processus.
Par le carbone 14. Afin d'employer les techniques de datation utilisant la spectrométrie de masse par accélérateur pour dater des peintures en n'utilisant qu'une très petite quantité de matière, il faut disposer d'échantillons contenant des matières organiques, ce qui est rare au Sahara. Une date de 6145 ± 70 ans B.P. a été obtenue sur une peinture peut-être bovidienne de l'abri Lancusi dans l'Akākūs (sud-ouest du Sahara libyen), et l'on peut supposer que de nouveaux résultats seront bientôt disponibles sur d'autres sites.
La méthode culturelle
Les présupposés évolutionnistes. Bien que depuis plus d'un siècle, de nombreux auteurs aient réfuté la doctrine évolutionniste voulant faire partout passer l'humanité de l'étage des « chasseurs » à celui des « pasteurs » et bien qu'une théorie aussi obsolète soit abandonnée par la plupart des anthropologues, il est curieux de constater qu'elle est toujours admise par la majorité des chercheurs en art rupestre saharien. Cette situation est dénoncée, depuis le début des années 1980, par Alfred Muzzolini, lequel conteste vigoureusement « ce paradigme qui revient à attribuer tous les chasseurs, par principe, à une phase „ancienne“ ». Ses critiques n'ont malheureusement guère été entendues, puisqu'elles visent des attributions qui ne s'appuient pas sur un raisonnement, mais sur l'un des fondements imaginaires de notre propre culture associant, dans les profondeurs de notre esprit, la chasse à l'archaïsme. En effet, les chasseurs symbolisent le primitif et le sauvage, et sont couramment associés, consciemment ou non, à une prétendue « mentalité archaïque ». Au point que, dans le vocabulaire des chronologies sahariennes, une expression comme « période des chasseurs archaïques » sonne presque comme un pléonasme.Les chronologies traditionnelles des arts rupestres sahariens illustrent donc un état ancien des études anthropologiques, popularisé à la fin du xixe siècle par Lewis Henry Morgan, présupposant un progrès linéaire de l'humanité par complexification progressive des cultures et impliquant l'existence d'un ordre immanent dans la succession des phénomènes économiques et culturels. Ces chronologies, qui se plaisent à reconnaître parmi les gravures rupestres sahariennes des témoignages de la succession : « chasseurs », puis « pasteurs », prolongent aussi la thèse du père Wilhelm Schmidt qui, en 1926, affirmait dans Der Ursprung der Gottesidee, qu'il faut distinguer Urkultur (culture des chasseurs nomades) et Primärkultur (culture des pasteurs), la seconde succédant nécessairement à la première. Le postulat évolutionniste sous-jacent transparaît clairement dans le vocabulaire utilisé pour le Sahara. En effet, des chasseurs tardifs (Late Hunters) y succèdent régulièrement aux chasseurs précoces (Early Hunters), on évoque volontiers la « diminution de la qualité artistique », ou bien l'on commente l'évolution d'un « style des chasseurs » allant du « décoratif » au « simplifié » en passant par le « classique » quand certaines œuvres ou périodes ne sont pas qualifiées de « décadentes », voire de « grossières » et de « primitives », tandis que le « subnaturalisme » y succède forcément au « naturalisme ». Pourtant, contre le préjugé d'un évolutionnisme culturel linéaire et universel, se sont d'abord élevées les voix d'Eduard Hahn, de Franz Boas et de Robert Lowie, puis celles de Bronislaw Malinowski, Wilhelm Koppers et Alfred Reginald Radcliffe-Brown, pour ne citer que les auteurs les plus connus. De nos jours, les anthropologues ont donc très généralement abandonné la théorie selon laquelle les sociétés passeraient nécessairement par des phases historiques liées aux ressources alimentaires, techniques et intellectuelles mises en œuvre pour répondre aux pressions de l'environnement. Il est désormais admis qu'il s'agissait d'une idée reçue, largement controuvée par les observations ethnologiques et qui, sur le terrain, a souvent conduit à ne prendre en compte que les singularités culturelles jugées susceptibles d'indiquer des écarts historiques. C'est ainsi que, dans l'étude des arts rupestres du Sahara, ce présupposé conduit à ne s'intéresser aux figurations de bovinés que dans la mesure où elles pourraient livrer des indices de domestication, ou bien à ne relever les représentations de la grande faune sauvage et les scènes cynégétiques (ou supposées telles) que parce qu'elles révéleraient la présence de « chasseurs ».
Les styles de gravures. Dans l'attente de l'application généralisée d'un ou plusieurs procédés objectifs de datation absolue des images rupestres, les seuls arguments valides pour l'instant sont d'ordre stylistique et culturel. Du point de vue stylistique, on distingue trois grandes « écoles » de gravures : le « Bubalin », l'école dite « de Tazina » et celle dite du « guerrier libyen.
Le Bubalin. La plupart des auteurs ont affirmé jusqu'à présent que les gravures « bubalines » ou des « chasseurs » seraient d'un autre style que les œuvres proprement pastorales, mais des recherches précises, portant sur plusieurs milliers de figurations, font rejeter cette assertion.
Si l'on s'en tient à l'étude des seuls témoignages graphiques que nous ont laissés les anciens habitants du Sahara, il est impossible d'en déduire l'existence d'une « culture des chasseurs » qui aurait laissé place à des pasteurs. La fréquence des animaux sauvages représentés dans l'art bubalin a souvent été surévaluée, de même que celle des scènes de chasse véritable. En outre, la présence de ce type d'image n'implique aucunement qu'elles soient le fait d'une société de « chasseurs ». Le grand buffle antique traditionnellement dénommé « bubale » ne peut caractériser un « Bubalin » très ancien puisqu'il est désormais attesté qu'en plusieurs points du Sahara, il a vécu très tardivement, au moins jusque vers 4000 B.P. S'il est parfaitement exact qu'il fut chassé et consommé par certains Néolithiques du Sahara, on constate que l'appellation de « bubalin » a été utilisée, surtout dans l'Atlas saharien et au Sahara central, pour définir des ensembles rupestres où cet animal n'est pas toujours présent, et que ce dernier a disparu longtemps après la fin de la phase qu'il est supposé caractériser. Ce terme de « bubalin » ne saurait donc être conservé que comme une étiquette commode pour désigner le style des gravures sur lesquelles le grand buffle antique apparaît le plus souvent, mais en aucun cas pour qualifier un étage particulier.
Les gravures de ce style, souvent détaillées, sont essentiellement « naturalistes » et comportent des représentations de la grande faune sauvage (éléphants, rhinocéros, hippopotames, girafes) dont certains représentants ont disparu beaucoup plus tard qu'on ne le pensait il y a une vingtaine d'années (des ossements d'hippopotames abondent par exemple dans les restes de cuisine du Ténéréen, vers 3500-2000 avant notre ère). Mais la présence de bovins et d'ovins domestiques y est également bien attestée, ainsi que le prouvent les bœufs richement parés, tenus en longe, ornés de pendeloques à décor géométrique maintenues par un collier, et portant des selles décorées munies d'un pommeau en « V » sculpté, connus dans l'art bubalin du Messak libyen, pourtant considéré comme un des « foyers » de la « culture des chasseurs ». Aucun animal indéniablement domestique n'étant connu au Sahara avant le Ve millénaire avant J.-C., les peintures ou gravures qui en représentent ne peuvent être antérieures, à moins de supposer l'existence, en plein Sahara central, d'une zone de primo-domestication plus ancienne. Placer ces œuvres dans le Ve millénaire avant J.-C. les fait concorder parfaitement avec les estimations signalées plus haut à partir de l'étude des états de patine.
Comme, par ailleurs, aucun des critères de superpositions, style ou technique ne permet de dissocier objectivement les images d'animaux domestiques et les représentations de la grande faune sauvage, il faut bien admettre que l'art gravé de style (et non d'âge) bubalin ne correspond pas à la production artistique de prétendus « chasseurs », mais constitue bien l'œuvre gravé d'un seul et unique groupe culturel qui, il y a environ 6500 ans, avait élaboré une haute civilisation pastorale. Bref, le fait d'inclure, au sein d'un ensemble pleinement pastoral, les œuvres habituellement considérées comme bubalines ou « des chasseurs » ne devrait pas réellement surprendre. Henri Lhote et Paolo Graziosi avaient déjà suggéré un tel regroupement, et cela ne fait que confirmer une remarquable intuition de Théodore Monod qui, dès 1932, posait la question de savoir si certains groupes de gravures de l'ensemble « préhistorique bovin » ne seraient pas à intégrer au « Bubalin », dont ils auraient été « plus ou moins contemporains ».
Le style de Tazina. Ce style tire son nom d'une station située dans les monts des Ksour, en Algérie, et il est essentiellement caractérisé par de petites gravures de gazelles et de girafes finement incisées, plus rarement d'autruches ou de grands fauves, dont les extrémités sont prolongées de manière parfois très fantaisiste. La très large répartition de ce type de représentations pose des problèmes difficiles à résoudre, car elles dominent numériquement de larges ensembles du Sahara occidental (Haut Atlas marocain, Rio de Oro, Adrar mauritanien) et du Sahara centro-méridional (Messak libyen, Djado).
Les Guerriers libyens. Il s'agit d'un type de gravures le plus souvent piquetées, qui se trouvent en grand nombre dans l'Adrar des Ifoghas et de l'Aïr, moins fréquemment en Ahaggar, mais tout à fait exceptionnellement au Fezzan, au Djado et au Tibesti. Elles correspondent vraisemblablement à la première occupation berbère du Sahara, et représentent surtout des hommes dessinés en position frontale, arborant volontiers des lances aux armatures (lames) exagérément agrandies, qui sont souvent munis d'un bouclier rond et tiennent des chevaux par une longe. Des figures comparables existent dans l'Adrar de Mauritanie et l'Aouker. Toutes ces œuvres sont à situer entre le Ier millénaire avant notre ère et le Ier millénaire après.
Les styles de peintures. La zone du Sahara pour laquelle on dispose des meilleures données est celle du Tassili-Akākūs ; ailleurs, le regroupement en écoles est soit en cours (Tibesti oriental), soit n'a aucune assise chronologique fiable, soit encore souffre d'une multiplication excessive de petits styles très localisés et mal définis (Ennedi).
Les Têtes rondes. L'école des « Têtes rondes », essentiellement tassilienne, est surtout connue par la présence des « Martiens », sortes de personnages en aplat clair cerné d'un contour sombre, à grosse tête arrondie sans indication des traits du visage, et qui caractérisent les peintures les plus anciennes. La faune, dont l'identification est souvent malaisée, est surtout composée d'antilopes. Des réalisations probablement plus récentes mais dues à cette école, sont connues dans l'Akākūs, et il est bien difficile d'en préciser la position chronologique par rapport aux peintures du Bovidien ancien local. Dans les phases plus tardives, l'aplat clair cède la place au remplissage à l'ocre.
Le Bovidien. Pour le Bovidien ancien, il s'agit essentiellement de peintures de personnages négroïdes en aplats ocres, qu'Alfred Muzzolini a proposé de regrouper sous l'appellation d'« école de Sefar-Ozanéaré ». Elles n'ont été reconnues qu'au Tassili, et leur thème de prédilection est celui dit de « la conversation devant l'enclos », où des hommes et des femmes, aux cuisses volumineuses, sont assis ou allongés devant des habitations de plan elliptique ou sub-rectangulaire dont l'aménagement intérieur est en partie visible.
En ce qui concerne le Bovidien récent, les peintures de l'école d'Abaniora, en aplats ocres, comportent des personnages dont le profil évoque celui des Peuls actuels, ce qui a contribué à l'élaboration de théories interprétatives visant à expliquer très imprudemment l'art rupestre saharien par les traditions culturelles de ce peuple. Enfin, l'école d'Iheren-Tahilahi, caractérisée par les dessins au trait fin, nous a laissé de nombreuses peintures pastorales complexes (déplacement des campements, montage des tentes) où dominent les bœufs et les moutons, mais aussi des scènes de chasse au lion. Cette école trouve des correspondances dans l'Akākūs, notamment avec le style de Wa-n-Amil, avant de se prolonger insensiblement dans la « période du cheval » qui verra bientôt l'apparition des premiers chars « au galop volant ».
Caballin et camélin. Aucune rupture franche n'apparaît entre le monde des derniers pasteurs (par exemple l'école de Ti-n-Anneuin, caractérisée par des personnages rigides, longilignes, peints en blancs avec un manteau ocre) et celui des « Caballins » ou « Équidiens », qui affectionnent les personnages bi-triangulaires, dont la tête peut être réduite à un simple bâtonnet. Après le cheval, on voit apparaître les chars vraisemblablement introduits par l'intermédiaire de Cyrène, à partir du viie siècle avant J.-C. L'alphabet libyque, préfigurant les actuels caractères tifinaghs, n'apparaît probablement pas au Sahara central avant les ve-vie siècles avant J.-C. Enfin, le chameau fait son apparition dans le dernier quart du Ier millénaire avant J.-C. et permet la reconquête d'un Sahara que ses anciens habitants, chassés par la détérioration du climat, avaient presque totalement abandonné. De nos jours, les Touaregs continuent à graver ou à peindre dans leur environnement, surtout autour des gueltas (points d'eau temporaires), des figurations camélines et des caractères tifinaghs.
La recherche du sens
Les comparatistes
Les premiers découvreurs s'interrogèrent sur le sens des représentations qu'ils rencontraient et, très tôt, plusieurs interprétations et « clés de lecture » de l'art rupestre furent proposées, s'appuyant sur des rapprochements concernant d'abord des données grecques, puis égyptiennes et africaines. Les anciens chercheurs qui, sur les dispositifs rupestres sahariens, crurent reconnaître ici les taureaux du temple d'Assos, là Hécate dans la pause de Baubo, ailleurs le vol du bétail par Hermès, ne faisaient que projeter leur propre culture sur les images des parois ornées. Mais, pour être plus développées, nombre de comparaisons plus récentes, étayées par une connaissance parfois approfondie des mythologies égyptienne et africaine, n'en sont pas moins arbitraires pour autant.C'est ainsi qu'en suivant la lecture de trois fresques tassiliennes proposée par l'ethnologue malien Hamadou Hampāté Bā, à la lumière des traditions ésotériques peules, on a pu espérer découvrir une clé de lecture susceptible de conduire aux significations profondes des images non descriptives, fréquentes sur nombre de sites. Mais là encore, il s'agissait d'une projection sans lendemain puisque, après cette intéressante tentative, aucune autre fresque n'a jamais pu être « lue » de cette façon. Il n'en est pas moins resté la thèse éminemment discutable et pourtant toujours citée, selon laquelle les auteurs des fresques tassiliennes auraient été des « proto-Peuls ».
Quant à la douzaine de rapprochements effectués depuis un siècle entre des œuvres du Sahara et de l'Égypte ancienne, ils s'appuient généralement sur des dossiers contestables et ne peuvent pas conforter l'idée d'une influence directe entre les deux zones. Mais quelques cas, énigmatiques, comme celui des béliers ornés d'un disque pourraient s'expliquer par l'hypothèse d'un héritage commun.
Le symbolisme et l'analyse interne
Les tentatives d'explications de l'art rupestre par de prétendus universaux symboliques se soldent régulièrement par l'oubli des contextes locaux et par la dislocation des ensembles graphiques hors desquels chaque symbolisme perd toute cohérence. Par exemple, il ne semble guère intéressant d'extraire, à partir des dispositifs rupestres sahariens, toutes les figurations de spirales, de mains ou de pieds, afin de les comparer à des exemples empruntés au monde entier, mais tout aussi décontextualisés.Il est bien plus fécond de revenir à une analyse interne des sites, où l'on a trop longtemps négligé les interrelations existant entre les figures. On a aussi prêté trop peu d'attention au rapport que celles-ci entretiennent avec les parois rocheuses, car le choix d'un support faisait partie intrinsèque de la réalisation des œuvres, qui ne peuvent en être extraites. Des recherches de ce type, actuellement en cours au Messak libyen, ont permis à quelques auteurs, non pas de révéler la signification profonde de l'ensemble des œuvres, ce que plus personne ne songe à faire, mais d'approcher les connotations probables de plusieurs d'entre elles. Des résultats encourageants ont été ainsi obtenus pour certains signes abstraits du Messak libyen, dont Axel et Anne-Michèle van Albada ont bien montré qu'ils correspondaient à des schématisations extrêmes du corps féminin.
La laïcisation progressive de l'art
Mais si cette approche du sens des œuvres est forcément limitée, il en est autrement de la perception du rapport qu'entretient ou non l'art avec le sacré. En effet, avec du recul, une grande différence apparaît à ce sujet entre figurations anciennes (avant 4000 B.P.) et récentes. Parmi les gravures de style « bubalin », nombre d'images ne visent évidemment pas à représenter des scènes de la vie quotidienne, puisqu'on y voit par exemple des géants zoocéphales capables de tirer un rhinocéros d'une seule main ou de le porter sous le bras. De telles images, illustrant les exploits d'un « maître des fauves » mi-homme mi-animal, correspondent probablement à des récits mythiques à jamais disparus. D'autres scènes avec des représentations de danses et de personnages portant des masques d'animaux présentent un indéniable caractère rituel.Mais parmi les ensembles bubalins actuellement inventoriés, figure aussi une grande quantité d'images dans lesquelles nous ne pouvons reconnaître que de simples représentations animalières. Qu'au sein de la société des artistes préhistoriques elles aient été ou non le support d'un symbolisme particulier, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Toujours est-il que la liste des espèces représentées sur les parois ne correspond aucunement à un reflet fidèle de la faune de l'époque, et encore moins de l'ensemble du milieu naturel environnant (par exemple, les plantes et les insectes sont pratiquement absents du répertoire graphique). L'essentiel de l'art bubalin correspond donc à un immense bestiaire imagé, où certaines espèces ont été favorisées au détriment d'autres pour des raisons qui nous échappent, mais qui résultent des choix culturels ayant présidé à l'élaboration des dispositifs.
Le poids de ces choix est encore plus sensible dans le monde des « Têtes rondes », où l'on serait bien en peine de reconnaître une seule scène de la vie quotidienne. Tout n'est que personnages étirés ou flottant horizontalement dans les airs, « martiens » géants munis d'excroissances anatomiques monstrueuses, « orantes » aux têtes circulaires couvertes de motifs géométriques, animaux à longues pattes linéaires, ou motifs circulaires abstraits que, faute de mieux, on a baptisés « méduses » et « verseaux ». Presque tout dans cet art demeure absolument opaque à nos yeux et, pour expliquer l'atmosphère d'étrangeté qui s'en dégage, on a parfois supposé l'influence de substances psychotropes tirées de certaines convolvulacées sahariennes (Ipomaea purpurua, Turbina corymbosa).
Aucune école de gravure ne rappelle l'atmosphère mystérieuse des peintures des « Têtes rondes » dans leur ensemble, mais plusieurs analogies notables se retrouvent par contre entre gravures et peintures pastorales. Dans ces deux groupes en effet, on connaît – au Tassili et en Libye – des représentations de femmes se déplaçant montées sur des bovins, ou des scènes montrant la vie paisible d'un campement de pasteurs. Mais cela n'empêche pas la présence de figures énigmatiques qui devaient se référer à des conceptions symboliques ou religieuses désormais perdues.
Ainsi, les arts peints et gravés des périodes anciennes sont toujours emprunts de religiosité, bien qu'à des degrés divers selon les écoles. Le contraste est total avec les périodes plus récentes, celles dites « caméline » et « caballine », où prédominent les représentations de guerriers en pied, munis de leur armement, et régulièrement montrés à la chasse ou au combat. L'apparition du métal et du bouclier, l'exaltation des armes et la représentation magnifiée d'individus stéréotypés témoignent d'un autre monde, qui n'a plus grand-chose en commun avec celui que présentent les images anciennes. Certes, ces représentations ont pu être investies d'une symbolique particulière, et l'on sait que des armes comme les poignards, par exemple, sont souvent riches de connotations cosmogoniques chez les populations qui les emploient. Mais, sur les ensembles rupestres, on ne trouve aucun indice de religiosité. Surtout, le contraste est si net entre la richesse imaginaire ou la liberté graphique des œuvres anciennes, d'une part, et le caractère statique ou la monotonie des productions récentes, d'autre part, que cette opposition doit bien correspondre à quelque chose comme une sorte de « laïcisation » de l'art ou à tout le moins, à des modifications consécutives à l'arrivée des premières populations méditerranéennes, porteuses d'une idéologie en rupture avec le fonds de croyance des anciennes populations sahariennes.
• L'art rupestre de l'Afrique australe
Dans l'Afrique subsaharienne, l'art rupestre est souvent mal connu, ou peu étudié, à l'exception des centaines de pétroglyphes circulaires de Bidzar, au Cameroun septentrional, des gravures schématiques de la vallée de l'Ogooué, au Gabon, des représentations de couteaux de jet de la République centraficaine, ou des peintures de l'Angola. Il est probable que le peu d'intérêt manifesté jusqu'à présent pour ces productions graphiques soit dû à leur caractère non figuratif, et au fait qu'elles sont le plus souvent composées de signes simples (cupules, cercles, traits) ou d'ensembles schématiques offrant peu de prise à l'interprétation. Mais on tend désormais à considérer l'art rupestre comme un objet archéologique parmi d'autres, quelle que soit sa signification, et il est probable que les travaux d'inventaire se multiplieront.En Afrique australe, la situation est très différente, car les figurations rupestres y sont apparemment plus proches, dans leur conception graphique, des normes artistiques occidentales, et leur caractère éminemment symbolique laisse place à de nombreuses possibilités d'interprétation. Les peintures pariétales, surtout concentrées dans les abris de montagne, s'y comptent par dizaines de milliers, de la Namibie au Mozambique et du Zimbabwe au Cap, mais il existe aussi des sites à gravures remarquables sur le plateau central sud-africain au Botswana. Les deux modes d'expression (peinture et gravure) sont au service d'un art essentiellement animalier, où figurent la plupart des représentants de la grande faune africaine, avec une écrasante majorité pour les figurations de la grande antilope appelée « éland du Cap ».
Lorsque les premiers auteurs n'y virent pas le produit du délassement des San (alors appelés « Bushmen ») supposés occuper ainsi leur oisiveté, ils crurent y reconnaître les indices d'une magie imitative à vocation cynégétique. Au xviiie siècle, sir John Barrow attribuait aux peintures du Cap un rôle comparable, au sein de la société san, à celui que tiennent les tableaux dans nos musées, mais des explications aussi simplistes sont abandonnées de nos jours, comme du reste toute tentative d'élucidation globale et unique de cet art. Une longue tradition interprétative, dite « narrative » et fondée dans les années 1860 par le géologue George William Stow, préféra considérer les fresques comme autant de témoignages sur la vie quotidienne des San, leur culture matérielle et leurs techniques de chasse. Mais dès les premières études, il était apparu qu'un certain nombre de figures (séries de points, cercles, lignes reliant des personnages) résistaient à toute tentative d'interprétation, alors qu'elles devaient pourtant bien receler un sens précis. On s'aperçut également que toutes les superpositions n'avaient pas de valeur chronologique, que certaines d'entre elles avaient été pratiquées volontairement, et qu'elles devaient donc être chargées de sens. Quant à l'interprétation par la magie de la chasse, elle ne résultait que de la lecture forcée de quelques scènes montées en épingle à partir de l'a priori selon lequel les artistes auraient dépeint en quelque sorte leur vie quotidienne. En réalité, on sait maintenant que les vraies scènes de chasse sont particulièrement rares et que le bestiaire figuré, privilégiant l'éland du Cap, ne coïncide pas avec le régime alimentaire des San, dans lequel le gibier est essentiellement composé de petits animaux pris au piège. L'art figuré témoigne donc d'une sur-représentation de l'éland du Cap, et d'une sous-représentation des espèces réellement consommées. En outre, plus de 60 p. 100 de l'alimentation des San est habituellement constituée de plantes dont la récolte est une activité traditionnellement féminine, alors que les figurations de femmes sont rarissimes dans les peintures. Au bout du compte, la multiplication de ce type d'observations a finalement conduit à l'abandon de la théorie associant l'art rupestre sud-africain aux techniques d'acquisition de la nourriture.
Comme dans le domaine saharien, l'histoire de la recherche sur l'art rupestre de l'Afrique australe a été marquée par bien des tentatives naïves de lecture qui, en réalité, n'étaient qu'autant de projections. C'est ainsi que dans la première moitié du xxe siècle, Raymond Dart et l'abbé Breuil crurent percevoir des réminiscences phéniciennes, sinon babyloniennes, perses et sumériennes, dans des peintures du Drakensberg. Quant à C. van Riet Lowe, il avait même considéré que l'instrument tenu par un « théranthrope » (être mi-homme, mi-animal) peint dans cette région n'était autre qu'un aulos (double flûte) grec, et que l'instrumentiste rappelait la figure d'Anubis.
Tout en permettant de s'affranchir de conceptions à ce point eurocentriques, les recherches ultérieures ont montré que l'art rupestre sud-africain était bien descriptif, mais d'une façon très différente de celle supposée jusqu'alors. En effet, l'étude détaillée des publications laissées par les ethnographes, les voyageurs et les missionnaires du xixe siècle a montré que les rituels fondamentaux des San utilisaient le phénomène de la transe collective provoquée. Or plusieurs détails des peintures, jusqu'alors inexplicables, peuvent se comprendre dans un tel cadre. On peut citer en exemple la position contractée ou révulsée de certains danseurs, et le saignement de nez qui accompagne généralement la transe, car ce sont autant de traits qui ont été notés par les peintres. De même, on peut supposer que les nombreuses figures de théranthropes tendent à rendre visible le processus de transformation surréelle survenant au cours de la transe, alors qu'elles seraient totalement incompréhensibles dans le cadre d'un art vériste n'ayant pour but que de décrire la vie quotidienne des chasseurs.
Bref, les peintures rupestres, même les plus énigmatiques en apparence, représentent donc bien quelque chose mais, plus que le gibier convoité ou son mode d'acquisition, elles évoquent le monde spirituel des anciens peintres, leurs croyances et, en partie, leurs rites destinés à se concilier le pouvoir des esprits-animaux. Depuis les travaux fondamentaux du linguiste allemand Wilhelm Bleek, de sa belle-sœur Lucy Lloyd et de sa fille Dorothea qui, vers la fin du xixe siècle, consacrèrent leur vie au recueil et à l'étude de témoignages contemporains des derniers dépositaires de l'ancienne tradition picturale, il est admis que le seul moyen de comprendre les peintures rupestres d'Afrique du Sud est de les replacer dans le cadre élargi des données mythologiques et linguistiques recueillies chez les anciens San.
Mais à partir des années 1960, il devint patent qu'il n'était guère possible d'analyser les œuvres à partir des seuls relevés – incomplets, partiels, tronqués, arbitrairement sélectionnés et souvent « arrangés » – jusqu'alors publiés. Sous l'impulsion de Patricia Vinnicombe, un riche courant d'études quantitatives vit alors le jour, consacré à l'enregistrement détaillé des sites, tant dans l'espoir d'en comprendre ainsi la signification, que dans celui d'apporter une assise scientifique à ces études.
Ces espoirs ayant été quelque peu déçus, les chercheurs s'intéressèrent à nouveau aux San, d'une part grâce à la multiplication des travaux sur ceux du Kalahari, et surtout grâce au dépouillement systématique des quelque 12 000 pages de notes et de transcriptions intégrales de mythes laissées par les Bleek. Grâce à la perspicacité de chercheurs comme David Lewis-Williams, il apparut alors que les conceptions générales ayant présidé à l'élaboration de l'art rupestre avaient été miraculeusement préservées, et que de nombreux détails des peintures pouvaient s'expliquer grâce à elles. Contrairement à ce qui s'était passé lors de la « lecture » de trois peintures sahariennes à la lumière des traditions peules, il ne pouvait s'agir ici de coïncidences, car non seulement les concordances étaient multiples et précises, mais elles permettaient soudain d'approcher les conceptions complexes ayant présidé à la création de centaines d'œuvres. De plus, cette direction de travail allait également montrer que les symboles utilisés pour la composition des peintures présentaient une riche polysémie, interdisant toute lecture monolithique.
Du reste, toute tentative globale d'explication négligerait la très longue durée au cours de laquelle se développèrent les arts rupestres d'Afrique australe. De nombreuses peintures témoignent des contacts entre les San, les Khoi-Khoi (Hottentots) et les Bantous, ces dernières populations pratiquant l'élevage, mais on a certainement exagéré l'impact qu'aurait eu sur l'art le contact, voire l'antagonisme, établi entre tous ces groupes.
Sur les peintures les plus récentes apparaissent, par contre, des images qui témoignent de l'arrivée des colons européens, et du calvaire que durent alors subir les San, jusqu'à leur quasi-extermination : on connaît plusieurs représentations de cavaliers tirant au fusil sur des petits hommes qui tentent de s'enfuir en courant... Ce sont là les dernières manifestations d'un art dont les origines sont à situer en plein Pléistocène. En effet, à Apollo Cave, un abri des montagnes Huns au sud de la Namibie, cinq plaquettes de pierre portant des peintures d'animaux en noir et en rouge, furent découvertes dans des couches d'occupation où la date la plus ancienne était de 26700 ± 650 B.P. Cela ferait de ces œuvres les peintures les plus vieilles d'Afrique, et certains auteurs en ont déduit que l'art rupestre sud-africain pourrait bien être aussi ancien que son homologue européen. Mais il convient de remarquer d'une part qu'il s'agissait ici d'art mobilier et non d'art rupestre à proprement parler, et de l'autre que l'argument serait plus convaincant si ces dates étaient confirmées.
Quoi qu'il en soit, David Lewis-Williams a judicieusement utilisé cette découverte pour réfuter localement une hypothèse implicite naguère en vogue, et selon laquelle l'art des peintures rupestres aurait connu une évolution complexifiante en ayant d'abord été monochrome, puis bichrome et enfin polychrome. Une fois de plus, il s'avérait donc que cette idée n'était rien d'autre qu'une notion née des préjugés évolutionnistes cultivés par certains chercheurs occidentaux.
Jean-Loïc LE QUELLEC
3. Extrême-Orient
• Chine
Le Paléolithique et le Mésolithique
L'impossibilité de travailler sur le matériel lui-même, le manque de concordance dans la terminologie, le peu de synthèses publiées sur des sites récemment fouillés rendent extrêmement difficile tout essai de faire le point sur cette période de la préhistoire chinoise. Aucune conclusion ne peut actuellement être tenue pour définitive, et les divergences entre savants sur la plupart des sites témoignent de ces difficultés. Cet article qui a été rédigé en 1972 ne rend évidemment pas compte des développements récents de l'archéologie chinoise. Pour en prendre connaissance, on se reportera à l'articleextrême-orient - Chine.Le Paléolithique inférieur
a) Les industries de Kehe. En 1959, les préhistoriens chinois découvraient au village de Kehe à l'extrémité sud-ouest de la province du Shanxi, onze gisements contenant treize espèces de mammifères fossiles et cent trente-huit objets façonnés à partir de galets de quartzite. Ces outils, éclats, choppers et chopping tools très primitifs, ainsi que la faune typiquement nihowan, permettent d'attribuer au site de Kehe une date antérieure à celle du sinanthrope.Au niveau de graviers de Kehe, qui appartiendrait au premier stade du Paléolithique inférieur, succède l'argile rouge caractéristique du Pléistocène moyen en Chine du Nord. Les gisements principaux sont à Zhoukoudian et dans la vallée du moyen Huanghe.
b) La culture de Zhoukoudian. Le site de Zhoukoudian, à quarante-deux kilomètres au sud-ouest de Pékin, est certainement le mieux connu. Les grottes et anfractuosités calcaires, signalées dès 1918, ont été fouillées de 1921 à 1937 (Bei Wenzhong et Teilhard de Chardin) et de nouveau depuis 1959.
Trois niveaux chronologiques au moins sont décelables à Zhoukoudian : la localité 13, la plus ancienne, la localité 1, enfin les localités 15, 3 et 4. La localité 13 n'a livré qu'un chopping tool, mais la localité 1, la plus riche par le nombre et la continuité des séries, montre une industrie du quartz taillé ( galets aménagés et éclats) associée à des restes fossiles du Sinanthropus pekinensis (l'homme de Pékin) et à une faune variée.
Le sinanthrope, que les anthropologues rapprochent du pithécanthrope de Java, est caractérisé par la station debout, une capacité crânienne de 1 000 centimètres cubes en moyenne et l'aptitude à fabriquer et à utiliser des outils. Vivant en groupe dans des grottes naturelles, le sinanthrope se nourrissait des produits de la chasse et de la cueillette, faisait du feu, pratiquait vraisemblablement le cannibalisme et employait des os comme outils sans pour autant les façonner.
L'outillage en pierre, qui s'apparente à une pebble culture évoluée, se compose de pièces sur galets ou fragments de galets, dont la pointe ou l'un des bords fut généralement utilisé. Les éclats, de débitage clactonien, furent parfois retouchés en racloirs.
c) Le moyen fleuve Jaune. De nombreux sites du Paléolithique inférieur, parmi lesquels Tongguan au Shaanxi, Shaanxian au Henan, Yuanqu au Shanxi, ont livré dans le niveau de terre rouge une industrie de galets et d'éclats semblable à celle du sinanthrope.
d) L'homme de Lantian. Une mâchoire inférieure d' hominidé a été découverte en 1963 à Lantian au Shaanxi, associée à un grand nombre de mammifères fossiles typiques du Paléolithique inférieur. Un crâne complet fut trouvé en 1964 à Gongwangling près de Lantian. Les traits morphologiques de ces deux fossiles montrent une nette parenté avec le sinanthrope, mais présentent des caractères plus primitifs qui les rapprocheraient plutôt du Pithecanthropus robustus de Java. Il est possible qu'ils correspondent à un stade un peu plus ancien que celui de l'homme de Pékin et soient contemporains de la localité 13 de Zhoukoudian. L'outillage associé aux fossiles comprend des choppers et des chopping tools en quartz et en quartzite, certains relativement grands et prismatiques.
e) « Gigantopithecus » et « Sinanthropus » en Chine du Sud. La présence en Chine du Sud du Gigantopithecus identifié par G. H. R. von Kœnigswald est confirmée par la découverte récente de nombreux fossiles trouvés in situ dans les dépôts jaunes des grottes du Guangxi, associés à une faune typique du Paléolithique inférieur.
On a également recueilli des dents d'un hominidé dont les traits primitifs sont comparables à ceux du Sinanthropus pekinensis. Mais le matériel trouvé autour de ce Sinanthropus officinalis reste trop peu abondant pour que l'on sache si la Chine du Sud était habitée par un Sinanthropus.
Le Paléolithique moyen
L'homme du Paléolithique moyen est actuellement représenté par trois groupes de fossiles correspondant aux trois principaux bassins fluviaux chinois : l'homme de l'Ordos, dans la vallée du Huanghe ; l'homme de Changyang, dans la vallée du Yangzi ; enfin l'homme de Maba, dans la vallée du Xijiang. Morphologiquement, il s'agit d'Homo neandertalensis.L'Ordos, qui englobe le Ningxia oriental, le sud-ouest de la Mongolie-Intérieure, le nord du Shaanxi et le nord-ouest du Shanxi, est la région de Chine où les industries du Paléolithique moyen sont le mieux connues. Un des sites les plus intéressants, celui de Shuidonggou, sur la rive orientale du Huanghe, a été fouillé en 1922 par le père Teilhard et le père Licent.
Les chasseurs de Shuidonggou fabriquaient des choppers, des pointes, des racloirs à partir de galets de quartzite. La plupart des outils sont massifs, mais certains sont très petits et des lames longues apparaissent.
Le Paléolithique supérieur
a) L'Ordos. Le site de Sjara-osso-gol (Mongolie-Intérieure) exploré par Teilhard et Licent en 1923, sur le bord de la rivière du même nom, a livré des outils très petits, taillés selon une technique typique des chopping tools, mais en progrès sur celle attestée à Shuidonggou. On a souvent réuni sous le nom de culture de l'Ordos Shuidonggou et Sjara-osso-gol. Ce groupement peut être trompeur car, bien que développés dans la même tradition, les outils de Sjara-osso-gol diffèrent de ceux de Shuidonggou par le matériau, la dimension et la forme. De plus, l'absence de choppers à Sjara-osso-gol et le développement sur ce même site d'une véritable industrie microlithique constituent une transition entre l'industrie du chopping tool et la culture microlithique qui va fleurir dans la région du Gobi à la période suivante.Cette situation de transition n'est pas limitée à l'Ordos. Des fouilles récentes au Henan et au Shanxi ont livré, associés à une faune lœssique typique du Pléistocène supérieur, des outils microlithiques, surtout des silex, taillés selon ce qui sera la tradition du Gobi. Des porteurs de cette tradition avaient donc leur habitat dans la vallée du Huanghe dès le Paléolithique supérieur.
b) L'homme et la culture de Dingcun. Les fouilles effectuées en 1954 sur le site de Dingcun, dans le Shanxi méridional, ont mis au jour des fossiles humains associés à une industrie de galets et d'éclats. Attribuée d'abord au Paléolithique inférieur, puis au Paléolithique moyen, la culture de Dingcun est actuellement considérée comme une survivance de la fin du Paléolithique inférieur dans le lœss du Paléolithique supérieur. L'outillage (éclats, souvent de grande taille et choppers) reste dans la tradition de Zhoukoudian, mais témoigne de progrès techniques et d'innovations : nucleus préparé, éclats finement retouchés, bifaces sur blocs et sur éclats, de style plutôt acheuléen.
c) La grotte supérieure de Zhoukoudian. Signalée en 1930 par Bei Wenzhong et fouillée en 1933-1934, cette grotte a livré une faune plus récente que celle de l'Ordos, des vestiges humains d'Homo sapiens de type mongoloïde associés à un outillage de silex et de quartzite. Pêcheur et chasseur, l'homme de la grotte supérieure façonnait des choppers et des chopping tools à partir de galets et adaptait des éclats de silex en racloirs. Il travaillait aussi l'os et les andouillers. Des perles de pierre habilement percées et peintes en rouge avec de l'hématite étaient utilisées comme parure, de même que des cailloux, des coquillages, des os et des dents perforés et polis. Des coutumes funéraires devaient exister et des échanges avec d'autres régions sont attestés.
d) Le Paléolithique supérieur en Chine du Sud. En 1951, des vestiges d'un Homo sapiens plus ancien que celui de la grotte supérieure, l'homme de Ziyang, furent découverts au Sichuan. D'autres vestiges d'Homo sapiens furent mis au jour au Guangxi, à Laibin et à Liujiang. Ces trois groupes sont mongoloïdes.
Le Mésolithique
a) Les dunes du Gobi et le Microlithique mongol. De nombreuses expéditions dans la région du Gobi au cours de la première moitié du xxe siècle ont donné lieu à des trouvailles de surface : outillage caractérisé par des microlithes en jaspe et par un percuteur globuleux. L'origine de la culture du Gobi, dont la datation reste difficile faute de stratigraphie, est vraisemblablement à chercher dans la culture du lac Baïkal, dont elle apparaît très proche.Le groupe de Shayuan au Shaanxi oriental montre des affinités avec le Microlithique du Gobi et des liens très nets avec les industries de l'Ordos du Paléolithique supérieur.
Vers l'est, la culture microlithique du Gobi s'étend jusqu'en Mandchourie avec deux sites principaux : Djalai-nor et Guxiangtun. Il semble bien qu'ici, comme dans les dunes de Mongolie, la tradition mésolithique persista très longtemps, même lorsque le Néolithique eut été introduit.
b) La Chine du Sud. De nombreux sites mésolithiques ont été signalés au Sichuan. L'industrie lithique de ces défricheurs de forêts semble rester dans la tradition du galet aménagé, mais un type caractéristique y apparaît que l'on peut appeler la « hache à épaulement », grande et lourde. Les microlithes sont inconnus. Des traits culturels semblables ont été relevés dans d'autres régions de la Chine du Sud-Ouest et s'apparentent aux niveaux hoabinhiens d'Indochine. Actuellement, on attribuerait plutôt ces niveaux au début du Néolithique, malgré l'absence de céramique et d'outils en pierre polie.
Le Néolithique
Chine du Nord
a) La culture de la poterie rouge. Les plus anciennes cultures néolithiques chinoises (env. 4000-3000 av. J.-C.) se situent dans le nord du pays, sur les hauts plateaux de lœss du Shaanxi, du Shanxi et du Henan occidental.Les agriculteurs vivent dans des villages temporaires qu'ils abandonnent après un certain temps d'occupation, suivant la technique de la culture sur brûlis. La répartition des villages sur une aire très vaste et les données stratigraphiques confirment des occupations discontinues et répétées. Ces établissements sont de dimensions restreintes : Banpocun, Baoji et Huaxian au Shaanxi, Linshanzhai et Miaodigou au Henan. L' habitat est varié : carré, rectangulaire ou rond, semi-souterrain ou en surface. À Banpocun, fouillé en 1954, la zone orientale du village était probablement le quartier de fabrication de la poterie, avec six fours ; le cimetière se trouvait au nord du village.
Montée à la main, à l'aide de boudins d'une argile mieux épurée et cuite à environ 1 000 0C, une céramique rouge semble réservée aux liquides et à la conservation des grains. Les formes comprennent de grandes jarres à fond pointu munies de deux petites anses, des pots, des bassins, des bols et des bouteilles. La surface est lissée. Certaines pièces sont ornées d'un décor noir, plus rarement rouge, peint avant la cuisson. Ce décor se compose de motifs géométriques : tresses, triangles (à Banpocun), lignes onduleuses (à Miaodigou). On y remarque aussi des représentations réalistes : poissons, masque humain à Banpocun, grenouille à Miaodigou.
On a donné à ce complexe néolithique le nom de culture de la poterie rouge ou de Yangshao, d'après le nom du site du Henan occidental où Andersson le distingua en 1921. La parenté de cette poterie rouge avec les céramiques néolithiques de l'Iran (Sialk, Anau) a incité certains archéologues occidentaux à attribuer l'origine de la poterie rouge chinoise à une influence étrangère. Mais les jalons intermédiaires manquent encore à l'appui de cette théorie. Les archéologues chinois pensent à une invention locale qui, apparue au Shaanxi, se serait propagée vers le Shanxi, le Henan et jusqu'au Shandong.
Vers le milieu du IIIe millénaire, la culture de la poterie rouge progresse vers l'ouest : au Gansu, les jarres globuleuses de la nécropole de Banshan sont décorées à l'épaule de décors peints en rouge et noir, où se mêlent motifs géométriques et figurations humaines très schématiques ; à côté de ces vases funéraires, les exemples retrouvés dans l'habitat voisin de Majiayao ont un décor plus simple et de couleur noire.
b) La culture de Longshan Si la poterie rouge se perpétue longtemps dans les provinces occidentales du Gansu et du Qinghai – sites de Machang, Qijia, Xindian, etc. –, elle disparaît lentement du bassin du fleuve Jaune pour faire place à une céramique grise ou noire qui correspond à la culture de Longshan, du nom du site où elle fut découverte en 1928 au Shandong.
-4000 à -2000. Naissance de l'écriture Apparition de l'écriture et des premières villes. Début de la métallurgie du cuivre. Expansion de la domestication du cheval. Le IVe millénaire peut être considéré comme le début de l'histoire car il voit apparaître l'écriture. La majeure partie du globe reste cependant occupée par des s…
Les paysans s'installent en villages permanents protégés par des murs en terre. Si la sédentarisation n'est pas complète, les occupations de sites apparaissent plus longues que dans la phase de Yangshao. Le centre du village est généralement occupé par une grande maison commune. L'industrie lithique et le travail de l'os témoignent d'une technique plus avancée qu'à Yangshao. Des os divinatoires et des anneaux de jade ont été retrouvés.
Cette culture de Longshan fut peut-être créée par les tenants de la culture de la poterie rouge, l'amélioration des fours ayant facilité cette évolution. Les sites de Miaodigou II et de Sanliqiao au Henan sembleraient l'indiquer et seraient antérieurs aux sites du Shandong. La céramique y est moins fine et moins abondante que dans le Longshan du Shandong. Les tons gris dominent. Certaines formes apparaissent, qui annoncent celles des bronzes rituels (tripodes à pieds pleins, coupes sur haut pied rond ajouré et cannelé, verseuses). Les traces du tour sont souvent utilisées comme décoration (filets en relief ou sillon sur les parois).
Le Longshan du Henan pourrait s'échelonner de 2500 environ à 1800 environ avant J.-C., tandis que le Longshan du Shandong serait un peu postérieur.
Chine du Sud
Trois horizons différents apparaissent en Chine du Sud, qui représentent chacun une aire culturelle distincte pendant une période donnée.L'horizon de la céramique cordée, touche les régions suivantes : Hubei occidental, Sichuan, Guangxi, Guangdong, Yunnan et Taiwan, peut-être aussi le Guizhou et le sud-ouest du Hunan.
Cet horizon est caractérisé par une économie fondée sur la chasse, la pêche, la cueillette et le ramassage des coquillages, par des outils en pierre taillée et par une céramique à impressions de cordes. Cette phase culturelle prend fin vers le milieu du IIe millénaire, lorsque des influences Shang atteignent ces régions.
L'horizon longshanoïde désigne l'extension de la culture septentrionale vers la vallée du fleuve Huai, la basse vallée du Yangzi et les vallées côtières du sud-est.
Cet horizon est marqué par des habitats situés sur des buttes ou montés sur pilotis, par la culture du riz et du millet, la domestication des animaux, la pratique de la scapulomancie, l'usage important de l'os et des coquilles, l'absence de métallurgie, enfin par l'emploi de haches, d'herminettes, de couteaux et de faucilles en pierre polie. La céramique, inspirée de la culture de Longshan en Chine du Nord, comprend un certain nombre de formes typiques telles que tripodes, vases verseurs, par exemple.
Cet horizon méridional apparaît comme une extension des débuts de la culture de Longshan en Chine du Nord. Il est difficile encore de situer ses débuts. Développé assez vite en phases régionales (culture de Qingliangang au Jiangsu, par exemple), il a dû se perpétuer pendant une période très longue, au moins jusqu'au milieu du IIe millénaire avant notre ère.
L'horizon géométrique, qui désigne la prépondérance d'un décor géométrique estampé sur la céramique, semble être une tradition distincte du Sud-Est, qui succède, dans cette région, à l'horizon longshanoïde. La plupart des traits culturels longshanoïdes se continuent, mais les tripodes, la céramique faite au tour et les décors peints diminuent ; ils sont remplacés par des urnes à fond rond, le façonnage à la main et le décor par impressions géométriques. Dans certaines régions – Anhui, Jiangsu, Zhejiang –, la métallurgie du bronze apparaît et de nombreux motifs de la céramique géométrique imitent des décors du bronze. La densité des sites archéologiques de cet horizon croît considérablement par rapport à l'horizon précédent ; l'aire de dispersion reste la même, mais il faut y ajouter le Hunan.
Il est vraisemblable que cet horizon s'est développé grâce à l'impulsion des civilisations contemporaines du Nord (Shang et Zhou) sur un substrat local longshanoïde. Ses débuts doivent se situer vers 1500 avant J.-C., tandis que le passage à l'âge du bronze, influencé par les Zhou orientaux, varie et se situe entre 700 et 300 avant J.-C. selon les régions.
Michèle PIRAZZOLI-t'SERSTEVENS
• Corée
Le Paléolithique et le Mésolithique
Malgré les récents progrès de l'archéologie paléolithique en Corée, la présence des premiers hommes dans la péninsule, il y a un demi-million d'années environ, est très discutée, et les industries lithiques et osseuses des Paléolithiques inférieur et moyen restent encore mal définies. Avec le début du Paléolithique supérieur il y a trente mille ans, les données se font plus précises. Les habitats de grotte ou de plein air, comprenant parfois un foyer ou des trous de poteaux, ont livré une grande quantité d'outils sur lame et de petits outils très finement retouchés, dont divers types de grattoirs, des burins, des becs et des pointes pédonculées. La matière première varie, mais l'utilisation de l'obsidienne semble particulièrement répandue. L'existence d'un art paléolithique demeure controversée, bien qu'une gravure rupestre piquetée représentant des cervidés soit parfois attribuée à cette période de la fin du Pléistocène.La transition avec le début de l'Holocène (env. 11000-6000 av. notre ère) est l'une des phases les moins bien connues de la préhistoire coréenne. D'après les études des années 1990, les hommes ne semblent pas avoir abandonné la péninsule à cette époque comme le prétend la théorie traditionnelle. Les sites, répartis sur l'ensemble du territoire, ont révélé la pratique d'une industrie microlithique sur lame à nucléus cunéiformes. Les plus anciennes céramiques connues en Corée datent peut-être de la fin de cette période. Bien qu'il y ait de nombreuses polémiques à ce sujet, de telles données s'intègrent parfaitement dans l'horizon postglaciaire du Nord-Est asiatique, caractérisé, entre autres, par l'apparition d'une céramique grise décorée qui indique une évolution progressive vers le Néolithique.
Le Néolithique
On a longtemps associé le Néolithique coréen à l'arrivée d'une nouvelle population dans la péninsule. Les variations régionales mises en évidence depuis 1980 semblent indiquer un phénomène beaucoup plus complexe. Dès le début du VIe millénaire, les premiers villages sédentaires se forment le long des rivières et des côtes, et l'utilisation de la céramique devient importante, notamment pour stocker la nourriture et préparer les aliments qui se diversifient alors. Les sites de la côte est, riches d'une céramique décorée de motifs en relief, sont à rapprocher des sites japonais du Jōmon Initial. Peut-être tout aussi ancienne, la célèbre céramique de forme conique à décor au peigne serait, elle, originaire du bassin du fleuve Han. À partir de 3500 avant J.-C., cette céramique s'étend à l'ensemble de la péninsule avec des décors plus chargés et des fonds plats, surtout dans le Nord. En même temps, la culture du millet s'ajoute progressivement aux activités précédentes de chasse, de cueillette, de pêche et de ramassage de coquillages. L'outillage lithique, qui s'adapte à cette agriculture naissante, devient plus complexe. L'artisanat du textile est attesté par la présence de fusaïoles, de poids de métiers à tisser, de perçoirs et d'aiguilles en os.L'art mobilier se développe au cours de cette période : bracelets de coquillage, petits anneaux en néphrite ou en marbre, perles de toutes sortes dont certaines en jade, épingles à cheveux décorées, petits masques et figurines zoomorphes et anthropomorphes.
Vers 2000 avant J.-C., la société coréenne subit de nouvelles transformations qui marquent la fin du Néolithique. Pour les périodes protohistoriques et historiques, on se reportera à l'article corée (Les arts de la Corée).
Laurence DENÈS
• Japon
Depuis vingt-cinq ans, les progrès des fouilles archéologiques au Japon et l'étude comparative de leurs résultats avec ceux qu'ont obtenus sur le continent asiatique les savants russes et chinois ont considérablement modifié les données établies avant la Seconde Guerre mondiale. Cet article qui a été rédigé en 1972 ne rend évidemment pas compte des développements de l'archéologie japonaise. L'existence dans l'archipel d'un Paléolithique (pour le Paléolithique japonais, on se reportera à l'article japon - histoire) et celle d'un Mésolithique sont désormais attestées, et leurs caractéristiques s'accordent avec celles observées dans les cultures du même genre de la Chine et de la Sibérie. Comme celui des provinces maritimes de la Sibérie et des forêts de la Mandchourie, le Néolithique des chasseurs-pêcheurs du Japon se caractérise par un outillage en pierre polie et une céramique, mais ignore l'agriculture. Les fouilles récentes ont montré que ce Néolithique trouve son origine dans les stades antérieurs des cultures japonaises. Étudiées en 1960, les strates successives de l' abri sous roche de Fukui (province de Nagasaki) au Kyūshū ont révélé, dans les couches supérieures, auprès d'un matériel lithique de la fin du Mésolithique, une poterie grossière ornée de filets en relief et de bandes d'argile rapportées (couche 3) à laquelle succèdent dans la couche 2 des spécimens à filets plus fins et d'autres à impressions d'ongles. On retrouve des échantillons analogues à ceux de la couche 2 dans la province de Yamagata (Hondo septentrional), où ils voisinent avec des fragments à impressions de cordelettes courtes et avec des outils à tranchants polis, analogues à ceux de la Sibérie. Ainsi se trouve établie la filiation des céramiques à impressions cordées ( Jōmon, qui ont donné leur nom au Néolithique japonais). Cette céramique dont l'évolution s'étend sur tout l'archipel présente une unité frappante, en dépit de nombreuses variétés locales et de l'emploi de techniques diverses (impressions cordées, tampons, lissoirs, etc.) que l'on trouve sur le continent voisin.Aux pièces à fond pointu succéderont des bassins profonds à fond plat, proches de ceux du littoral sibérien. C'est à l'époque du Jōmon moyen que, sur le littoral du Pacifique (région de Tōkyō), le plus favorisé par le climat, apparaissent, avec des habitats plus denses aux demeures semi-souterraines pourvues d'un foyer et aux importants amas de coquillages (kaizuka), de hauts bassins à l'ouverture rehaussée de boudins d'argile et de masques d'animaux en relief, d'un parti stylistique parfaitement original. Les figurines modelées dans la terre ( dōgu), traitées jusqu'alors de façon réaliste, se schématisent et se revêtent d'un décor de spirales et d'impressions cordées. Ce style nouveau se répandra dans l'île de Hondo (ou Honshū) et, avec certaines modifications, se perpétuera très longtemps dans la partie septentrionale de cette dernière. L'apparition à la même période d'un outillage en os (harpons, poissons-leurres, parures), qui s'inspire de modèles sibériens, témoigne de rapports renouvelés avec le continent, rapports dont le mécanisme et la localisation n'ont pas encore été éclaircis.
Contrairement aux datations très hautes obtenues après la guerre par la méthode du carbone 14, ces rapports attestés avec le continent inclinent aujourd'hui les archéologues japonais à harmoniser leur chronologie avec celle établie par les savants continentaux et à rabaisser l'apparition du Néolithique au IIIe millénaire avant notre ère.
Dans le nord-ouest du Kyūshū, vers les iiie-iie siècles avant J.-C., de nouvelles techniques, transmises par l'intermédiaire de la Corée du Sud (riziculture, métallurgie, tissage, etc.), transformeront les chasseurs-pêcheurs en agriculteurs, c'est ainsi que les premières poteries Yayoi voisineront avec des spécimens du Jōmon tardif. Au cours des siècles qui suivront, agriculture et métallurgie se répandront rapidement dans l'île de Hondo. Seul, l'extrême nord de l'île restera longtemps fidèle aux techniques néolithiques.
Madeleine PAUL-DAVID